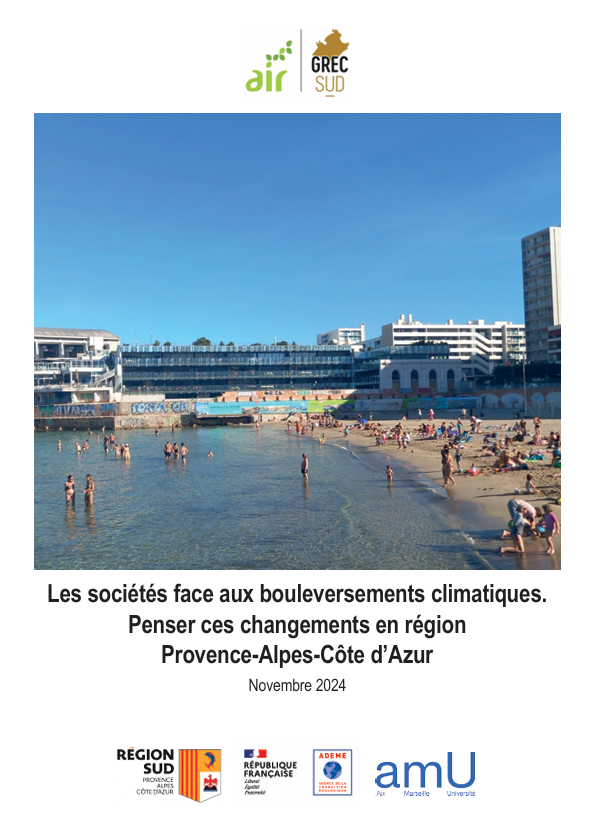Les sciences humaines et sociales sont fondamentales pour mener une action collective ambitieuse à la hauteur des enjeux des changements climatiques et environnementaux en cours et à venir. Elles sont riches d’enseignements, à la fois pour comprendre des phénomènes globaux, mais également pour saisir des situations vécues, singulières. Elles nous permettent d’interroger l’histoire, de comparer des trajectoires territoriales à priori éloignées, de se doter d’outils analytiques et critiques pour penser le futur de nos sociétés.
Le cahier "Les sociétés face aux bouleversements climatiques" nous éclaire, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur les questions qu’il est nécessaire de se poser lors de la construction de projets de territoire et l’élaboration de politiques publiques et nous invitent à repenser nos modèles économiques, politiques ou encore juridiques.
Sommaire
Sommaire du cahier
- Messages clés
- Résumé
- Introduction
- Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?
-
Se représenter le changement climatique au travers du risque
- Le risque, une évidence ?
- Faire face au changement climatique : des processus psychosociaux à l’œuvre
- Perception des risques induits par le changement climatique dans deux grandes villes : Marseille et Nice
- Vivre les fournaises urbaines. Les représentations et affects urbains à l’épreuve du changement climatique
- Développer une culture du risque inondation : retours d’expérience en basse vallée de la Durance
- La perception des risques côtiers (érosion, submersion, inondation) par les acteurs publics locaux
-
L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques
- L’adaptation des stations de ski aux changements climatiques. Du déni marchand à l’alternative éthique ? Une comparaison entre Alpes du Nord et Alpes du Sud
- Une bifurcation touristique pour une transition socio-environnementale des Alpes du Sud
- Les déterminants de l'adaptation des pratiques de la gestion forestière au changement climatique
- Penser l’adaptation de la viticulture au changement climatique : s’intéresser aux savoirs territorialisés
-
Une gouvernance territoriale à réinventer
- La mise en œuvre d’un droit climatique dans les territoires
- Le traitement des risques côtiers induits par le changement climatique dans les documents d’urbanisme des communes littorales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : un attentisme local qui interroge
- La planification territoriale pour le changement climatique est-elle utile ? Limites et leviers pour l’action
- La Camargue : s’adapter à l’adaptation au changement climatique
-
Les citoyen.nes, des actrices et acteurs incontournables
- La gestion souple du trait de côte : donner la parole aux usagers et communiquer sur les travaux de renaturation du cordon dunaire des Vieux Salins d’Hyères
- Le rôle des associations et des citoyens dans l’exigence juridique en matière de changement climatique
- Échec et réussite de la Convention citoyenne pour le climat
- Les procès climatiques : la responsabilisation des acteurs économiques dans leur contribution à l’effort climatique
- La recherche-action participative - Repenser la « culture en terrasses » dans la Roya
- Conclusion
- Remerciements
-
Messages clés
Les résultats de recherches en sciences humaines et sociales, qui abordent des objets d’étude complexes et qui exigent de la nuance, comme pour toute science, se prêtent rarement à des résumés succincts. Mais prêtons-nous au jeu, à l’instar des rapports du GIEC ! Voici, énoncés en quelques lignes, les résultats saillants des recherches présentées dans ce cahier.
1. Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?
□ Le climat a déjà changé par le passé dans la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, impactant fortement des sociétés et les paysages.
□ Le thème actuel du changement climatique est apparu progressivement dans les discours médiatiques depuis les années 1980.
□ Les représentations sociales du changement climatique se sont affinées sur ces vingt dernières années : en 2022, seul un quart des Français interrogés affirment qu’« on s'adaptera sans trop de mal ».
2. Se représenter le changement climatique par le risque
□ Le « risque » est une construction sociale qui dépend de notre vision des enjeux importants.
□ L’appréhension des bouleversements climatiques dépend de la mémoire sociale des évènements passés ou encore de la confiance dans les acteurs politiques.
□ À Marseille et Nice, en 2015, les personnes enquêtées étaient tout à fait conscientes du changement climatique, mais peu s’en inquiétaient.
□ Les expériences du changement climatique sont pourtant très prégnantes dans les milieux les plus densément urbanisés.
□ Les résidents vivant en zone inondable comme dans la basse vallée de la Durance s’informent peu sur le risque, même quand ils y sont exposés quotidiennement.
□ Le risque d’inondation est davantage perçu que le risque de submersion marine par les élus locaux du littoral de la Région Sud (qui est une notion plus abstraite pour ces derniers).
3. L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques
□ Une station de ski des Alpes du Sud s’adapte mieux aux changements climatiques que certaines de ses homologues du Nord accrochées au modèle « tout ski ».
□ Certains territoires de montagne comme le Queyras, se caractérisent par une cohabitation paradoxale entre ces deux types de trajectoires.
□ Les stratégies d’adaptation des propriétaires forestiers français sont diverses, selon leurs caractéristiques sociales et professionnelles, leurs usages de leur forêt et leurs représentations du changement climatique.
□ Dans certaines zones comme le Ventoux, les viticulteurs sont conscients du changement climatique et en conséquence repensent le périmètre d’appellation avec des critères liés au changement climatique.
4. Une gouvernance territoriale à réinventer
□ Le droit français a progressivement décentralisé beaucoup de compétences en matière de changement climatique, répartis entre différents secteurs d’action publique, ce qui complexifie la gestion de l’adaptation.
□ L’analyse des documents de planification urbaine montre que les collectivités littorales de la région n’ont pas encore pleinement pris la mesure des changements induits par le changement climatique.
□ Le manque de ressources financières limite l’impact de la planification territoriale.
□ La gestion des ressources naturelles, si elle ne répond pas à des principes de justice environnementale - de partage et de solidarité entre territoires - peut conduire à des phénomènes de maladaptation.
□ La Camargue, sujette à de nombreux risques (submersion marine, salinisation des terres, tourisme de masse…), est une société locale consciente de la nécessité de s’adapter mais qui doit se donner les moyens de traiter collectivement et de manière intégrée l’adaptation à ces risques.
5. Les citoyens, des acteurs incontournables
□ Lors de la renaturation du cordon dunaire des Vieux Salins d’Hyères, la pédagogie et la communication employée pour mobiliser les résidents ont permis de mettre en place des modes de gestion alternatifs du trait de côte.
□ Des dispositifs tels que les conventions citoyennes, celle de Marseille par exemple, permettent de penser collectivement le changement climatique et de proposer des solutions consensuelles.
□ Les associations de citoyens se mobilisent en portant des actions juridiques contre les pouvoirs publics devant les tribunaux.
□ De tels procès tentent de responsabiliser des acteurs économiques pour contribuer à l’effort climatique.
□ Cultures en Terrasses, dans la vallée de la Roya, associe chercheur.es, associations et acteurs du territoire pour penser l’avenir et les transitions économiques et agricoles à la suite des inondations de 2022.
-
Résumé
L’origine anthropique des bouleversements climatiques actuels est sans conteste. L’intrication entre le climat et les choix collectifs portés par les institutions et les sociétés humaines est soulignée dans la synthèse du 6e rapport d’évaluation du Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) : en fonction des trajectoires socio-économiques qui seront prises au cours des prochaines décennies, le globe se réchauffera de 1,5°C à 5°C à l’horizon 2100. Ces trajectoires dépendent des choix de société des années à venir.
Les sciences humaines et sociales (science politique, histoire, sociologie, anthropologie, psychologie sociale, géographie, droit, économie…) sont donc cruciales pour guider l’action collective afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et adapter nos territoires aux effets du changement climatique. Ces disciplines nous permettent également de mieux comprendre notre présent et de penser nos futurs, d’éclairer les transformations sociales impactées par les changements climatiques et environnementaux (transformation de nos métiers, de nos paysages du quotidien) et, plus largement, de repenser nos modèles économiques, politiques ou encore juridiques.
Un premier apport des sciences humaines et sociales est de fournir un recul historique face à des phénomènes nouveaux ou d’ampleur inédite. Ces recherches témoignent de la manière dont des sociétés antérieures aux nôtres ont agi face à des changements de climat, parfois très impactant bien que moins abrupts que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Les fluctuations du petit âge glaciaire en Provence ont contraint les habitants à s’adapter à d'importantes inondations, à des froids exceptionnels ainsi qu’à des sécheresses longues et intenses. Déjà, les grandes stratégies nationales déclinées indépendamment des contextes locaux ont mis en évidence les contradictions entre développement agricole et déforestation, exposant les territoires de la Provence à des inondations inédites. Si le défi n’est pas nouveau, les témoignages de mal-adaptation de sociétés dans le passé doivent être relus à l’aune de l’accélération inédite de ces phénomènes climatiques extrêmes à l’heure actuelle.
Si le changement climatique constitue aujourd’hui une évidence scientifique, il n’a pas toujours fait l’objet du même traitement politique et médiatique : il a dû intégrer le débat public, conquérir les sphères décisionnaires aux échelles internationales et nationales. De nombreuses questions sont apparues : est-ce un phénomène cyclique, anthropique, inéluctable ? Afin de dépasser les perceptions et l’expérience immédiate, la variabilité saisonnière et spatiale, promouvoir des savoirs climatiques sur plusieurs décennies, la création, en 1988, du GIEC, a été cruciale pour établir ces évidences partagées, construire un savoir collectif clair et accepté. Malgré ce portage institutionnel et scientifique, les représentations du changement climatique continuent de fluctuer au fil des années, des évènements politiques, des extrêmes météorologiques. Les phénomènes que les sciences du climat et de l’environnement décrivent et quantifient depuis des décennies, sont différemment reçus et interprétés selon l’époque, le territoire ou bien la catégorie socio-professionnelle des individus. Lors de fortes canicules, ou après la tenue d’une COP, une attention toute particulière sera portée au climat alors que dans certains contextes politiques, les discours portés par des partis conservateurs qui entretiennent un rapport distant à la science, mettent en avant du climato-scepticisme. Les phénomènes climatiques et environnementaux ne peuvent donc être considérés indépendamment des processus économiques, politiques ou encore psycho-sociaux à l’œuvre.
Faire face aux enjeux du changement climatique implique de pouvoir se représenter les risques encourus, agir malgré l’incertitude et plus fondamentalement, de pouvoir renouveler nos manières de penser le futur de nos professions, de nos villes, de nos territoires. Tout d’abord, la gestion des risques climatiques suppose de disposer de connaissances territorialisées tout en composant avec l’incertitude pour tracer des trajectoires d’adaptation et construire des territoires résilients. Pour ce faire, il est important de pouvoir identifier ce qu’est un “risque”, ce qu’est un territoire vulnérable, tout en ajustant au fil des années les trajectoires d’adaptation en fonction des risques encourus.
Les processus psychosociaux qui empêchent de prendre la pleine mesure de certains enjeux sont pléthores : comparer la Côte d’Azur à la côte Atlantique pour relativiser des risques en région, refuser de penser la transformation d’une économie touristique de montagne ou encore portuaire, se sentir protégés par des digues... ces biais supposent autant de nouveaux rapports à construire avec nos environnements maritimes, alpins, etc. De fait, afin de fonder des politiques de gestion du risque cohérentes, adaptatives et acceptables, il est nécessaire de comprendre les spécificités locales et les trajectoires socio-historiques des territoires de la région. Ainsi, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, certains risques sont sur-représentés (inondations, feux de forêts, canicules urbaines) tandis que d’autres émergent tardivement (submersion marine, érosion, retrait et gonflement des argiles…). Par ailleurs, certains évènements traumatiques, à l’instar des inondations dans le sud-ouest des Alpes Maritimes survenues en octobre 2015, ou encore de la tempête Alex dans les vallées alpines de l’est des Alpes Maritimes en octobre 2020, en rappellent l’actualité.
Les institutions et acteurs en responsabilité de la gestion des risques doivent mettre en œuvre des politiques d’accompagnement et de prévention adaptées à ces nouveaux enjeux ; en intégrant à la fois l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Malheureusement, les recherches présentées ici montrent qu’il n’en est pas toujours ainsi. La planification territoriale doit être repensée pour intégrer des projets de territoires concertés et faire avec les habitants, discuter des nouveaux usages, consacrer un rapport renouvelé aux ressources et aux solidarités territoriales. Aussi, aux côtés des décideurs, les citoyens et associations ont un grand rôle à jouer pour coconstruire des politiques adaptées et transformatives, participer à l’élaboration de règles dédiées, élaborer des plans de gestion ambitieux, mais également porter des procès climatiques, ou responsabiliser les grandes entreprises fortement émettrices de GES. Les contestations, bien que peu évoquées dans ce cahier, sont des espaces importants pour porter, à d’autres échelles, les enjeux territoriaux qui se font jour (controverses associées aux méga bassines, déploiement des énergies renouvelables, etc.).
Enfin, de nouvelles interfaces science-société apparaissent et les dispositifs de recherche action participative se multiplient. Il est non seulement possible de faire de la recherche autrement, de corréler les interrogations scientifiques aux demandes formulées par les territoires, mais également d’impliquer des publics plus larges pour construire des savoirs utiles à la décision publique.
-
Introduction
La synthèse du 6ème rapport d’évaluation du GIEC souligne que les politiques publiques relatives à l’atténuation se sont généralisées depuis le 5e rapport d’évaluation du GIEC paru en 2014. Toutefois, ces mesures et engagements des états restent en deçà des transformations nécessaires pour respecter la trajectoire 1,5°C. Par ailleurs, la planification et la mise en œuvre de mesures d’adaptation au changement climatique ont globalement progressé. La gestion intégrée des ressources en eau, le recours à l’agroforesterie, la réaffectation des terres et la valorisation d’approches favorisant les solutions fondées sur la nature (végétalisation urbaine, restauration des zones humides et des écosystèmes forestiers) ont contribué à une résilience renforcée. Toutefois, ces réponses restent trop fragmentées, incrémentales et spécifiques à certains secteurs d’activité ou certains territoires.
De fait, comprendre l’écart entre les perspectives et les besoins urgents d’atténuation et d’adaptation au changement climatique nécessite de mobiliser les différentes disciplines des sciences humaines et sociales (science politique, histoire, sociologie, anthropologie, psychologie sociale, géographie, droit, économie…) aux côtés des sciences du climat et du vivant. Dans une région soumise à de nombreux risques et évènements climatiques extrêmes, à l’augmentation des températures moyennes annuelles, notamment sur le pourtour du bassin méditerranéen, à l’intensification des vagues de chaleur et des canicules et la perturbation du cycle hydrologique (sécheresse et inondations), l’enjeu est grand. Les inondations du sud-ouest des Alpes Maritimes en octobre 2015, la tempête Alex dans les vallées alpines au-dessus de Nice, la sécheresse qui sévit depuis l’été 2022 et les canicules marines à répétition sont autant de marqueurs de ces bouleversements climatiques et environnementaux en cours et à venir.
S’il est nécessaire d’« accélérer la transition », de mettre à disposition des outils d’aide à la décision fondés sur des savoirs territorialisés, les sciences humaines et sociales permettent également de retracer les transformations qui façonnent en profondeur nos sociétés. Ce cahier illustre différentes approches théoriques et méthodologiques qui partent tantôt de l’individu, tantôt des collectifs ou des institutions et qui éclairent plusieurs dimensions de ces bouleversements en cours et à venir. Les méthodologies de recueil de données mobilisées et les publics ciblés varient d’une étude à l’autre et dépendent des résultats escomptés : entretiens individuels, analyse de documents écrits, traitement de données issues de sondages, etc. Certaines enquêtes sont menées en collaboration avec des acteurs territoriaux. Cette synthèse régionale illustre la diversité des approches et des apports des sciences humaines et sociales mais ne saurait rassembler de manière exhaustive toutes les études en région. Ce cahier est également loin de couvrir toutes les dimensions sociales du changement climatiques. De très nombreuses enquêtes restent à mener pour bien comprendre la manière dont notre société – et notre région en particulier – l’abordent, entre efforts d’atténuation et d’adaptation mais aussi parfois avec une dangereuse insouciance.
En proposant des allers-retours entre phénomènes globaux et enjeux locaux, ce cahier ambitionne de donner des clefs de compréhension des changements économiques, sociaux et politiques qui s’opèrent pour faire face aux enjeux climatiques en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il permet d’examiner l’évolution du rapport aux questions climatiques en région mais également de mettre en lumière la manière dont les acteurs publics et privés s’emparent de ces questions, transforment (ou non) leurs métiers et leurs modèles de développement.
-
Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?
Nos sociétés mettent du temps à se saisir de changements climatiques qui eux-mêmes évoluent, et qu’elles perçoivent comme plus ou moins nouveaux. Les sciences humaines et sociales permettent de situer ces phénomènes actuels dans le temps, de les remettre en perspective. Dans cette première section, la recherche historique nous rappelle que des époques antérieures ont connu des bouleversements dont nous pouvons tirer des leçons. Puis, sur une période bien plus récente, un examen des discours médiatiques nous permet de suivre la construction progressive du problème public qu’est le changement climatique. Par ailleurs, si les représentations sociales de ces changements globaux évoluent et se stabilisent grâce à de nombreuses recherches et aux différents rapports du GIEC, il n’en demeure pas moins qu’elles fluctuent dans le temps et dans l’espace, qu’elles varient en fonction des appartenances politiques et des milieux sociaux.
-
Des changements dans le climat au passé
Stéphane Durand (Centre Norbert Elias)
Si l’ampleur actuelle du réchauffement global est inédite dans l’Histoire, le changement climatique est en revanche un phénomène qu’ont connu les sociétés qui nous ont précédé sur le territoire. En particulier, le Petit Âge Glaciaire, avec ses propres fluctuations internes, a touché la Provence et ses environs entre le XIVe et le XIXe siècle, contraignant les habitants de la région à s’adapter à ses effets. Pluies importantes et inondations conséquentes dans le bassin de la Durance et dans le delta du Rhône, violentes tempêtes sur le littoral, froids exceptionnels au cours de certains hivers ; voici quelques-uns des extrêmes auxquels ces sociétés ont été exposées. Le défi environnemental n’est donc pas nouveau ; en revanche, il a changé de mesure et de rythme.
Le concept de vulnérabilité appliqué aux sociétés anciennes conduit à s’interroger au sujet du rôle qu’ont joué les formes d’occupation du territoire dans leur exposition à ces extrêmes météorologiques. La déforestation de la Haute-Provence pour une mise en valeur agricole et l’exploitation de la ressource en bois, dénoncée dès le XVIIIe siècle, a considérablement accru la force des inondations, de l’aval des versants montagneux jusqu’aux embouchures des fleuves. Par ailleurs, la descente sur le littoral de certaines communautés provençales juchées jusqu’au XVIIe siècle sur les premières hauteurs de leurs terroirs les a inévitablement exposées aux coups de mer et à l’érosion conséquente. Ces deux formes de maladaptation correspondaient néanmoins à des objectifs légitimes : accroissement des disponibilités alimentaires et développement du commerce maritime. La contradiction entre ces ambitions et les défis environnementaux était mal résolue. Dès lors, la recherche historique, qui contribue à fournir des données paléoclimatiques pour un passé proche (500 à 1000 années avant la période actuelle) grâce à l’exploitation d’archives diverses, peut aussi – et surtout – servir, comme les autres sciences humaines et sociales, à évaluer la capacité des sociétés à s’adapter au changement climatique. La bibliothèque de références que constituent les situations historiques documentées et analysées par la recherche permet d’identifier un certain nombre de points de vigilance pertinents pour concevoir les adaptations d’aujourd’hui. Ainsi, la forme et le fonctionnement des systèmes de gouvernance ne sont pas neutres pour la capacité des sociétés à s’adapter : la nécessaire articulation entre enjeux globaux et intérêts locaux n’est pas nouvelle, pas plus que le défi d’implication des populations et de mobilisation des ressources nécessaires à l’adaptation. Concrètement, les formes de gouvernance centralisées donnent l’illusion d’une plus grande efficacité en raccourcissant les circuits de prise de décision, sans cependant emporter l’adhésion des sociétés locales. Par ailleurs, la mise en œuvre des solutions ingéniériales questionne les conditions de leur élaboration, entre compétences techniques, moyens mobilisables et adhésion des habitants. C’est ainsi, par exemple, que les ingénieurs du roi – dont les choix techniques n’étaient guère discutés – changèrent le cours du Rhône au XVIIIe siècle sans l’avoir véritablement voulu en cherchant à noyer les salines illégales de quelques habitants pour satisfaire les intérêts des concessionnaires privés des salines royales. Ils laissèrent s’échapper les eaux du fleuve dans un nouveau chenal, bouleversant ainsi toute la morphologie d’une partie du delta. Il faut néanmoins prendre garde à ne pas aborder les choses de manière simpliste : tous ces aspects fonctionnent de manière systémique, comme toute construction sociale, et tout usage de références nécessite une mise en contexte, exactement comme lorsqu’on mobilise un exemple pris à l’autre bout du monde.

-
Le changement climatique dans les médias : apparition et évolution
Raquel Bertoldo (LPS) & Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE)
La question climatique est apparue sur la scène médiatique durant les années 1980 et à la fin de la décennie, les grands médias commençaient à attribuer clairement aux activités humaines la catastrophe à venir. Dans ce contexte, le changement climatique est d’abord décrit comme potentiellement catastrophique, constituant une menace pour la planète entière même si le rôle des comportements humains n’est pas toujours évoqué par les médias.
Cette tendance à couvrir la thématique de façon catastrophiste mais déconnectée des actions humaines sera véhiculée et renforcée par des courants climatosceptiques à partir des années 1990. En effet, malgré la formation d’un large consensus, dans de nombreux pays, sur le caractère anthropogène du changement climatique actuel, certaines personnes, chercheurs compris, restent plutôt climatosceptiques ou continuent à associer ces changements plutôt à un phénomène naturel, inévitable et cyclique.
La cristallisation des idées climatosceptiques se complexifie davantage encore avec l’entrée dans le débat public et médiatique sur le climat de figures politiques telles qu’Al Gore ou du faux scandale du ClimateGate[NBP] Le ClimateGate est une affaire de piratage informatique en 2009 d’une unité de recherche climatique de l’université d’East Anglia qui travaillait sur les changements climatiques. Dans un premier temps accusés de conspiration, les chercheurs ont été totalement blanchis depuis.
L’affaire a néanmoins contribué à réduire l’impact de la COP 15 à Copenhague la même année.[\NBP] qui a temporairement terni la réputation des climatologues. Des études ayant analysé la consommation des médias par les climatosceptiques américains, plutôt conservateurs, ont montré leur nette préférence pour des médias qui sont, eux aussi, conservateurs et à tendance climatosceptique. En France, l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) avait constaté, dans une enquête menée auprès de parlementaires en 2020 que le climatoscepticisme est davantage porté par des élus de droite que par des élus de gauche. À titre d’exemple, 43% des élus de droite pensent que « Les scientifiques qui étudient les évolutions du climat exagèrent les risques de réchauffement climatique », tandis que c’est le cas pour seulement 4% des élus de gauche, et 1% des élus de la majorité présidentielle.Cette brève présentation des enjeux médiatiques et politiques sous-jacents au débat climatique met en exergue la légitimité de la place de la science et l’enjeu d’ajuster la communication scientifique à cette polarisation. Comme dans d’autres polémiques sociales sur des risques (à l’instar de celles sur les biotechnologies) ces questions révèlent des scissions qui vont au-delà des savoirs scientifiques, et qui traduisent des positionnements politiques.
Le GIEC et l’évolution du rapport à la science
Wolfgang Cramer (CNRS, IMBE)
Le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) a été créé en 1988. Les rapports du GIEC sont une synthèse de dizaines de milliers d’articles scientifiques, toutes disciplines confondues. Ils évaluent l’évolution, les causes et les impacts du changement climatique. Le GIEC a produit 6 rapports d’évaluation entre 1990 et 2023, mais également des rapports spéciaux sur demande des États.
Les rapports d’évaluation du GIEC instaurent une dynamique bidirectionnelle, à mi-chemin entre les préoccupations scientifiques et les demandes d’expertise des États. Cette instance rassemble des représentants des États membres (195 à ce jour) qui envoient des délégués dans les grandes conférences et qui, avec les chercheurs, animent cet échange structuré entre les décideurs et les scientifiques.
Les étapes sont bien cadrées : la planification d’un rapport fait l’objet d’une discussion et d’une demande des gouvernements (rapports généraux ou spéciaux). La présentation du rapport est soumise à l’approbation par tous du résumé à l’attention des décideurs.
L’enjeu est donc d’établir des évidences partagées qui puissent être prises en compte dans les politiques publiques. Ainsi, l’accord de Paris en 2015 n’aurait jamais eu la forme et le contenu actuel sans le rapport du GIEC en amont.
-
Les représentations sociales du changement climatique ces vingt dernières années
Daniel Boy (Science Po, CEVIPOF)
L’Agence de la Transition Écologique (l’ADEME) fait réaliser chaque année, depuis 2000, une enquête sur les représentations sociales du réchauffement climatique sous la forme d'un sondage administré à un échantillon représentatif de la population française. Ces enquêtes réalisées en règle générale au mois de juin de l'année en cours ont permis d'observer, depuis plus de vingt ans comment les Français se sont peu à peu familiarisés avec la question climatique.
Les préoccupations pour l'environnement
L’étude met en évidence l’évolution des représentations au fil des années et l’impact des facteurs environnementaux, politiques et médiatiques sur la perception de l’urgence climatique.
Question 1 : je vais vous citer un certain nombre de problèmes d’environnement. Quels sont les deux qui vous semblent les plus préoccupants ?
Les 4 premiers problèmes retenus par les répondants (Figure 2, page suivante) :
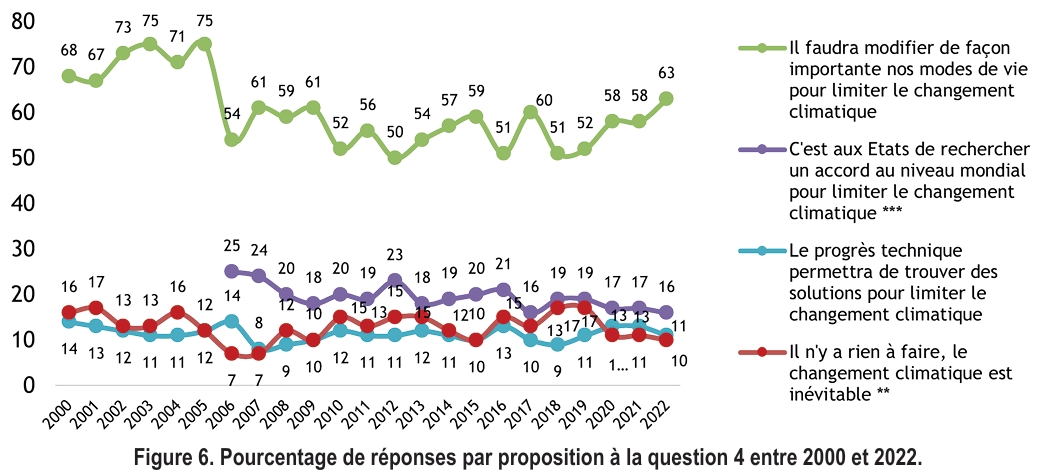
Les 4 derniers problèmes retenus par les répondants :
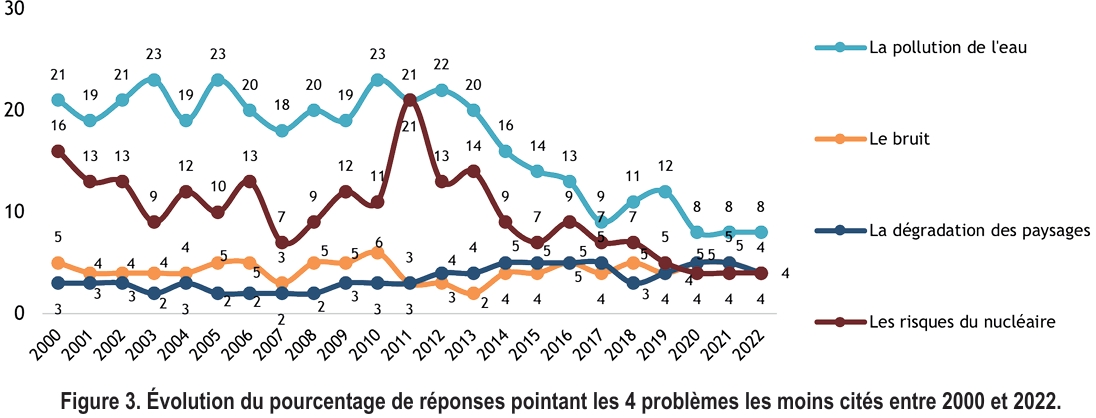
Les courbes des Figures 2 et 3 montrent ainsi comment la question de l'effet de serre ou du réchauffement climatique a peu à peu pris place parmi les problèmes d'environnement les plus préoccupants, mettant au second rang les thèmes historiquement dominants de la pollution de l'eau et de l'air. Mais il faut aussi remarquer que l'enjeu du réchauffement climatique a subi des phases de déclin : c'est le cas, par exemple de la période suivant le sommet des Nations Unies sur le Climat de Copenhague ou COP 15 (2009) qui avait suscité bien des espoirs, mais qui avait déçu par le manque de résultats concrets. Il faut noter aussi que la campagne de dénigrement liée au ClimateGate avait nuit à la crédibilité de ces COP. On note, à l'inverse, des pics de sensibilisation, notamment au moment d’évènements météorologiques extrêmes (canicules), ou politiques ; à la suite du Grenelle de l'environnement (2007-2008) ou encore au cours de l'année de la COP21 qui a eu lieu à Paris (2015). En 2022, la question du réchauffement climatique atteint son niveau maximum : 43 % des répondants se déclarent principalement préoccupés par ce problème.
Les causes du réchauffement climatique
Question 2 : de ces trois opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ?
En vingt ans les perceptions du public quant à l'origine des désordres climatiques ont profondément changé (Figure 4). L'idée selon laquelle ces désordres seraient des « phénomènes naturels » passe de 49 % en 2001 à 17 % lors de la dernière enquête (2022). À l'inverse, la responsabilité humaine à l’origine du réchauffement climatique est aujourd’hui affirmée par deux tiers des répondants (64 %) contre un tiers en 2001 (32 %).
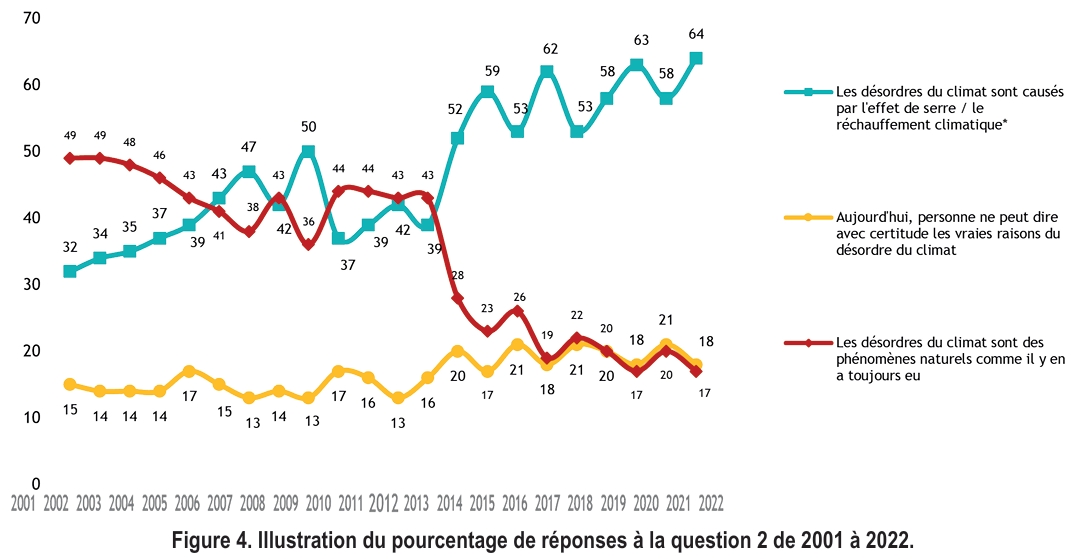
Les conséquences du réchauffement climatique
Question 3 : si le réchauffement / changement climatique continue, à votre avis, quelles seront les conséquences en France d'ici une cinquantaine d'années ?
Les conséquences du réchauffement attendues par le public se partagent entre environ un quart d'optimistes qui affirment « on s'adaptera sans trop de mal » et trois quarts de pessimistes estimant que « les conditions de vie deviendront extrêmement pénibles » (Figure 5). Depuis 2017 la proportion de pessimistes tend à augmenter et atteint son maximum en 2022 (72 %).
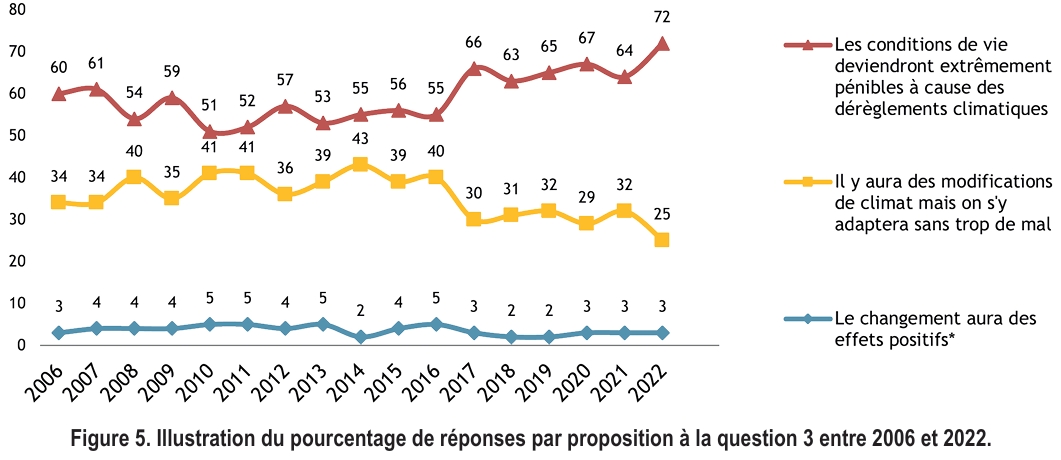
Agir contre le réchauffement climatique
Question 4 : de ces quatre opinions, laquelle se rapproche le plus de la vôtre ?
Face au changement climatique, le public a toujours majoritairement choisi la contrainte d'une modification des modes de vie, alors que la solution technique (« le progrès technique permettra de trouver des solutions ») n'était privilégiée que par 11 % en moyenne des personnes interrogées. Néanmoins l'ajout de la mention « c'est aux États de réglementer… » introduite à partir de 2006 est choisie en moyenne par 20 % des répondants (Figure 6).
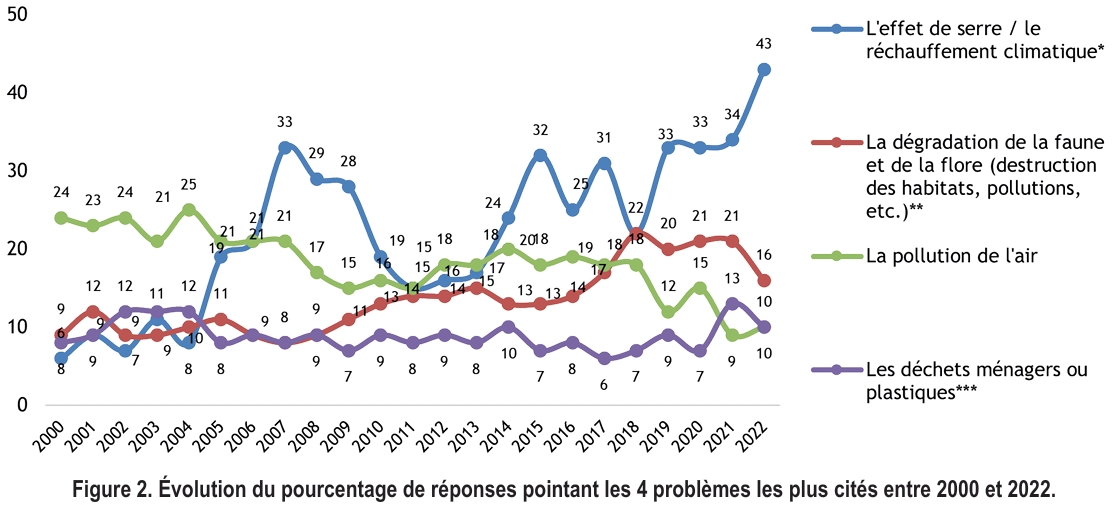
Les représentations de l’urgence climatique et des politiques à mettre en œuvre varient donc dans le temps et dans l’espace, mais également en fonction des caractéristiques socio-démographiques et culturelles (commune de résidence, sexe, genre, âge, profession…) des personnes interrogées.
Dans la section suivante, les chercheurs montrent que l'évaluation de la vulnérabilité d’un territoire n’est pas immédiate et évidente et qu’elle implique de comprendre les mécanismes qui amènent les acteurs publics et privés à se représenter le changement climatique et les risques associés.

-
-
Se représenter le changement climatique au travers du risque
Le rapport du réseau d’Experts Méditerranéens sur le Changement climatique et environnemental, le MedECC, souligne que le bassin méditerranéen et par là, le sud de la France, est un « hot spot du changement climatique » et ainsi, fortement exposé aux évènements climatiques extrêmes. Toutefois, lorsqu’il s’agit de s’accorder sur les territoires vulnérables en région et de porter une action publique locale ambitieuse, d’adaptation et de réduction des risques associés, le bât blesse : quels sont les collectivités à enjeux ? De quels risques parle-t-on ? La représentation des risques climatiques diffère selon que l’on se situe en espace urbain, rural, qu’on les appréhende depuis la Camargue, le littoral azuréen ou encore les Préalpes. Après nous être interrogés sur ce que recouvre la notion de « risque » et la manière dont nous le pensons, nous donnons ici quelques exemples de ce type d’approche lorsqu’il s’agit de faire face à la chaleur excessive en ville à Nice et Marseille, les inondations dans la vallée de la Durance ou encore la submersion du littoral.
-
Le risque, une évidence ?
Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)
Tempêtes, incendies, vagues de submersion, ouragans, avalanches, vagues de chaleur... A la simple évocation de ces aléas liés aux extrêmes climatiques, les risques qu’ils comportent semblent flagrants. Pourtant, certaines certitudes tombent rapidement lorsque l’on analyse de plus près la notion de « risque ».
Dans le champ de l’environnement, un risque est tout d’abord relié à la présence d’un aléa naturel qui correspond à la possibilité qu’un événement naturel survienne. Si les contours de l’aléa naturel sont les fruits de profonds débats de prévisions scientifiques, le risque est quant à lui une construction intellectuelle dont les propriétés sont soumises à des appréciations encore bien plus discutables. Le risque est en effet issu de la conjonction d’un aléa (survenue d’un événement), d’une exposition d’enjeux (humains, économiques, etc.) et d’une vulnérabilité de ces enjeux (présence d’enfants, de personnes âgées, installations fragiles, etc.) (Figure 7).
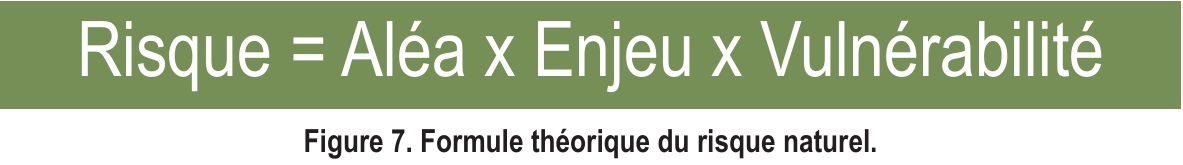
Ainsi, un aléa naturel ne représente pas un risque s’il n’est pas connecté à des enjeux identifiés. Une avalanche en pleine montagne sauvage ne constitue pas un risque tandis que le même aléa au-dessus d’une station de sports d’hiver à son pic maximal de fréquentation en sera bien évidemment un pour les infrastructures, les habitants, les touristes, les activités économiques, etc. (Figure 8).
Or, ces enjeux ne sont que des consensus qui se forment pour définir ce qui mérite d’être considéré comme tel. De façon tautologique, l’enjeu c’est donc ce qui est considéré comme un enjeu ! Certains aléas, pourtant bien identifiés, ne deviennent ainsi des risques qu’uniquement après la survenue de catastrophes : la vague de chaleur de 2003, les inondations par crue du Rhône en 2003, la submersion marine par la tempête Xynthia en 2010, etc.
Le risque est une construction sociale : la perception des risques naturels..., n’est pas si « naturelle » que ça ! Le risque est donc issu d’un consensus relativement malléable et qui, par essence, est amené à se transformer. Ce qui est considéré comme un risque tend alors à évoluer en fonction d’une myriade de facteurs, eux-mêmes en interaction entre eux : idéologies dominantes, sensibilité de l’opinion publique, opportunités politiques, questions économiques, écologiques, sanitaires, etc. Bien malin dans ces conditions qui prétendrait anticiper les risques futurs… Et pourtant, paradoxalement, c’est bien le rôle des chercheurs, des ingénieurs et des responsables de la prévision, de l’anticipation et de la gestion des risques naturels !
Dans le contexte actuel du dérèglement climatique, dont les nombreux impacts sont difficilement prévisibles et modélisables avec un haut degré de certitude, l’identification des risques susceptibles d’en découler devient un enjeu central. On peut donc s’attendre à des évolutions majeures dans les prochaines décennies concernant l’adaptation aux multiples risques liés aux extrêmes climatiques.
L’histoire du territoire, les différents évènements climatiques extrêmes rencontrés par les habitants, leur expérience quotidienne des changements globaux, sont autant de prismes par lesquels le changement climatique est localement perçu.
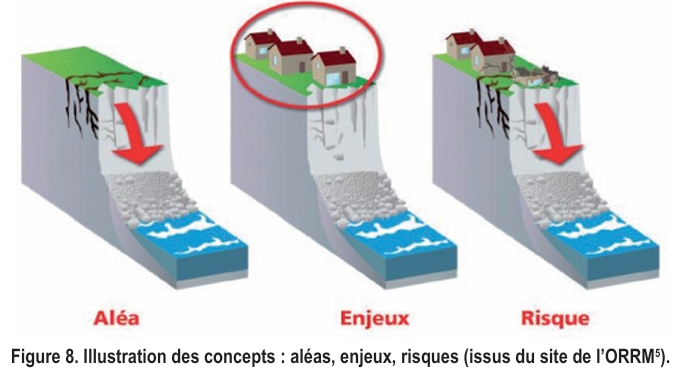
Que nous apprend la « canicule de 2003 » sur le risque ?
Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)
Août 2003 : la France connait une vague de chaleur sans précédent et pourtant le risque qu’elle représente pour la population n’est ni clairement identifié ni pris en charge ni anticipé par les pouvoirs publics. Cette vague de chaleur a principalement affecté une population « invisibilisée » (les personnes âgées), entrainant un manque de réactivité général des pouvoirs publics. Malgré le nombre de publications scientifiques sur l’impact des canicules sur la santé qu’ils avaient déjà à leur disposition, il faudra tout de même attendre plusieurs jours avant que les pouvoirs publics ne prennent pleinement conscience de la mortalité engendrée par la vague de chaleur. Un « plan canicule » verra alors le jour dès 2004 : la perception par les pouvoirs publics du risque lié aux vagues de chaleur est née.
-
Faire face au changement climatique : des processus psychosociaux à l’œuvre
Pierre Dias (MODIS), Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188), Raquel Bertoldo (LPS) & Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE)
Pour illustrer la complexité des processus psychosociaux en jeu quand il s’agit d’appréhender les bouleversements climatiques, prenons pour exemple le cas de la submersion marine qui est déjà une réalité sur le littoral français. Plusieurs enquêtes, menées par entretiens semi-directifs dans des villes littorales concernées (Grau-du-Roi, Port-Saint-Louis-du-Rhône et Fréjus), montrent l’importance des processus psychosociaux dans l’adaptation à ce changement. Cette approche souligne que nos interactions en tant qu’individus avec notre environnement sont fortement influencées par le fait que nous sommes aussi des êtres sociaux.
Ainsi, ces études ont pu montrer :
1. comment la mémoire sociale des aléas climatiques chez les personnes en responsabilité localement influence la conception des actions préventives à adopter. Ainsi, à Port-Saint-Louis, la pluralité et l’impact des submersions passées sont minimisés en mémoire pour rester cohérents avec les savoirs traditionnels toujours actuels et les pratiques futures : « ici, les gens ont l’habitude, ils gèrent ». Au Grau-du-Roi, dont l’identité urbaine est marquée par l’économie touristique et portuaire, les participants interrogés ne se sentent pas préoccupés par la submersion ni aucun évènement passé, certains d’être protégés par des aménagements, et de pouvoir intervenir dans le futur : « on est protégé, la commune n’a pas une forte culture des risques liés à la mer ».
2. comment les habitants intègrent la vulnérabilité de leur territoire au changement climatique et façonnent des stratégies d’atténuation pour y faire face. À Port-Saint-Louis, et à Fréjus, des habitants emploient plusieurs stratégies argumentatives pour rationaliser le risque et atténuer le sentiment de vulnérabilité : la comparaison sociale « Ici nous sommes moins exposés que les habitants de la côte atlantique », la comparaison entre les risques « Il y a ici d’autres risques, plus immédiats, plus importants » et le fatalisme « De toutes façons, on ne pourra rien faire contre l’élévation de la mer ». Ces résultats confirment le paradoxe constaté dans d’autres études : les individus sont attachés à leur littoral, malgré leur connaissance des dangers auxquels ils sont exposés.
3. comment s’élabore la confiance accordée aux politiques publiques d’adaptation au changement climatique. En effet, le type de confiance accordée aux acteurs de la gestion varie avec le sentiment de posséder peu ou beaucoup de connaissances sur les vulnérabilités du territoire. Lorsque les individus ont le sentiment de posséder peu de connaissances, ils développent une confiance basée sur une évaluation positive des intentions des gestionnaires, et déclarent mettre en place les comportements de protection contre les inondations. Lorsqu’ils ont le sentiment de posséder de nombreuses connaissances sur ce sujet, ils développent une confiance basée sur les aspects techniques de la gestion, et déclarent ne pas forcément suivre les recommandations s’ils ne les jugent pas pertinentes.
En conclusion, le comportement des habitants face au changement de leur territoire dépend non seulement des connaissances que les acteurs publics cherchent à enrichir par la mise en place de communications, mais également des mécanismes psychosociaux. Ces résultats doivent interpeller les institutions et acteurs en responsabilité de la gestion des risques afin de prendre en compte ces types de stratégies, et de mettre en œuvre des actions pour les faire évoluer. Des ateliers basés sur des scénarii d’évènements climatiques locaux, où les savoirs vernaculaires prendraient leur place, pourraient rendre plus concrète la représentation d’un risque pour lequel il n’y a pas de mémoire collective.
La mémoire des risques naturels. Analyse des données statistiques issues de l’enquête sur la perception des risques majeurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Coline Mias (AIR Climat)
L’enquête de perception de l’Observatoire Régional des Risques Majeurs (ORRM) en Provence-Alpes-Côte d’Azur, menée entre 2017 et 2018, souligne qu’il existe une mémoire des risques naturels ou technologiques survenus sur le territoire. Sur 656 répondants, 388 personnes affirment avoir connaissance d’un ou plusieurs évènements majeurs : le séisme de Lambesc du 11 juin 1909 est cité par 63 sondés, les inondations de Vaison-la-Romaine (cité 46 fois), les feux de forêt de l’été 2016 dans les Bouches-du-Rhône, les inondations dans les Alpes-Maritimes du 3 octobre 2015 et les inondations du bassin versant de la Nartuby le 15 juin 2010 (cités plus de 30 fois toutes les deux). La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur est considérée par 276 personnes de l’échantillon comme plus exposée aux risques majeurs que les autres régions métropolitaines. Les raisons invoquées sont les activités industrielles (88), les risques naturels majeurs (67), les risques technologiques majeurs (53), le risque sismique (44). On évoquait alors beaucoup moins des risques associés à la façade littorale urbanisée (17), le risque de submersion marine (1) ou le changement climatique (seulement 1 répondant).
-
Perception des risques induits par le changement climatique dans deux grandes villes : Marseille et Nice
Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE), Ruchi Mudaliar (ESPACE), Parul Rishi (IIFM) & Samuel Robert (ESPACE)
Le changement climatique s’exprime de différentes manières sur les territoires. En contexte littoral, les risques liés à la mer, et en contexte urbain les canicules en sont les manifestations les plus évidentes. Comment les habitants des grandes villes littorales françaises telles que Marseille ou Nice en prennent-ils conscience ? Quels facteurs interviennent dans leur perception du changement climatique et l’adoption d’éventuels comportements visant à l’atténuer ou à s’adapter à ses conséquences ? C’est la question étudiée par un collectif franco-indien de chercheurs, à Marseille et Nice, dans une enquête menée en juillet 2015.
475 habitants de Marseille et de Nice, vivant ou travaillant près du trait de côte, ont répondu à un questionnaire sur leur perception du changement climatique. La Figure 9 montre les phénomènes climatiques rapportés par les participants. Dans les deux villes, la canicule occupe la première place, même si elle est significativement plus citée à Marseille qu’à Nice. En revanche, tous les phénomènes liés à la mer et à l’eau (inondations, tempêtes, dégradation des aménagements côtiers et montée du niveau de la mer) sont de manière significative plus souvent évoqués à Nice qu’à Marseille. En termes de dimensions cognitives et émotionnelles de la perception du changement climatique, les résultats montrent que dans les deux villes, les participants sont tout à fait conscients du changement climatique, mais ne s’en inquiètent pas beaucoup. Ce paradoxe n’est pas propre à notre enquête, il a été aussi observé dans d’autres études sur la côte atlantique.
La dimension qui prédit le plus l’intention d’endosser des comportements d’atténuation ou d’adaptation est le stress ressenti face au changement climatique, que ce soit à Nice ou à Marseille. A Marseille se rajoutent la confiance dans les institutions et un faible sentiment de bien-être côtier comme facteurs favorisant les intentions de ces comportement, ce qui n’est pas le cas à Nice. Dans les deux villes, la connaissance du changement climatique n’a pas d’effet sur l’intention d’adopter des comportements d’atténuation ou d’adaptation.
Ce dernier résultat pose la question de l’importance de la communication du savoir et des connaissances. Certes, « connaitre » est une condition pour prendre conscience. Mais cela n’est pas suffisant. Il est aussi nécessaire de prendre en compte les émotions ou préoccupations des habitants dans la communication et les échanges autour du changement climatique. Les représentants des autorités locales sont conscients de cette dimension émotionnelle de l’adaptation au changement climatique, et demandent qu’elle soit davantage prise en considération. Ils souhaitent aussi être épaulés pour une plus grande implication de la population dans la construction collective des politiques locales d’adaptation. D’autres chercheurs soulignent ainsi la coopération nécessaire à plusieurs niveaux entre acteurs, habitants, chercheurs, artistes, associations,… pour faire avancer la réflexion et l’action à ce sujet.
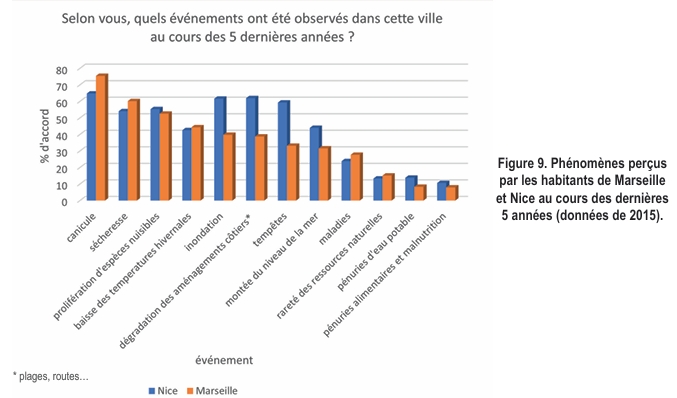
-
Vivre les fournaises urbaines. Les représentations et affects urbains à l’épreuve du changement climatique
Fabian Lévêque (TRIANGLE) & Guillaume Faburel (CNRS, TRIANGLE)
Alors qu’elles ne représentent que 2% de la surface terrestre, mais 56% de la population mondiale selon la Banque Mondiale, les villes sont responsables de 60% des émissions de gaz à effet de serre et consomment 78% de l’énergie mondiale. Villes et métropoles se sont imposées comme les lieux privilégiés de concentration des populations. La « menace » climatique et les bouleversements écologiques associés sont d’ores et déjà perçus de manière aigue, et au quotidien, par les citadins.

L’enquête « Vivre les fournaises urbaines », réalisée à l’été 2019, renseigne de tels vécus par entretiens longs auprès de 130 habitant.es de trois métropoles (Marseille, Montpellier, Toulouse) et deux villes moyennes (Narbonne, Nîmes) du sud de la France. Il en ressort que les expériences du changement climatique sont très prégnantes dans les milieux les plus densément urbanisés. Pour 70% des répondant.es, le changement climatique fait l’objet d’observations situées (sécheresses des terres agricoles en périphérie des villes, canicules urbaines…). 56% affirment qu’il a déjà des effets concrets sur leurs manières de vivre, en particulier l’été : les rythmes de vie ralentissent pour tenter de reposer les corps, souvent en souffrance. Des inquiétudes prédominent à l’égard de personnes fragiles et vulnérables.
Les canicules urbaines sont décrites comme de véritables « épreuves » autant physiques que psychologiques : des sensations de suffocation et d’asphyxie structurent les discours. La surdensification des centres et l’artificialisation périphérique, l’hyperconcentration des activités et la bétonisation des espaces de respiration laissent à penser que les pouvoirs publics sont incapables de réguler les intérêts économiques en prenant en considération les enjeux écologiques. Les projets visant à la gentrification et à la mise en tourisme des villes au détriment du mieux vivre des habitant.es ont été décriés (Figure 10).
Le sort des grandes villes inquiète : un tiers envisage déjà de quitter les centres urbains si les conditions d’habitabilité continuaient à se dégrader. Les arrière-pays, espaces périphériques et campagnes sont les échappatoires privilégiées. Un défi de taille se pose alors pour ces villes qui, tout en affichant des stratégies d’adaptation et de résilience face aux changements climatiques, ne continuent pas moins à se vouloir attractives et compétitrices.
Une enquête entre sphères universitaire et associative
Pour venir appuyer les nombreuses mobilisations qui se sont développées, en 2019, pour la justice sociale et écologique, le collectif Notre Affaire à Tous a créé un consortium entre les sphères universitaire et associative. L’enquête « Vivre les fournaises urbaines » est l’aboutissement de cette action conjointe entre Notre Affaire à Tous, l’Université Lyon 2 et l’Unité Mixte de Recherche Triangle pour penser de nouveaux milieux et territoires de vie plus écologiques.
-
Développer une culture du risque inondation : retours d’expérience en basse vallée de la Durance
Johnny Douvinet (ESPACE), Eric Duverger (SMAVD) & Guillaume Hamon-Marie (ESPACE)
Le changement climatique est à l’origine d’une modification de la fréquence et de l’intensité des événements extrêmes, tels que les sécheresses, engendrant de nombreux impacts sur les milieux naturels et sur les sociétés. Le risque lié aux inondations fait lui aussi partie des événements craints, même si les prévisions sont moins précises et plus incertaines. Pour autant, le dérèglement climatique impose de se préparer à l’impensé, à l'impensable, voire à l'imprévisible. Dès lors, comment développer une culture du risque dans un tel contexte, et comment se préparer à la survenance d’une catastrophe ?
Afin de répondre à cette question, une étude a été menée par des chercheurs de l’université d’Avignon et le Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la Durance (SMAVD) en 2020, dans des quartiers situés en zone inondable. Concessionnaire de la gestion du Domaine Public Fluvial de la Basse-Durance depuis 1982, le SMAVD contribue à l’aménagement et à la gestion du lit de la Durance. Dans le domaine des inondations, le SMAVD anime en particulier un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) aux objectifs étendus (surveillance et prévision des crues et des inondations, ralentissement des écoulements, protection des personnes et des biens, etc.). Le syndicat réalise également des actions pour renforcer la connaissance et la culture du risque. Pour accompagner le développement et l’enracinement, auprès des populations du territoire, d’une « culture du risque » adaptée à l’identité du bassin versant de la vallée de la basse Durance, un état des lieux sur la perception et sur l’intégration de cette culture a été mené au cours de l’année 2020. Cette « culture du risque » a été définie comme résultant d’un partage de connaissances (sur les risques, les consignes de mise en sécurité, les outils d’alerte existants) entre l’ensemble des acteurs d’un territoire (élus, associations, citoyens). L’acceptabilité et la crédibilité du risque sont ainsi des composantes majeures d’une telle « culture ».
Des enquêtes ont été conduites dans 8 communes (Figure 11), pour récolter les avis de 200 personnes résidant en zone inondable (telle que reconnue dans le Plan de Prévention du Risque Inondation). Les réponses (25 répondants par commune) ont été collectées lors d’entretiens semi-directifs qui ont duré de 20 minutes à 1h. Les résultats ont permis de voir que, sur le volet « Connaissance des éléments structurants du risque inondation », les 200 participants déclarent connaître la Durance (96%) ou la notion de débit (81%), mais seules 5% sont capables d’expliquer ce qu’est un bassin versant, et 11% une crue centennale. Sur le volet « Connaissance et rôle des aménagements de la Durance », 90% déclarent connaître un ouvrage hydraulique (dont 52% citent le barrage de Serre-Ponçon) et 78% affirment que ces ouvrages ont une influence sur les inondations (la moitié des répondants affirme que ces aménagements aggravent le risque et pour l’autre moitié, que ces ouvrages l’atténuent). Sur deux communes (Noves et Mérindol), le nombre de répondants ne connaissant pas ces aménagements était plus élevé, ce qui a amené le SMAVD à relancer des actions de sensibilisation.
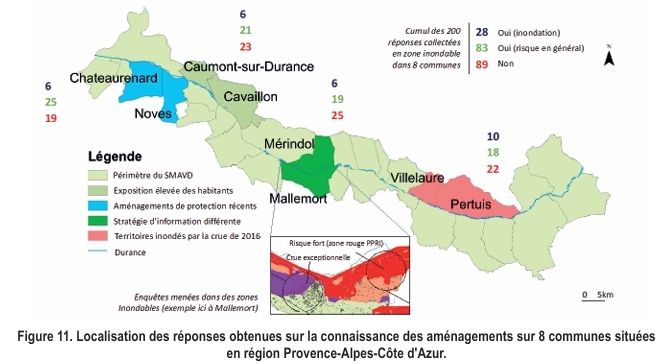
Sur le volet « Rapport aux informations sur le risque inondation », 62% des personnes interrogées citent la mairie comme le vecteur le plus pertinent pour assurer la diffusion de l’information sur le risque inondation. Cependant 44% des interrogés ne ressentent pas le besoin de s’informer sur les inondations et sur les risques naturels en général, 47% assument ne pas vouloir chercher ces informations, 74% déclarent ignorer le PPRI, et 60% déclarent n’avoir jamais été officiellement informés de l’existence de ce risque. Sur le volet « Comportements face aux inondations », 86% des personnes interrogées déclarent connaître les pratiques à adopter en cas d’événement, 43% prendraient le temps de certifier une demande d’évacuation en cas de besoin, 22% indiquent qu’elles quitteraient leur logement sans tarder ; 68% indiquent toutefois qu’elles n’ont pris aucune mesure pour faire face aux inondations qui pourraient se produire au niveau de leur habitation.
Au final, cette étude, qui vient compléter les autres études menées sur la perception du risque inondation, confirme plusieurs éléments. Tout d’abord, malgré les efforts opérés en matière d’information, les résidents vivant en zone inondable en basse vallée de la Durance ne vont pas chercher l’information sur le risque, même quand ils y sont exposés quotidiennement. Par ailleurs, si les injonctions réglementaires sont nécessaires, elles ne sont guère suffisantes pour transmettre une culture du risque partagée entre tous les acteurs au sein des territoires. Les règles relatives à l’Information des Acquéreurs et des Locataires imposées aux notaires depuis 2006, ou l’obligation faite aux mairies, depuis 1987, d’élaborer un Document d’information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) nécessitent des mesures complémentaires. En effet, en cas d’alerte, les individus estiment connaître les pratiques à mettre en œuvre, mais pour autant, ils ne sont pas prêts à quitter leur logement sans vérifier la source de l’alerte, et n’ont pas imaginé des solutions de repli ou de protection pour faire face à une inondation le jour venu.
Pour le SMAVD, il a donc été nécessaire d’accroître les efforts en termes de communication et de sensibilisation, ce qui s’est traduit par l’organisation de manifestations « grand public » (ex. : « Un Dimanche en Durance »), des aménagements touristiques (« Un vélo-route en Durance »), des communications adaptées via les réseaux sociaux, et des rétrospectives sur des inondations passées marquantes (1886, 1994).
-
La perception des risques côtiers (érosion, submersion, inondation) par les acteurs publics locaux
Samuel Robert (ESPACE), Axel Quercy (ESPACE) & Alexandra Schleyer-Lindenmann (ESPACE)
Sur le littoral, le changement climatique se manifeste spécifiquement par une augmentation des risques côtiers liés à trois types d’aléas : l’érosion et le recul du trait de côte ; le débordement des cours d’eau et les inondations côtières rapides, consécutives aux épisodes méditerranéens ; les vagues de submersion et l’élévation progressive du niveau de la mer. Ces aléas fragilisent les territoires côtiers, dont la vulnérabilité est accentuée par les aménagements du rivage et des espaces proches : urbanisation, infrastructures portuaires, terre-pleins gagnés sur la mer, digues de protection, enrochements, etc. La perception de ces phénomènes et des risques qu’ils induisent conditionne fortement l’émergence de mesures d’adaptation au changement climatique. La caractérisation de ces perceptions, en particulier celles des acteurs en responsabilité, constitue donc un préalable à toute politique ou stratégie en ce sens.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, une étude menée en 2021 par des chercheur.es des universités de Nice et d’Aix-Marseille a récemment permis de rendre compte de la perception des risques côtiers et de la représentation du littoral d’acteurs en responsabilité au niveau municipal. Elle révèle que les aléas et risques côtiers ne sont pas tous perçus avec la même acuité et que le littoral de la région n’est pas véritablement pensé comme devant s’engager dans une stratégie d’adaptation.
Parmi les 100 mots les plus utilisés dans les entretiens, les trois premiers sont « plage », « littoral » et « commune », (plus de 600 occurrences chacun). Les termes « risques » et « érosion » n’apparaissent respectivement que 121 et 120 fois. Aussi, la structuration du discours d’ensemble s’organise autour du mot « plage », ce qui signifie que le littoral de la région est principalement perçu par cette forme d’interface côtière (Figure 12).
Dans ce contexte, les risques occupent une place relativement secondaire, « érosion » étant davantage citée que « inondation » (92 occurrences) ou « submersion » (71 occurrences).
Perçue comme un risque familier, présent « au quotidien », peu ou prou prévisible, l’érosion est évoquée à propos des plages. Elle est pensée comme gérable techniquement et est d’autant plus combattue qu’elle fragilise l’économie balnéaire.
Le risque d’inondation est au contraire évoqué avec des termes plus dramatiques. Dépeint comme mettant en les risques péril des biens matériels et des vies humaines, il est relaté par de nombreuses expériences personnelles. Redouté, il semble plus subi que géré. Il est également perçu comme plus fréquent et plus intense ces dernières années.La submersion marine est quant à elle moins fréquemment évoquée et moins familière. Il n’y a pas de récit détaillé, ni d’expérience relatée de ce phénomène. Lorsqu’elle est mentionnée, la submersion est le plus souvent associée à des termes la localisant dans un futur lointain, tout en étant pressentie comme particulièrement problématique à l’avenir. Toutefois la prise en compte de l’élévation de la mer et ses conséquences en termes d’adaptation sur le plus long terme est difficilement pensée par les personnes en responsabilité.
Au final, les risques côtiers sont inégalement perçus par les responsables municipaux, et la vulnérabilité globale du territoire aux risques induits par le changement climatique n’apparaît pas comme un sujet critique. Toutefois, lorsque la vulnérabilité est plus particulièrement abordée, les rapports entre institutions pour la gestion des risques sont questionnés. Des divergences de méthode et de vue sont mentionnées, en particulier entre l’État et les collectivités. Ce constat interpelle car la connaissance, la prévention et la gestion des risques est une problématique dont on peut penser qu’elle ne peut que pâtir d’un manque de coordination des pouvoirs publics.
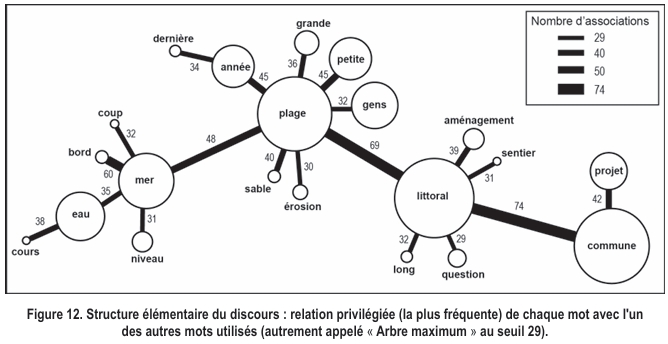
Le terme « submersions marines » en question
Séverin Guignard (Laboratoire de Psychologie, UR 3188)
On peut questionner la dénomination du risque dit de « submersion marine », dénommé coastal floods en anglais soit « inondations côtières » pour une traduction littérale. Bien qu’il s’agisse stricto sensu de synonymes, nous avons demandé à des habitants de villes côtières de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur quels étaient les 4 mots qui leurs venaient spontanément à l’esprit lorsqu’ils entendaient soit « submersion marine » (pour le groupe 1), soit « inondation côtière » (pour le groupe 2).
Les participants du groupe 2 évoquent davantage de mots liés au risque et ses conséquences (noyade, mort, danger) et perçoivent davantage le risque d’un événement d’inondation côtière que les participants du groupe 1 concernant un événement de submersion marine. Autrement dit, les mots utilisés pour nommer le risque agissent sur sa représentation par les populations et, in fine, sur le rapport au risque de celles-ci.
Face aux nouveaux risques émergents liés aux extrêmes climatiques (risques en devenir, aux contours et effets difficilement formalisables aujourd’hui), la posture visant à requestionner les évidences dans notre rapport aux risques (depuis la constitution même du risque jusqu’à sa dénomination) permettra une co-construction et un meilleur dialogue entre décideurs publics et citoyens concernant les réponses à y apporter.

-
-
L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques
Par-delà la gestion des risques, les changements climatiques et environnementaux impliquent nécessairement des ajustements, des recompositions, des bifurcations des activités et modèles économiques qui prévalent depuis des décennies. C’est par ce prisme que nous abordons la prochaine section ; les sciences humaines et sociales apportent ici des éclairages précieux pour comprendre des dynamiques existantes et avec lesquelles il nous faut composer.
Face aux différents scénarios et projections climatiques, il n’est pas facile pour les professionnels de s’adapter à leurs futures conditions d’exercice - d’autant que celles-ci sont entourées d’incertitudes. De nombreuses expériences menées en région Provence-Alpes-Côte d’Azur montrent toutefois que des leviers d’action existent et que l’atténuation et l’adaptation doivent faire partie d’un nouveau paradigme. Des enquêtes présentées ici ont cherché à comprendre de telles situations rencontrées par les professionnels du ski, de la forêt, de la viticulture ou de la gestion du littoral. Par contrainte ou par conviction, nombre d’acteurs socio-économiques imaginent des alternatives pour adapter leur profession à des épisodes de sècheresse, de raréfaction de la neige en montagne, à la fonte des glaciers…. Nous abordons ici les facteurs qui les ont poussés à faire cette transition et à modifier leurs pratiques professionnelles.
-
L’adaptation des stations de ski aux changements climatiques. Du déni marchand à l’alternative éthique ? Une comparaison entre Alpes du Nord et Alpes du Sud
Anouk Bonnemains (UNIL) & Cécilia Claeys (CRESEM)
Les territoires de montagne sont précocement éprouvés par les effets des changements climatiques. Les irrégularités croissantes de l’enneigement des stations de sports d’hiver en sont les premiers signes impactant visiblement l’économie locale. Plus hautes en latitude et en altitude, les stations des Alpes du Nord sont parmi les plus grandes du monde. Plus basses en latitude et en altitude, mais aussi plus petites, les stations des Alpes du Sud seront plus rapidement exposées aux effets du changement climatique. La plus grande vulnérabilité climatique et économique des stations de sports d’hiver du sud alpin pourrait-elle favoriser une plus rapide adhésion des acteurs du territoire aux principes de la transition écologique, par opposition aux stations de sports d’hiver du nord alpin davantage captives du modèle économique de l’« or blanc » ?
Au nord comme au sud, les décideurs politiques et économiques adoptent, en premier lieu, un même réflexe moderniste qui associe croissance économique et développement technologique. Ces aménagements d’altitude (remontées mécaniques, immobilier de loisir, etc.) renforcent ce modèle connu et rassurant de l’or blanc rendant difficile de penser des alternatives. Néanmoins, des signaux plus visibles apparaissent dans le sud alpin où le déni marchand, basé sur un argumentaire d’impossibilité de reconversion économique, cède, çà et là, la place à d’autres « pistes », potentiellement plus éthiques d’un point de vue environnemental et social. Des initiatives portées par des acteurs locaux voient en effet le jour. Ainsi, la mise en réseau des acteurs territoriaux au sein de l’association des Gîtes et refuges du Queyras (lui-même une vallée et un parc national régional des Hautes Alpes) témoigne de la manière dont le manque de neige peut entrainer la création d’innovations sociales et d’alternatives éthiques. A Céüse, les pratiquant.es, tout particulièrement locaux, mettent en œuvre spontanément des formes d’alternative au tout ski, rappelant que la transition peut aussi être impulsée par l’évolution de la demande (cf. Zoom 6). D’autres stations des Alpes du Sud, davantage inscrites dans le modèle de l’or blanc, peinent en revanche à s’affranchir du tout ski. C’est le cas du domaine du Dévoluy, où un projet de tourisme scientifique contribuant à la redynamisation du village en fond de vallée est devenu - à la faveur d’une alternance municipale - un projet d’extension du réseau de remontées mécaniques sur le domaine skiable.
Ainsi, l’économie de l’or blanc, basée sur des logiques de rente et de concentration du capital, exerce un lobby très fort au niveau local comme national. Les alternatives se développent principalement sur des territoires tout à la fois vulnérables aux changements climatiques et plus en retrait du modèle dominant. Le défi pour l’implantation de ces pratiques alternatives demeure la construction d’un modèle économique respectueux de l’environnement et des populations locales.

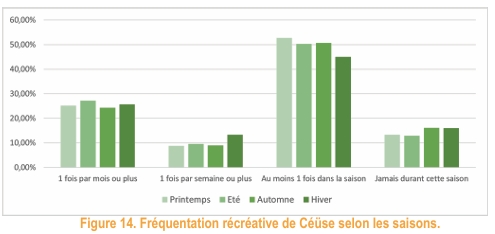
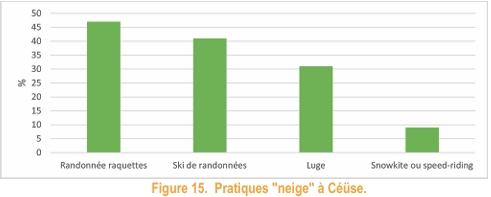
La station de Céüse : une transition par les pratiquants ?
Anouk Bonnemains (UNIL) & Cécilia Claeys (CRESEM)
En 2019-2020, une enquête réalisée par les étudiant.es du Master Gestion durables des territoires de montagne (GDTM) du Pôle Universitaire de Gap auprès de 877 usagers du site révèle que la fréquentation du massif est d’ores et déjà « quatre saisons » (Figure 14).
Malgré - sinon grâce à - la fermeture des remontées mécaniques en périodes d’enneigement, le domaine skiable est investi par des activités de raquettes, ski de randonnée, luge et snowkite ou speed-riding (Figure 15).
Parmi les enquêtés, le recours à la neige de culture est peu considéré comme une stratégie pertinente pour l’adaptation de Céüse au changement climatique. Le développement de nouvelles offres touristiques, y compris affranchies des remontées mécaniques, tend à faire consensus. En revanche le démontage des remontées mécaniques fait davantage débat (Figure 16).
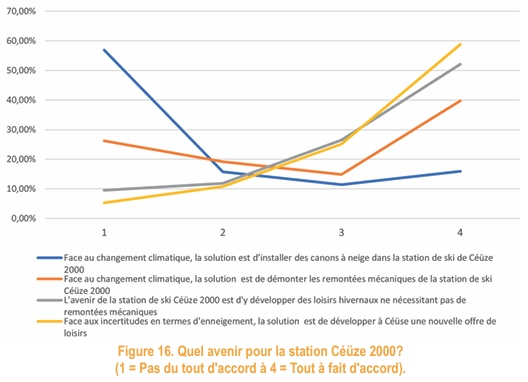
-
Une bifurcation touristique pour une transition socio-environnementale des Alpes du Sud
Mikaël Chambru (GRESEC) & Cécilia Claeys (CRESEM)
L’adaptation au changement climatique du tourisme de montagne donne lieu à une grande diversité de stratégies allant de la solution confortant le modèle du « tout ski », à celle s’affranchissant de la dépendance à la neige. Le Queyras se caractérise par une cohabitation paradoxale entre ces deux types de trajectoires. Les collectivités départementales et régionales continuent d’y subventionner les infrastructures des stations de ski, tandis que certaines municipalités s’engagent dans une bifurcation touristique. Elles optent pour un régime d’habitabilité visant à réduire les vulnérabilités socio-environnementales du territoire, aggravées par le changement climatique mais aussi par les effets pervers d’une économie touristique devenue omniprésente.
Des enquêtes sociologiques réalisées dans le Queyras par des chercheur.es de l’Université Grenoble Alpes et d’Aix-Marseille (2018-2024) ont montré l’existence d’une culture du risque chez les habitants vivant au quotidien avec les aléas environnementaux tranchant avec leur inquiétude face à la vulnérabilité économique du modèle ski-centré. Les glissements de terrain, éboulements et avalanches sont considérés comme inhérents à la vie de montagnard, tandis que les spéculations immobilières, la désertification des services publics et des commerces de proximité sont dénoncés par les habitants interrogés comme les résultantes d’un régime d’attractivité touristique empêchant de vivre et de travailler à l’année dans ces hautes vallées alpines. À ce titre, l’enjeu prioritaire pour les municipalités porteuses de projets d’habitabilité est la résolution des problèmes sociaux : accès à des logements locatifs à l’année, sauvegarde des classes d’école menacées de fermeture, création de tiers-lieux pour des activités économiques et culturelles, etc. Ce faisant, le tourisme tendra à redevenir la résultante d’un territoire habité plutôt qu’une fin en soi du développement en montagne . Ces initiatives appellent désormais un plan d'adaptation structurel des territoires de montagne pour faire face aux effets des changements climatiques dans les années et décennies à venir.
-
Les déterminants de l'adaptation des pratiques de la gestion forestière au changement climatique
Annabelle Amm (INRAE, URFM) & Julie Thomas (Centre national de la propriété forestière - Institut pour le développement forestier, CNPF-IDF)
L’ampleur du changement climatique est telle que des mesures d’adaptation des forêts sont nécessaires pour maintenir le couvert forestier à long terme. Des programmes nationaux en font mention, à l’instar du deuxième plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC-2 : 2018-2022) qui promeut une gestion forestière tenant compte de l’évolution du climat. Toutefois, l’adaptation des forêts pose de nombreuses questions relatives aux acteurs et aux modalités concrètes de sa mise en œuvre en particulier pour les forêts privées qui constituent les trois-quarts des forêts nationales (un peu moins de la moitié en région Sud). Un projet de recherche mené entre 2016 et 2019 questionne et analyse les stratégies d’adaptation des propriétaires forestiers privés français face au changement climatique, les déterminants de leurs choix, ainsi que les freins rencontrés et les incitations au changement.
Des analyses statistiques réalisées en 2021 ont permis de déterminer les variables qui influencent la mise en œuvre de stratégies d’adaptation. Deux classes de variables ont été étudiées, des variables « objectives » et des variables « subjectives ».
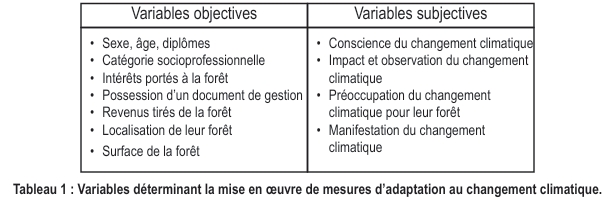
Perceptions des changements climatiques et transformation des pratiques
Dans l’ensemble, les propriétaires forestiers enquêtés portent de multiples intérêts pour leur forêt (parmi eux, la notion de préservation de la biodiversité, l’attachement à la mise en valeur de leur patrimoine, la production de bois, etc.).
Selon l’étude, 73% des propriétaires sont conscients du changement climatique et la plupart d'entre eux pense qu'il est induit par l'homme. Toutefois, si la plupart des répondants sont persuadés que le changement climatique aura un impact sur les forêts (augmentation de la fréquence et de l’intensité des sécheresses et des tempêtes…), ils se préoccupent peu de l'impact du changement climatique sur leur propre forêt et/ou pensent pouvoir attendre avant de s’adapter (70,1%, Figure 17). Seuls 16,1 % des répondants affirment avoir déjà changé leurs pratiques depuis 5 ans ou plus. Dans ce cas, trois stratégies d’adaptation sont essentiellement envisagées : récolter plus tôt, réaliser des éclaircies et s’orienter vers des peuplements irréguliers.
Les facteurs de déclenchement, pour s’adapter et réduire les dommages dus au changement climatique, tiennent à la mise à disposition d’une information spécialisée dans le secteur forestier et au fait d’avoir reçu des conseils de professionnels. Ainsi, les répondants portent un intérêt particulier à la formation spécialisée sur le changement climatique et ses réglementations. En revanche, ceux qui ne souhaitent pas s’adapter évoquent comme frein le fait qu’ils pensent encore pouvoir attendre, que l’information sur le changement climatique est contradictoire ou absente, qu’ils ont un manque de moyens financiers, d’autres priorités pour leurs forêts ou encore que la règlementation limite les moyens d’action (Figure 17).
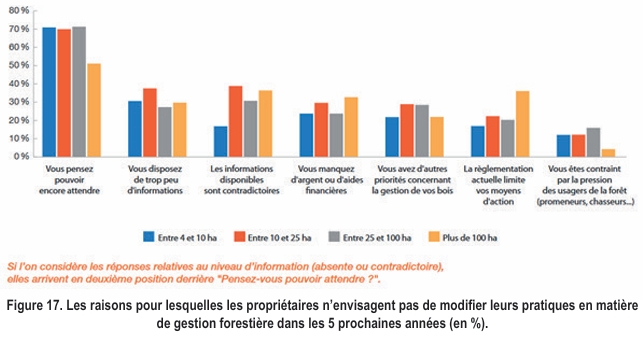
Par ailleurs, les propriétaires qui n’envisagent pas de changer de pratiques portent des intérêts différenciés aux incitations proposées lors de l’enquête (Figure 18). Environ 50% de ces propriétaires ne sont pas intéressés par un bilan climatique ou sanitaire, ni par une expérimentation, une assurance ou encore par des aides. Cela peut signifier que les propositions n’étaient pas assez variées ou que ces propriétaires ne s’identifient pas aux politiques promues par la filière forêt-bois.
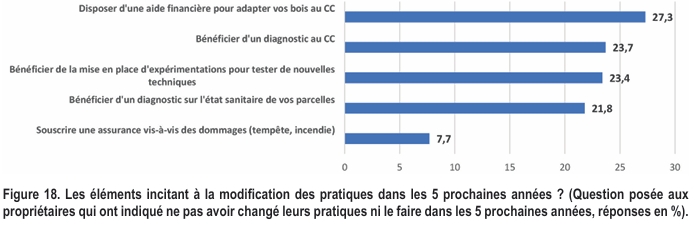
Les déterminants des stratégies d’adaptation
Les résultats de l’enquête montrent que la mise en œuvre des trois stratégies d’adaptation citées (récolter plus tôt, réaliser des éclaircies et s’orienter vers des peuplements irréguliers) est déterminée par des variables à la fois subjectives et objectives (Tableau 1). Certains déterminants sont significatifs pour la mise en œuvre de ces stratégies d’adaptation (Tableau 2). À titre d’exemple, l’appartenance à la catégorie socio-professionnelle (CSP) artisans, commerçants, chefs d’entreprise et professions intermédiaires encourage les propriétaires forestiers privés à récolter plus tôt. Inversement, l’appartenance à la catégorie socio-professionnelle employés influence négativement la pratique des éclaircies.
D’autre part, la décision de mettre en place des peuplements irréguliers ou de récolter plus tôt est souvent liée à la possession de documents de gestion forestière. Il semble que les propriétaires qui ont pu fournir un document pour certifier leur gestion forestière sont plus enclins à adopter ces stratégies d’adaptation. Les documents de gestion forestière représentent donc un vecteur pertinent pour une potentielle politique publique dédiée à la mise en œuvre d’une stratégie d’adaptation.
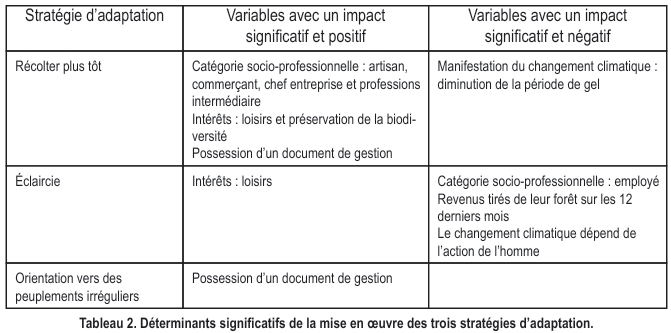
Le fait de savoir que le climat change n'est pas suffisant pour initier un processus d'adaptation de la part des propriétaires. Pour prendre la décision de s’adapter, ils doivent être convaincus que les impacts du changement climatique sont et seront réels (qu'ils possèdent de grandes surfaces forestières ou de petites). Ce résultat confirme les preuves basées sur des statistiques descriptives qui montrent que les propriétaires ont besoin d'informations spécialisées dans le secteur forestier, ainsi que de formation sur le changement climatique et ses réglementations. Les stratégies d’adaptation mises en place par les propriétaires interrogés sont multiples et dépendent des caractéristiques sociales et professionnelles des propriétaires, mais également des usages de leur forêt et de leurs représentations du changement climatique. Cela signifie que parler d'adaptation en général présente peu d’intérêt et que les populations spécifiques doivent être identifiées et ciblées par les politiques publiques dans le but d'encourager des pratiques d'adaptation cohérentes avec le territoire.
-
Penser l’adaptation de la viticulture au changement climatique : s’intéresser aux savoirs territorialisés
Corentin Thermes (CITERES)
Les adaptations de la viticulture au changement climatique en France donnent à voir les mobilisations de savoirs différents qu’ils relèvent plutôt de la sphère technico-scientifique (centres de recherche et d’expérimentation, modélisations climatiques etc.), ou de la sphère pratique (expérimentations par les vignerons, pratiques traditionnelles etc.).
À l’heure où le changement climatique frappe le vignoble français de manière concrète et régulière (gel de printemps, sécheresse) ces différents savoirs mobilisés pour prendre des chemins d’adaptation sont au cœur des réflexions des acteurs de la filière et des vignerons. Apparaissent alors des « savoirs territorialisés », correspondant à un ensemble de savoirs issus à la fois du transfert de savoirs technico-scientifiques sur un territoire et de savoirs pratiques expérimentés localement (avec une notion historique ou non).
L’étude de ces savoirs territorialisés permet d’analyser le processus de territorialisation de l’adaptation, adapté à chaque contexte. Les vignerons, collectivement ou individuellement, se saisissent de productions scientifiques, expérimentent par eux-mêmes, s’appuient sur des savoirs « traditionnels » pour construire leurs réponses au changement climatique. Par exemple, on peut citer les choix de localisation de parcellaire viticole, la réflexion sur les encépagements etc. Ce processus conduit un certain nombre de vignerons à expérimenter souvent en dehors du périmètre d’AOC, en IGP ou en Vin de France, pour s’affranchir de certaines règles et pourvoir mêler plus librement les différents types de savoirs, fabricant ainsi des savoirs territorialisés qui en fin de compte profiteront au système d’appellation.
Avec la notion de territorialisation de l’adaptation, on se questionne sur l’existence ou non d’une échelle optimale pour mettre en place ce processus. Bien que la tendance soit à l’échelle du bassin viticole et de l’interprofession pour discuter du changement climatique, l’échelle de l’appellation ou de la fédération d’appellations propose le plus de réponses et semble donc être actuellement la plus pertinente pour œuvrer concrètement à cette stratégie d’adaptation. On le voit notamment dans le Ventoux, où les velléités pour repenser un périmètre d’appellation avec des critères liés au changement climatique supposent réellement une action stratégique à long terme. Elle ne peut se faire qu’à l’échelle de l’AOC avec l’appui des acteurs de la filière : l’INAO et des organismes tels que la Cellule Terroir développée en Val de Loire, ainsi que les opérateurs de transmissions.
L’appellation Ventoux : intégrer la prise en compte du changement climatique dans un cahier des charges
Corentin Thermes (CITERES)
L’appellation d’origine contrôlée (AOC) Ventoux fait partie des appellations viticoles pionnières en France sur les réflexions d’intégration du changement climatique et des adaptations dans le cahier des charges qui la régie.
Dans un contexte de délimitation particulier depuis les années 70, le collectif de vignerons impliqué aujourd’hui dans l’appellation tente d’intégrer, en dialogue avec l’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité), des évolutions sur le périmètre de l’appellation. Le syndicat d’appellation questionne les délimitations « classiques » de l’INAO en AOC viticole qui fixe, par exemple, une limite théorique à la classification de parcelles à 500 m d’altitude en France. Comme l’indique son nom, l’appellation est au pied du « Géant de Provence » - le Mont Ventoux - et les vignerons regardent avec intérêt la possibilité de faire monter des vignes en altitude. Cela permettrait notamment de gagner en fraîcheur les nuits d’été, impactant directement la maturité des raisins, leur charge en sucre et donc le potentiel en alcool des vins du Ventoux ; en bref, il s’agit de déplacer des vignes dans un même territoire pour répondre aux impacts du changement climatique. Les vignerons s’interrogent aussi sur les fonds de vallons qu’ils souhaiteraient voir figurer parmi les périmètres révisés de l’appellation pour maintenir de la fraicheur.
Le syndicat se confronte à l’institution, garante du maintien de la qualité des vins d’appellation, à ses experts et à certains critères qui ont du mal à évoluer aussi vite que le changement climatique impacte les vignes. Le dialogue est ouvert, et si l’AOC Ventoux arrive à faire évoluer son cahier des charges avec des arguments tirés des impacts du changement climatique, il est certain que d’autres suivront.
Il est à noter qu’en parallèle et ici aussi de manière pionnière, l’AOC a recruté un chargé de mission climat et transition écologique, en partenariat avec le Parc Naturel Régional du Mont-Ventoux, pour accompagner les vignerons sur ces questions.
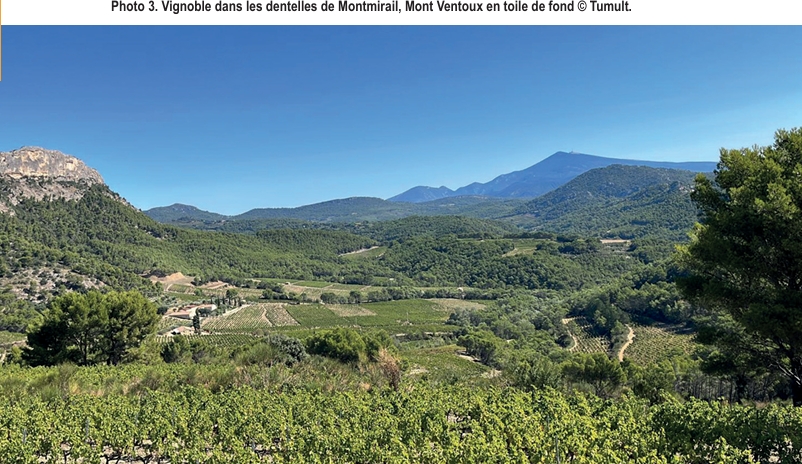
-
-
Une gouvernance territoriale à réinventer
Les collectivités locales ont un rôle primordial à jouer pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. Des contributions en sciences juridiques et en sciences politiques permettent de mieux comprendre la complexité de ces transformations et les implications démocratiques sous-jacentes.
-
La mise en œuvre d’un droit climatique dans les territoires
Marie-Laure Lambert (LIEU)
Un ensemble de textes juridiques internationaux encadre l’évolution de la prise en compte du changement climatique par les décideurs publics. Les engagements de lutte contre les changements climatiques sont adoptés par chaque État souverain qui a accepté de signer des Traités contraignants (Rio en 1992 et Kyoto en 1995), puis des accords plus souples (Accord de Paris en 2015). La France est également tenue de respecter les objectifs chiffrés européens en matière de baisse des émissions de GES (-55 % en 2030, par rapport à 1990, -80 % à 95 % en 2050 pour atteindre la neutralité carbone), de réduction de la consommation finale d'énergie (au moins 40 % en 2030 par rapport à 2007), de développement des énergies renouvelables, de rénovation et de performance énergétique des bâtiments etc. Le respect de ces obligations est vérifié par la Commission européenne, mais aussi, de plus en plus, par des ONG qui engagent des procès climatiques.
Or l’État français a progressivement décentralisé beaucoup de compétences en matière d'atténuation ou d’adaptation au changement climatique, lesquelles reposent largement sur une planification territoriale partagée entre les Régions (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires - SRADDET) et les intercommunalités (Plans Climat Air Energie Territoriaux - PCAET). Ces dernières disposant également de la compétence de gestion des inondations et des submersions marines (GEMAPI) qui impliquera de gérer les digues ou de prévoir des stratégies de gestion des risques d’inondation et de submersion, et désormais également des stratégies locales de gestion intégrée du trait de côte. De plus, l’action des acteurs publics locaux doit, selon le code de l’énergie (article L100-2), en premier lieu viser à maîtriser la demande d'énergie et favoriser l’efficacité et la sobriété énergétiques, dans tous les domaines de leurs compétences : la gestion de leur patrimoine immobilier ou de leur flotte de véhicules, leur commande publique ou la formation de leurs personnels.
Cette approche plus localisée permet aux acteurs en prise directe avec les émissions et la vulnérabilité de leurs territoires, d’expérimenter des solutions répondant aux enjeux locaux, et notamment aux vulnérabilités sociales, qui seront aggravées par le changement climatique. En outre, ils peuvent s’appuyer sur leurs compétences d’urbanisme, les SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et les PLUi (Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux) pouvant désormais intégrer des objectifs climatiques ou énergétiques, en imposant une production minimale d’énergies renouvelables, en luttant contre l’étalement urbain (objectif ZAN - Zéro Artificialisation Nette), en réintégrant l’implantation des activités commerciales dans les centres urbains, en incitant à l’utilisation de matériaux de construction biosourcés ou à la désimperméabilisation des sols. En matière agricole, le SCoT peut fixer des objectifs pour améliorer l’autosuffisance alimentaire du territoire, relocaliser la consommation en accompagnant une dynamique autour des producteurs locaux, préserver le captage naturel du carbone par les forêts ou des sols de qualité. Il peut enfin identifier les filières de matériaux biosourcés et produits localement qui mériteraient d’être développées dans le but de fournir des matériaux d’isolation, de rénovation ou de construction performants, à moindre empreinte carbone et généralement recyclables.
Le PLU peut travailler sur l’implantations des constructions dans une approche bioclimatique, la qualité urbaine et architecturale (favorisant la performance énergétique des bâtiments), et le traitement environnemental et paysager des espaces non-bâtis (pour limiter l’îlot de chaleur urbain). La gestion cohérente des déplacements par transports en commun ou modes doux (Plans de mobilité) ainsi que des déchets (PLPRD et SRADDET) est également précieuse pour lutter contre les changements climatiques. Mais cet éclatement des compétences, ainsi que l’injonction à la « neutralité carbone », pourraient aggraver les inégalités territoriales, dans la mesure où les territoires ruraux seraient tenus de compenser les émissions de carbone des grandes métropoles ou des grands sites industriels. En outre, la réglementation des Installations Classées Protection de l’Environnement (ICPE) est une compétence de l’État, dont les collectivités territoriales n’ont pas la maîtrise. Ainsi, le captage-stockage souterrain du CO2 (CSC) afin de stocker les émissions de CO2 des grandes industries plutôt que de les réduire à la source pourrait être imposé aux territoires ruraux bien qu’il crée des risques technologiques nouveaux sur de vastes territoires.
Une solidarité réelle entre les territoires devrait au contraire reposer sur un effort de sobriété partagé, et sortir du modèle contemporain qui concentre les richesses et la valeur ajoutée dans les grandes métropoles, lesquelles reportent la charge de services peu rémunérateurs vers les zones excentrées (fourniture de nourriture, d’énergie, gestion des déchets, compensation des émissions carbone).
De la prévention à la compensation : la neutralité carbone en question
Marie-Laure Lambert (LIEU)
La référence à la « neutralité carbone » qui a émergé depuis quelques années, brouille les objectifs de limitation des émissions de GES. Il ne s’agit plus seulement, comme cela était prévu par la loi depuis 2005, de faire baisser les émissions de CO2 des territoires d’un facteur 4 ou d’un facteur 6, mais désormais de s’orienter vers des calculs complexes effectués par des logiciels (comme Aldo), selon des indicateurs discutables, pour équilibrer les émissions et le stockage du carbone.
Le risque est alors de remplacer les efforts de sobriété énergétique, de réduction des émissions, de contraction de la demande énergétique, d’efficacité énergétique, par une comptabilité opaque et peu contrôlable visant à compenser les émissions par du stockage « anthropique », sans garantie de pérennité dans le temps : combien de carbone un arbre pourra-t-il stocker si la sécheresse le fait mourir en quelques années ?
En termes juridiques, on passe donc du principe vertueux de prévention ou de réduction à la source, imposé au pollueur, à des techniques beaucoup plus discutables de compensation carbone, qui font parfois peser les efforts sur d’autres entités que les pollueurs. Ce mécanisme est particulièrement visible dans le secteur de l’aviation civile, qui doit compenser progressivement ses émissions au lieu de chercher à les réduire. Au-delà des principes juridiques et de l’équité, le passage de la prévention à la neutralité carbone nous dirige peut-être vers des procédés ou techniques de stockage du carbone très discutables.
Ainsi, les efforts pour améliorer le stockage naturel du CO2 par les forêts, les écosystèmes et les sols peuvent être bénéfiques pour l’environnement, mais peuvent aussi conduire à la généralisation de plantations d’arbres monospécifiques par exemple.
De même, les techniques de captage-stockage souterrain du CO2 (CSC) dans d’anciens gisements de gaz ou de charbon, voire dans des nappes d’eau souterraines, qui ont été expérimentées, en France (« pilote » de stockage géologique de CO2 de Total dans les Pyrénées Atlantiques), présentent des risques technologiques indéniables. L’étude de danger de Total a montré qu’une fuite de CO2 serait létale jusqu’à plus de 50 mètres du gazoduc ou du puits d’injection, et que des fuites diffuses pourraient être nocives pour l’environnement (acidification des sols et des nappes d’eau). Enfin, le CSC entraîne une consommation énergétique supplémentaire, qui nuit à sa cohérence climatique.
En raison de ces dangers, le stockage industriel souterrain a fait l’objet d’oppositions locales fortes et de contentieux. Pour autant, ce type d’activité est désormais autorisée et sera classée dans la catégorie des installations classées industrielles les plus à risques (Autorisation avec affichage dans un rayon de 6 km).
-
Le traitement des risques côtiers induits par le changement climatique dans les documents d’urbanisme des communes littorales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : un attentisme local qui interroge
Samuel Robert (ESPACE)
L’adaptation au changement climatique passe notamment par l’anticipation de ses effets par les politiques publiques d’aménagement du territoire. Sur le littoral, l’une des questions les plus critiques concerne l’élévation du niveau de la mer et l’augmentation des risques liés aux aléas météo-marins. Dans une certaine mesure, la prise en compte de ces phénomènes dans les documents locaux d’urbanisme témoigne de la manière dont les institutions se représentent le changement climatique et les risques associés.
À l’échelon local, les documents d’urbanisme sont établis par les communes et les établissements intercommunaux. Ils réglementent les usages possibles des sols et les droits à construire, tout en se conformant à des obligations réglementaires issues d’échelons administratifs supérieurs, notamment concernant la gestion et la prévention des risques, qui restent une prérogative de l’État. Une étude de la planification urbaine des 65 communes littorales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, riveraines de la Méditerranée et de l’étang de Berre, a permis de caractériser la manière dont les risques liés au changement climatique sont traités dans les documents d’urbanisme en vigueur en juillet 2019. Ses enseignements, qui se situent à plusieurs niveaux, révèlent que le littoral de la région est insuffisamment préparé aux changements actuels et à venir.
Si, dans l’ensemble, les risques littoraux associés au changement climatique ne sont pas ignorés, 31 communes (cumulant 22 % de la longueur du littoral régional) sont soit sans Plan Local d’Urbanisme (PLU), soit sans évocation de ces risques dans le rapport de présentation de leur PLU. Un tel phénomène est surprenant dans une région aussi densément peuplée sur son littoral et autant orientée vers l’économie balnéaire et résidentielle. Par ailleurs, sur les 34 communes (77 % du littoral régional) dont le PLU évoque l’existence de phénomènes de submersions marines et/ou d’érosion, seules 23 (60 % du littoral régional) présentent des éléments de réglementation en lien avec ces aléas. Ce décalage interpelle et surprend à nouveau. Il signifie que certaines communes mentionnent les aléas mais qu’elles n’ont pas pris de dispositions pour y faire face.
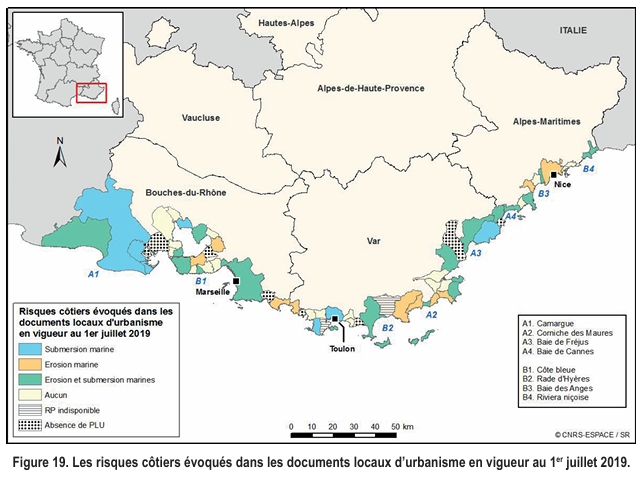
Enfin, lorsque des dispositions existent dans les règlements d’urbanisme (23 communes), elles découlent le plus souvent de mesures imposées par l’État via les Plans de prévention des risques (PPR) ou par les Porter à connaissance sur l’aléa submersion marine, documents transmis par les Préfets aux communes. Seules 8 communes proposent de leur propre chef une réglementation d’urbanisme visant à se prémunir des risques littoraux. Aussi, outre le faible nombre de communes dont la planification urbaine aborde réglementairement l’occupation du littoral en rapport avec les aléas marins, l’étude révèle la relative faiblesse des dispositions, voire leur absence d’ambition.
Au final, il apparaît que les collectivités littorales de la région n’ont pas encore pris la mesure des changements induits par le changement climatique, comme le suggère l’analyse de la planification urbaine en vigueur à la mi-2019, et comme le confirme le décret du 29 avril 2022, découlant de la loi Climat et Résilience (août 2021), « établissant la liste des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées aux phénomènes hydrosédimentaires entraînant l'érosion du littoral ». En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, seules deux communes (Cassis et Eze) ont accepté d’en faire partie, ce qui interroge sur la capacité des communes littorales de la région à remettre en question leur modèle de développement et à s’engager dans une démarche d’adaptation.
-
La planification territoriale pour le changement climatique est-elle utile ? Limites et leviers pour l’action
Antoine Ducastel (ART-Dev,CIRAD) et Marie Hrabanski (ART-Dev, CIRAD)
« La planification écologique existe déjà, mais ne sert à rien » affirmait un haut fonctionnaire dans les colonnes d’AOC. En matière de planification territoriale, ce constat est particulièrement vrai tant se sont multipliés depuis une dizaine d’années les plans et schémas d’aménagement aux visées écologiques.
La fabrique des schémas et documents d’urbanisme (SRADDET, PCAET, etc.) - qui se déclinent en orientations stratégiques et en plans d’action -, repose sur la mobilisation d’élus, de techniciens et d’experts extérieurs, et sur l’organisation de larges consultations publiques des acteurs publics et privés (collectivités, entreprises, associations, etc.). Le pilotage est confié aux collectivités « assistées » par quelques bureaux d’études spécialisés, tandis que l’État garde un pouvoir de supervision (validation des schémas régionaux d’aménagement par le préfet par exemple) Ce travail quotidien de planification est souvent long, couteux et incertain car il repose sur l’articulation entre une grande diversité d’intérêts, de ressources et de savoirs.
Pourtant, même lorsqu’ils sont adoptés, ces plans sont peu ou pas appliqués. Les études académiques ont mis en évidence une série de facteurs qui permettent de mieux comprendre les difficultés et les limites de la planification territoriale :
□ Son périmètre d’action est étroit et restreint à la fois en amont, par la planification écologique nationale (Stratégie Nationale Bas Carbone, Programmation Pluriannuelle de l’Energie, etc.), mais aussi en aval par les collectivités infra - EPCI, les communes. Cette planification climatique multi-niveaux se caractérise par un empilement, une superposition de plans, sans que leur articulation ne soit toujours clairement posée.
□ Le manque structurel de ressources de fonctionnement pour mener à bien ce travail de planification. A ce titre, les collectivités sont placées dans une situation de dépendance vis-à-vis des bureaux d’études spécialisés et des opérateurs techniques (par exemple les gestionnaires des réseaux électriques et le S3ENR (Schéma régional de raccordement au réseau des Énergies Renouvelable - EnR) dans le cadre de la planification du développement des EnR).
□ Le manque de ressources d’investissement pour mettre en œuvre et opérationnaliser ces plans. D’une part, les recettes (fiscales et budgétaires) des collectivités sont structurellement insuffisantes pour couvrir les besoins financiers de la transition écologique. D’autre part, ces plans sont peu ou pas articulés avec les contrats territoriaux qui sont assortis de transferts financiers de la part de l’État.
□ La faible appropriation politique de ces plans au niveau local - avec toutefois quelques exceptions comme le SRADDET de la région Occitanie, Occitanie 2040.
En conclusion, si aujourd’hui, avec la promulgation de la loi relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelable (loi APER), l’État se soucie d’accélérer la transition à l’échelle des territoires, dans les faits, de nombreux obstacles institutionnels financiers et politiques entravent cette dynamique. Il semble en effet que pour mettre en cohérence et atteindre les objectifs de planification à l’échelle des territoires, une « planification de papier » ne suffise pas, sa mise en œuvre requiert impérativement des financements publics conséquents.
Le projet Aqua Domitia : un exemple de maladaptation ?
Antoine Ducastel (ART-Dev,CIRAD) et Marie Hrabanski (ART-Dev, CIRAD)
Le temps est-il venu pour la France des grands transferts d’eau des régions les plus arrosées vers les plus sèches, entre des bassins-versants différents, comme cela se pratique dans d’autres pays, notamment en Espagne ? Cette question est relancée depuis que le département des Pyrénées Orientales connait une sécheresse très grave : la solution qui semble s’imposer consiste précisément à prendre de l’eau dans le Rhône et à la transporter dans les départements du Languedoc. Aujourd’hui, un gros tuyau appelé Aqua Domitia s’arrête dans l’Aude et la distribution se répartit entre eau potable (40 %), irrigation agricole (40 %) et « volumes de substitution » (20 %) qui permettent de puiser moins dans des environnements vulnérables. Vu le contexte climatique, nombre de voix s’élèvent pour réclamer sa prolongation jusque dans les Pyrénées orientales. Ce département est économiquement très dépendant du tourisme et de l’agriculture – la sécheresse a eu des conséquences très graves sur cette dernière, avec des pertes non seulement de récoltes mais d’arbres fruitiers et de vignes. D’autres, au contraire, contestent avec encore plus de vigueur le projet. Les interrogations restent les mêmes : ne faut-il pas d’abord réduire les fuites (40 % de pertes dans certains endroits des Pyrénées Orientales), recycler les eaux usées, modifier les pratiques culturales, réduire les consommations, en particulier celles des touristes ? Et surtout, le Rhône pourra-t-il fournir de façon pérenne les quantités d’eau nécessaires à cette partie de l’arc méditerranéen sans dommages sur les écosystèmes du fleuve, comme sur la Camargue ?
Le dispositif de transport d’eau du Rhône vers l’Occitanie est présenté comme un exemple d’adaptation au changement climatique sans toutefois que celui-ci ne soit intégré dans une dynamique de planification territorialisée. En effet dans les années 2000, afin de faire face à un contexte marqué par l’augmentation des contraintes réglementaires et institutionnelles pour bon nombre d’usagers et d’acteurs de l’eau tant au niveau national (loi sur l’eau de 2006 en France) qu’européen (Directive cadre sur l’eau de 2000), la région Occitanie a souhaité étendre et interconnecter davantage le réseau hydraulique régional dont elle est devenue propriétaire en 2008 pour sécuriser des ressources en eau régionales. Aqua Domitia visait ainsi à sécuriser l’alimentation en eau potable par l’apport d’une ressource supplémentaire, notamment en cas de sècheresse ou de pollution, à alléger la pression sur les milieux fragiles, accompagner le développement économique régional et enfin maintenir et développer une agriculture diversifiée de qualité et une viticulture compétitive, malgré le changement climatique. L’utilisation de l’eau du Rhône pour irriguer les terres qui le longent ne constitue en rien une nouveauté. Mais le transfert de l’eau du Rhône en direction du Languedoc a changé cette logique d’utilisation par l’ampleur des coûts, la distance et l’échelle des travaux à réaliser.
Le prolongement d’Aqua Domitia doit notamment participer à l’approvisionnement en eau de la production viticole et horticole : des secteurs d’activités particulièrement stratégiques pour la région, et qui sont par conséquent au centre d’enjeux politiques et électoraux. Ce projet vise officiellement à répondre aux enjeux d’adaptation de l’agriculture au changement climatique mais il apparait davantage comme un exemple emblématique de maladaptation. Il semble être élaboré en dehors de toutes les ambitions planificatrices pourtant portées par les différents territoires concernés. A ce titre, plusieurs points essentiels peuvent être soulignés. Tout d’abord, le premier projet Aqua Domitia était particulièrement onéreux et son extension l’est encore davantage. Un financement massif, obtenu via un partenariat privé public, a permis de financer à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros ce projet controversé. Ce financement est particulièrement élevé au regard des quelques millions d’euros dédiés à la planification territoriale.
Un deuxième point a trait à la cohérence du projet avec les objectifs et exigences de la planification territoriale. En effet il va à l’encontre d’une gestion de l’eau adaptée aux enjeux climatiques et en phase avec le principe de justice environnementale. Il encourage en effet l’augmentation de la demande et la pérennisation de cultures agricoles particulièrement gourmandes, qui ne sont plus adaptées, ou ne seront pas adaptées, au dérèglement climatique telles que la culture du maïs. Il engendre également des inégalités sociales et territoriales en créant des inégalités d’accès entre agriculteurs, notamment entre ceux qui seront servis et les autres et entre les communes et communautés de communes qui pourront financer ou pas les réseaux secondaires.
Enfin le projet a des conséquences sur le long terme et crée des conditions d’irréversibilité : une fois mis en œuvre, il faudra bien utiliser l’eau, entretenir les canalisations, etc. Ces différents dimensions techniques et politiques n’ont pas été négociées dans le cadre d’une planification territorialisée concertée et se poursuivront malgré les négociations qui pourraient avoir lieu à l’avenir.
-
La Camargue : s’adapter à l’adaptation au changement climatique
Raphaël Mathevet (CNRS EPHE CEFE), Cécile Bazart (CEEM), Aurélien Allouche (MESOPOLHIS)
Le dérèglement climatique et ses conséquences environnementales et socio-économiques deviennent visibles de tous en Camargue. Salinisation des eaux et des sols, érosion littorale, élévation du niveau de la mer, sécheresses et canicules plus fréquentes et intenses génèrent tensions sociales et conflits locaux, comme l’a montré un projet de recherche en deux volets. Le premier interrogeait les acteurs locaux (6 ateliers réflexifs, une conférence publique et deux séances de théâtre-forum) sur leurs visions des changements, les craintes et questions en lien avec leurs activités, leurs vies quotidiennes ainsi que les futurs possibles du territoire.
Pour cela, une synthèse des connaissances scientifiques sur le changement climatique et ses effets à l’échelle de la réserve de biosphère de Camargue a été produite et diffusée pour servir de support de médiation territoriale. Ces ateliers ont été également l’objet d’une évaluation sociologique des apprentissages et d’une caractérisation des participants pour préciser les enjeux de sensibilisation et d’engagement dans l’action collective.
De façon complémentaire, le second volet correspondait à une campagne d’enquête auprès d’un millier d’habitants. Il a permis de mesurer un fort attachement à la Camargue, des perceptions variées des changements et une très faible connaissance des institutions et des modalités de l’action publique. Il ressort de ce travail, réalisé de 2021 à 2023 et en cours de valorisation, que les problèmes actuels ne sont pas que biophysiques mais aussi institutionnels. Ils dépendent des rapports de force entre acteurs du territoire, des modes de gouvernance ainsi que des systèmes de valeurs et de connaissances. La principale limite réflexive à l’adaptation en Camargue reste l’incapacité à faire émerger un espace public autour de l’adaptation, conséquent et cohérent avec les dynamiques sociales et institutionnelles. Il en résulte une faible circulation des connaissances trans-sectorielles, ainsi qu’un affaiblissement de la capacité des institutions locales à peser sur une compréhension collective des enjeux du changement climatique. En conséquence, se multiplient des visions hétérogènes de l’adaptation individuelle, collective et institutionnelle, sans qu’elles ne puissent se confronter significativement. Les visions de l’adaptation au changement climatique évoluent le long d’un gradient allant de la maîtrise hydraulique historique reposant sur le génie civil et l’aménagement, jusqu’à l’adaptation de la gestion et des aménagements existants en intégrant les processus biophysiques dans des opérations de restauration écologique. Les prochains travaux scientifiques sur la gestion de l’eau et la modélisation de l’évolution du delta devraient permettre d’accompagner la réflexion des acteurs locaux. Quelle sera la place des infrastructures hydrauliques agricoles et de protection dans l’adaptation à venir ? Quelle Camargue veulent les camarguaises et camarguais ? La situation actuelle est celle d’une société locale consciente de la nécessité de s’adapter, traversée par des dispositifs allant en ce sens, mais qui doit encore produire un apprentissage social et institutionnel du traitement de cet impératif : en somme, s’adapter à l’adaptation.

-
-
Les citoyen.nes, des actrices et acteurs incontournables
La question du degré d’acceptation par les citoyen.nes des mesures prises dans le cadre de la transition écologique, des politiques d’atténuation aux projets d’adaptation au changement climatique se pose depuis plusieurs années. La question de la réception des mesures d’adaptation, si elle est essentielle, doit être pensée en parallèle de l’implication des citoyen.nes au sein des projets de territoires. L’enjeu est bien de formaliser des modalités de gouvernance permettant de faire ensemble, de l’élaboration à la mise en œuvre, et de s’assurer que la transition écologique est juste et démocratique. Ainsi, depuis plusieurs années, la multiplication des collectifs et des recours juridiques (Notre affaire à tous, la convention citoyenne pour le climat, la notion de crime d’écocide, le défi #onestprêts…) témoignent d’un enjeu de corréler transition, justice sociale et démocratie.
-
La gestion souple du trait de côte : donner la parole aux usagers et communiquer sur les travaux de renaturation du cordon dunaire des Vieux Salins d’Hyères
Myriam Hilbert (LADYSS)
Le recul du trait de côte d’une partie du littoral français est accentué par le changement climatique qui provoque une montée du niveau des mers. Cette évolution a donné lieu à une refonte de la stratégie d’aménagement du littoral national et l’élaboration, dès 2012, d’une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte (SNGITC) valorisant le rôle des écosystèmes naturels dans les projets de recomposition spatiale.
Ce changement de paradigme est également porté par le Conservatoire du littoral qui tente de combiner la préservation de la biodiversité d’une part, et l’adaptation au changement climatique d’autre part (dont l’adaptation des littoraux au risque de montée des eaux). Le Conservatoire a notamment initié un projet européen, avec les acteurs économiques et politiques locaux (2017-2022) qui vise à démontrer l’intérêt et la faisabilité des solutions de gestion souple du trait de côte pour répondre aux conséquences des aléas de submersion et d’érosion marine. Ce projet explore différentes solutions d’adaptation fondées sur la nature sur dix sites du littoral français.
Dans le cadre d’un processus de renaturation du littoral du site des Vieux Salins par la suppression d‘une digue constituée d‘enrochement (voir Zoom 10), le Conservatoire du littoral et le gestionnaire (la Métropole Toulon Provence Méditerranée) se sont interrogés sur la manière dont les usagers qui fréquentent les Vieux Salins perçoivent et comprennent les mesures de gestion du site, et notamment le désenrochement. La réalisation d’une étude sur la perception sociale permet d’identifier ce qui relève ou non d’un attachement des usagers aux sites et de constituer des outils d’évaluation des politiques publiques d’aménagement du littoral.
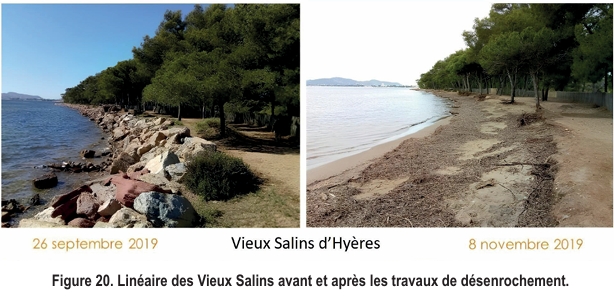
Lors d’une enquête par questionnaire menée entre 2015 et 2016 par des étudiant.es en Master à AgroParisTech sur les Vieux Salins, les usagers interrogés sur l’avenir de l’enrochement, encore en place à cette époque-là, se déclaraient à 63% pour sa conservation (bien que majoritairement considéré comme étant inesthétique et d’une utilité peu certaine), et à 27 % pour sa suppression et la renaturation du cordon dunaire. Entre août et septembre 2020, une enquête a été conduite auprès de 184 usagers du même site, à la suite de la suppression de 590 m de linéaire d’enrochement et de la reconstitution de la dune, afin de recueillir leurs ressentis face à ces transformations (Figure 20). Il en ressort que 72 % d’entre eux déclarent avoir vu des transformations sur le site, sans pour autant citer spontanément le désenrochement. Après présentation par les enquêteurs des objectifs du désenrochement (en priorité lutter contre l’érosion), ainsi que les photos de la Figure 20, 75 % des usagers se disent satisfaits de ces travaux. De manière générale, les usagers fréquentent les Vieux Salins pour leur beauté, leur calme et leur esthétique naturelle, des caractéristiques rares sur un trait de côte méditerranéen perçu par eux comme fortement artificialisé. L’ombrage apporté par les pins, présents sur le rivage, est d’ailleurs un point majeur d’attachement souvent cité : sa disparition, liée à la mortalité des pins du fait de la salinisation du sol, semble être la principale raison du mécontentement des usagers, bien avant la problématique de l’existence, ou non, de l’enrochement.
Toutefois, une incertitude demeure chez ces usagers quant à la capacité de ces méthodes de gestion à prévenir et protéger des risques côtiers. Interrogés sur la confiance qu’ils seraient prêts à accorder à des méthodes douces de gestion des risques côtiers (Solutions fondées sur la Nature entre autres), ils sont 41 % à répondre qu’ils ne savent pas – malgré leur conscience des effets de l’érosion sur le rivage. Ces doutes quant à la capacité de ces méthodes souples de gestion à répondre aux enjeux en présence, se retrouvent principalement chez les résidents des communes proches (Hyères, la Londe-les-Maures). Pourtant, sur le site des Vieux Salins, à la suite des différentes tempêtes (octobre et novembre 2019) qui ont frappé les côtes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur après les travaux de désenrochement, la plage renaturée et les banquettes de posidonies ont montré leur capacité de résistance face à l’érosion, ayant permis au cordon dunaire de tenir. Sur ce site, ces observations constituent un argument de plus en faveur de la pertinence de ce choix de gestion souple du trait de côte.
En conclusion, l’enquête met en évidence la complexité d’appréhender ces modes de gestion alternatifs, et la nécessité de poursuivre les efforts d’information d’ores et déjà mis en place sur le site (panneaux qui jalonnent aujourd’hui les Salins et qui expliquent le rôle des dunes, des herbiers et banquettes de posidonie ou encore l’impact de l’enrochement). Des expositions photographiques, des reportages, ou encore la formation des techniciens en charge des travaux, permettraient de faire passer une information auprès des usagers du site, et de détailler les objectifs recherchés par les aménagements.
La renaturation du site des Vieux Salins d’Hyères
Pauline Bouzat (Conservatoire du littoral)
Les Vieux-Salins d’Hyères (Var), au passé industriel et aujourd’hui placés au cœur d’un programme de renaturation du trait de côte, sont l'un des dix sites du littoral français ciblés par le Conservatoire du littoral dans le cadre du projet Adapto.
Acquis en 2001 par le Conservatoire du littoral, les salins sont séparés de la mer Méditerranée par un cordon littoral étroit dans lequel a été creusé un canal d’alimentation ainsi qu’une levée de protection des anciennes tables salantes. Entre 1970 et 1992, la compagnie des Salins du Midi enrocha une partie du cordon littoral situé à l’est du site sur près de 800 mètres pour protéger l’outil de production salinière. Si les enrochements ont permis de faire obstacle au recul du trait de côte sur le secteur Est des Vieux-Salins, ils ont conduit à décaler la cellule d’érosion plus à l’ouest des ouvrages et à renforcer le risque d’intrusion marine au niveau du canal d’alimentation du site qui dessert l’ensemble des pièces d’eau en eau de mer. Pour atténuer l’érosion au niveau de ce secteur sensible, susceptible de mettre à mal le fonctionnement hydraulique des Vieux-Salins, le Conservatoire du littoral a lancé une réflexion autour de la renaturation du cordon littoral plutôt que renforcer voire prolonger les ouvrages existants.
Ainsi, après un dialogue approfondi avec les partenaires concernés (Conservatoire du littoral, élus locaux et services de la collectivité gestionnaire), un désenrochement et une restauration du cordon dunaire ont été privilégiés pour rétablir la mobilité du trait de côte et restaurer les dynamiques sédimentaires naturelles. Entre 2011 et 2020, trois phases de désenrochement se sont succédées sur la majeure partie de l’ouvrage (près de 700 mètres linéaires). Ces opérations ont permis le retour d’une plage sableuse tout en maintenant le trait de côte au même niveau. Une atténuation de l’érosion sur le site a aussi été observée par la restauration du transit hydrosédimentaire. Enfin, un itinéraire alternatif du sentier littoral a été aménagé en retrait, afin d’assurer la continuité du sentier littoral pendant les travaux et d’anticiper les effets des futures évolutions du rivage. Les différentes études menées ont mis en lumière le rétablissement des équilibres hydrosédimentaires, les bénéfices écologiques, paysagers, pédagogiques et économiques de la gestion souple du trait de côte dans ce cas.
-
Le rôle des associations et des citoyens dans l’exigence juridique en matière de changement climatique
Marie-Laure Lambert (LIEU)
Les citoyens sont de plus en plus présents dans les débats publics et exercent une pression auprès des décideurs locaux et nationaux en faveur d’actions climatiques. Le plaidoyer des associations et des ONG est connu de longue date mais les décideurs publics ont récemment fait appel à des conventions citoyennes, qui permettent de recueillir l’avis ou les propositions de panels de citoyens qui ne sont pas, au départ, des militants avertis.
Il est donc particulièrement intéressant de constater que les explications données par des scientifiques ou des experts, dans des rencontres qui laissent le temps de la réflexion et de l’échange, loin des tempêtes médiatiques et des raccourcis des réseaux sociaux, peuvent amener 150 citoyens, a priori peu sensibilisés aux enjeux climatiques, à émettre finalement des propositions d’actions en faveur du climat ou des transitions écologiques parfaitement pertinentes et équilibrées.https://propositions.conventioncitoyennepourleclim...">
Si les résultats de la convention nationale ont été insuffisamment repris (environ 40 % des propositions seulement) dans le texte final de la loi « climat et résilience » adoptée en juillet 2021, il est à noter que la région Occitanie s’est inspirée de l’expérience en conviant une convention de 100 citoyens destinée à construire un « Green New Deal local ». Les propositions ont été soumises à une votation à laquelle ont participé 20 000 Occitans. Toutes les propositions ont été reprises, sauf une (pour instaurer un travail d’intérêt écologique des prisonniers), et cinq qui n’étaient pas du seul ressort de la Région.https://jeparticipe.laregioncitoyenne.fr/consultat...">
-
Échec et réussite de la Convention citoyenne pour le climat
Jean-Michel Fourniau (Université Gustave Eiffel)
Convoquée pour parachever le Grand débat national, réponse gouvernementale aux Gilets jaunes, la Convention citoyenne pour le climat s’est vue confier une mission exceptionnelle : définir les mesures législatives nécessaires pour diminuer de 40 % (par rapport à 1990) les émissions de gaz à effet de serre de la France d’ici 2030. Le gouvernement reconnaissait par ce dispositif inédit la légitimité du tirage au sort pour représenter les citoyens. Les 160 citoyens tirés au sort ont travaillé 9 week-ends de 3 jours, d’octobre 2019 à juin 2020, aiguillonnés par la promesse du président de la République de transmettre « sans filtre » leurs propositions au Parlement. Cette « France en miniature » lui a remis le 29 juin 2020 à l’Élysée 149 propositions de mesures législatives et réglementaires. Son rapport a fourni la structure et la matière de la loi Climat-Résilience annoncée à ce moment-là, et à la préparation de laquelle les citoyens ont été associés, même si trop de leurs propositions n’ont pas été reprises « sans filtre », et pour beaucoup, pas du tout.
On retient souvent cette frilosité du gouvernement et des parlementaires à aller aussi loin que les citoyens le préconisaient pour parler d’échec de la Convention citoyenne.
Mais celle-ci a néanmoins fixé un cap et des objectifs pour les politiques climatiques, sur lesquelles l’action collective ne manque pas de s’appuyer. L’exercice lui-même est riche d’enseignements démocratiques. Après avoir mis à la disposition des participants un socle – remarquable et lui aussi inédit – de connaissances sur les enjeux climatiques, le dispositif de co-construction entre les citoyens et les experts du climat et juristes travaillant à leur service pour l’élaboration de mesures d’atténuation, intégrait dès sa commande la prise en compte de la justice sociale. En écho à la crise des Gilets jaunes, cette question a cadré l’esprit du travail des citoyens et en a fondé la portée politique. Le principal levier de la formulation des propositions dans un esprit de justice sociale vient de l’égalité radicale que confère le tirage au sort, autorisant une confrontation sans hiérarchie préétablie des expériences, des compétences et du sens de la justice, très divers parmi les participants. Comme l’ont analysé les travaux d’un groupe de trente chercheurs en sciences sociales ayant observé in situ le processus, le large consensus parmi les participants qu’a généré leur travail collectif a également trouvé un large écho au sein du grand public : plusieurs sondages l’ont souligné.
D’importants progrès restent à accomplir pour remettre les citoyens au cœur de l’action climatique, pour produire des mesures législatives et non pas seulement des recommandations générales comme dans la plupart des dispositifs participatifs, et ainsi asseoir le rôle politique représentatif des assemblées citoyennes , avec un engagement nécessaire de l’exécutif quant à la transmission sans filtre à au Parlement des mesures législatives formulées et leur soumission ou non à référendum. L’expérience de la Convention citoyenne a été un premier pas déterminant. Il contribue à l’intérêt que porte aujourd’hui les sciences humaines et sociales aux défis climatiques.
Une assemblée citoyenne du Futur à Marseille
Joël Guiot (CEREGE)
La Ville de Marseille a également lancé, depuis 2023, une « assemblée citoyenne du Futur » constituée de citoyens qui débattent de sujets d’avenir (sobriété et partage des usages en eau, tourisme durable et ville-nature). Ce dispositif permet aux citoyennes et aux citoyens de formuler des propositions concrètes pour construire une ville pilote en termes de transition écologique et sociale. Au total, 111 citoyen. ne.s ont été tiré.e.s au sort, dont 16 lycéen. ne.s. La première session de travail s’est terminée en mars 2024. Informés par les experts du GREC-SUD, les citoyens ont traité de la problématique de l’eau, du tourisme, de la Zéro Artificialisation Nette (ZAN), de la démocratie participative. De nouvelles sessions sont prévues avec d’autres participants tirés au sort. La balle est maintenant dans le camp de la municipalité qui doit reprendre les propositions lors des futures délibérations du conseil municipal.
-
Les procès climatiques : la responsabilisation des acteurs économiques dans leur contribution à l’effort climatique
Christel Cournil (LaSSP)
La concrétisation de l’urgence climatique sur les sociétés humaines a conduit la société civile ou des collectivités publiques à engager des actions contentieuses en visant d’abord les pouvoirs publics avant que les entreprises ne deviennent à leur tour la cible de ces « procès climatiques ». Dirigées contre des sociétés pétrolières, des sociétés productrices d’énergie, des investisseurs, les plaignants ont essuyé des échecs en raison de leur difficulté à faire reconnaître un intérêt à agir et à établir l’action ou l’omission fautive des entreprises, du difficile partage de responsabilités entre les multiples émetteurs ou encore de l’établissement du lien de causalité et le préjudice subi. Dernièrement, certains obstacles ont cédé et l’utilisation, dans les procédures judiciaires, d’éléments probatoires nouveaux (science du climat) y a contribué. À côté des procès plus classiques contre les infrastructures polluantes (projets d’oléoducs, projets énergivores), trois types de stratégies contentieuses se dessinent désormais.
D’abord, des tentatives de responsabilisation résultant des émissions de GES du passé (ex post) ont été menées sous l’angle de la responsabilité délictuelle, avec des requêtes cherchant à obtenir une réparation des préjudices subis en raison du changement climatique résultant des émissions de GES de quelques grandes entreprises polluantes. Certaines villes (San Francisco et Oakland) ont en vain demandé le financement de coûts d’infrastructures. En Europe, la demande de réparation (indemnisation) d’un Péruvien menacé par des crues glaciaires sur sa propriété à l’encontre de l’entreprise productrice d’électricité RWE a été jugée recevable par le juge allemand.
Ensuite, des demandes en responsabilité (ex ante) sur les émissions futures accompagnées d’injonctions préventives (qui vise à prévenir un acte illicite futur) ont été initiées. Il ne s’agit pas d’obtenir des indemnisations mais de chercher à responsabiliser des acteurs économiques dans leur contribution à l’effort climatique en demandant au juge de contrôler leur trajectoire de réduction de GES défini par leur Plan climat ou l’anticipation des risques climatiques dans leur « business model ». Ces procès ont été intentés par des ONG en France contre TotalEnergies ou contre BNP et aux Pays-Bas contre Shell. Pour ce dernier, il s’agit d’un des rares procès ayant obtenu une condamnation. Le juge néerlandais a exigé une diminution d’au moins 45 % d’émissions nettes avant 2030, par rapport au niveau de 2019. Shell a fait appel, mais reste néanmoins tenu de respecter les obligations de réduction fixées par le juge en raison du caractère exécutoire du jugement. En France, après 4 ans de procédure sur les questions de recevabilité, un récent jugement permet qu’un procès se tienne au fond sur le respect du devoir de vigilance en matière climatique par TotalEnergies.
Émergent, enfin, des demandes de responsabilisation portant sur la divulgation mensongère d’informations présentant des risques financiers ou sur le contrôle de la sincérité de la communication des engagements de décarbonation. Le premier cas en France porte sur la crédibilité des allégations de neutralité carbone d’ici 2050 de TotalEnergies. Trois ONG ont assigné le groupe à faire cesser des pratiques commerciales trompeuses définies par le Code de la consommation.
Un mouvement des procès climatiques en construction
Marie-Laure Lambert (LIEU)
Plusieurs procès portés par des fondations ou associations influentes visent à dessiner les objectifs d’une justice climatique en construction. En effet, les associations de citoyens peuvent se mobiliser en portant des actions juridiques devant les tribunaux. Le mouvement des « procès climatiques » a été encouragé par le succès de la fondation Urgenda aux Pays Bas. Cette association a obtenu, au nom de 886 citoyens, la condamnation de l’État néerlandais par le Tribunal de La Haye en juin 2015 (confirmé par la Cour Suprême hollandaise en décembre 2019) pour ne pas avoir « pris de mesures suffisantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ». Depuis, les contentieux climatiques se multiplient dans nombre d’états.
En France, les juges se sont très récemment laissé convaincre par des arguments climatiques, auxquels ils étaient demeurés sourds pendant des décennies. Une première décision dans ce sens est celle du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise annulant le projet Europacity en 2018 sur le motif de l’accroissement des émissions de GES (décision historique mais isolée et annulée par la CAA de Versailles). Elle fut suivie par une injonction adressée par le Conseil d’État (19 novembre 2020, Grande Synthe et autres) à l’État de renforcer son action climatique dans le sens des objectifs fixés pour 2030. De même le Tribunal Administratif de Paris a-t-il reconnu la responsabilité de l’État pour non-respect du budget carbone qu’il s’était fixé en vue d’atteindre les objectifs européens (Notre Affaire à Tous, Greenpeace, FNE, 3 février 2021). A la demande de ces mêmes associations, le tribunal administratif de Paris (14 octobre 2021) a donné injonction au gouvernement de réparer le préjudice écologique lié au surplus d'émissions de gaz à effet de serre, avant le 31 décembre 2022.
Parallèlement, des formes d’activisme moins institutionnalisées se manifestent aujourd’hui face à l’urgence climatique (Extinction Rebellion, Dernière génération, Scientists Rebellion…), et sont désormais accueillies par les juges. On relève notamment la relaxe par le TGI de Lyon le 18 septembre 2019 des « décrocheurs de portraits » du mouvement « Action non-violente COP 21 » ainsi que la relaxe, le 23 janvier 2024, par le Tribunal Correctionnel de Grasse, de trois activistes d’Extinction Rebellion poursuivis pour entrave à la circulation d’un jet privé sur l’aéroport de Cannes. De plus en plus, les juges reconnaissent la supériorité de la liberté d’expression dans le domaine d’un sujet d’intérêt général comme le changement climatique.
-
La recherche-action participative - Repenser la « culture en terrasses » dans la Roya
Clara Descamps (OTECCA)
Le projet Cultures en Terrasses (CTR) dans la Vallée de la Roya est un exemple emblématique d’un projet de recherche-action multi-partenarial impliquant recherche, incubateurs, associations et acteurs du territoire, mis en place dans le but de repenser un espace avec le prisme du changement climatique. En octobre 2020, la tempête Alex touche fortement la vallée de la Roya ; s’ensuivent de multiples questions pour repenser l’avenir durable et soutenable d’une vallée sinistrée. Le projet CTR émerge alors, entre des structures diversifiées pouvant apporter des compétences complémentaires, afin de repenser les modes de vie et le développement local dans le but de créer un avenir plus résilient dans la vallée. En collaboration étroite avec la Communauté d'Agglomérations de la Riviera Française (CARF) et la Mission Interministérielle pour la Reconstruction des Vallées (MIRV), CTR mobilise à la fois des chercheurs en économie, agronomie, géographie, sciences de l’éducation et anthropologie, ainsi que des parties prenantes locales telles que des ONG et des incubateurs. CTR s’intéresse aux espaces agricoles de terrasse, traditionnels de ces zones de montagne méditerranéennes, au travers d’une question de recherche coconstruite - « Les espaces de terrasses, que peut-on y faire, que peut-on en faire ? » - afin de repenser de manière holistique et décloisonnée l’avenir d’une vallée dans son ensemble.
Pour ne citer que deux exemples, le développement d'une méthode de détection automatique de terrasses basée sur des données LIDAR® couplée à des critères co-définis tels que l’accès à l’eau ou le potentiel de résistance durant un épisode climatique intense (localisation de la terrasse) permettront de mieux appréhender quelles terrasses réinvestir. Dans le cadre de ce projet, une étude anthropologique sera menée en étroite collaboration avec l’association « Remontons la Roya » pour répertorier les pratiques agricoles anciennes de la vallée afin de repérer les plus pertinentes dans un contexte de changement climatique et de les réintroduire via les formations données par les incubateurs de projets agricoles partenaires du projet. Cette approche collaborative entre chercheurs et parties prenantes locales enrichit le processus de recherche d’une part et garantit l’impact des données produites pour les réalités de terrain d’autre part.
En favorisant une prise de décision éclairée face aux défis environnementaux, le projet Culture en Terrasse dans la vallée de la Roya illustre le potentiel des sciences humaines et sociales à contribuer à l'adaptation au changement climatique et au développement durable dans les territoires.

L’observatoire de la Transition Écologique et Citoyenne - Côte d'Azur (OTECCA)
Clara Descamps (OTECCA)
Crée en 2020 à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société - Sud Est, l’OTECCA se positionne à l’interface entre monde académique et société civile. Il contribue à coordonner les efforts de recherche en sciences humaines et sociales de l’Université de Nice Côte d'Azur (UniCA), contribuant ainsi à la compréhension scientifique de la région et fournissant aux parties prenantes des données, des outils pratiques, des recommandations et des matériaux de discussion pour une prise de décision éclairée en collaboration avec les pouvoirs politiques locaux.
-
-
Conclusion
Les sciences humaines et sociales sont fondamentales pour mener une action collective ambitieuse à la hauteur des enjeux des changements climatiques et environnementaux en cours et à venir. Elles sont riches d’enseignements, à la fois pour comprendre des phénomènes globaux, mais également pour saisir des situations vécues, singulières. Elles nous permettent d’interroger l’histoire, de comparer des trajectoires territoriales à priori éloignées, de se doter d’outils analytiques et critiques pour penser le futur de nos sociétés.
Ces disciplines nous éclairent, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, sur les questions qu’il est nécessaire de se poser lors de la construction de projets de territoire et l’élaboration de politiques publiques. Comment les changements climatiques sont-ils appréhendés localement ? Quelles sont les transformations sociales marquantes pour la région ? Comment co-construire, avec les citoyen.nes, un projet de territoire en phase avec les enjeux climatiques ?
Les apports des sciences humaines et sociales sont multiples et diverses pour une Région Sud qui l’est tout autant, entre villes littorales, communes de montagne ou zones agricoles. Les préoccupations économiques peuvent être liées à un important taux de chômage, à une reconversion économique accélérée, au maintien d’un tourisme balnéaire ou alpin. Des aléas ont déjà marqué certaines parties du territoire, comme des canicules ou des inondations. Cette diversité représente une grande richesse mais, pour en bénéficier au mieux, il faut la connaître et la comprendre.
Les sciences historiques permettent ainsi de saisir les racines des évolutions de nos sociétés : en comparant, avec précaution, différentes époques, on peut mieux comprendre les nôtres. Les sciences juridiques mettent en évidence les cadres normatifs et règlementaires de cette évolution. Une connaissance fine de la manière dont les individu.es se représentent le changement climatique et les transformations sociales qu’il provoque permet de mieux saisir leurs dynamiques d’action - ou d’inaction. Une approche à l’échelle de secteurs d’activité ou collectifs professionnelles, articulée à des analyses économiques, aide les collectivités territoriales à piloter et accompagner les changements à venir. Sans oublier que tout ceci ne pourra se faire sans offrir une large place aux citoyen.nes dans la préparation de leur avenir commun.
Ce cahier nous a permis d’illustrer les apports possibles des sciences humaines et sociales. Il illustre surtout l’importance de continuer à largement développer ces recherches pour mieux cerner les spécificités de la Région Sud. Celle-ci est particulièrement impactée par les bouleversements du climat, la hausse de températures ou la violence des précipitations menaçant de modifier profondément ses modes de vie. Il faut, par exemple, développer davantage de travaux sur l’impact de ces changements sur l’économie locale ou l’emploi et mieux comprendre la difficulté d’adaptation des politiques publiques locales, ou encore analyser les impacts croisés du vieillissement et du réchauffement sur la santé publique. Il faut savoir concilier la justice sociale et la participation citoyenne avec la conservation de l’agriculture, du tourisme et de l’habitabilité des villes. Les défis sont immenses et toutes les sciences ne seront pas de trop pour les affronter.
-
Remerciements
Nous tenons à remercier tous les auteurs et autrices pour leur contribution à cet ouvrage collectif et souligner leur patience tout au long de ce cheminement éditorial.
Nous remercions également Suzanne de Cheveigné d’avoir accordé une juste part aux différentes disciplines représentées dans ce cahier, ainsi que pour sa distance critique, ses relectures assidues, ses reformulations précieuses, et surtout son aptitude à maintenir le cap de l’édition. Nous remercions également les membres du conseil scientifique du GREC-SUD, notamment Joël Guiot pour ses mises en perspective toujours pertinentes sur les enjeux climatiques régionaux et son goût pour l’histoire, ainsi que Marie-Laure Lambert pour avoir apporté à ce cahier une note critique et engagée.
Nous remercions Julie Gattacceca et Aurore Aubail d’avoir initié ce cheminement, ainsi qu’Antoine Nicault, Philippe Rossello, Dominique Flahaut, Cécile Bergeot et Chloé Stab pour leurs relectures attentives et leurs conseils avisés.
Nous remercions les financeurs du GREC-SUD, Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Région Sud, qui ont permis à l’association AIR Climat de réaliser cet ouvrage.
Comment citer cette publication du GREC-SUD ?
Les sociétés face aux bouleversements climatiques. Penser ces changements en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Les cahiers du GREC-SUD édités par l’Association pour l’innovation et la recherche au service du climat (AIR Climat), novembre 2024, 52 pages.
ISBN : 9782491380199
Sommaire du cahier
- Messages clés
- Résumé
- Introduction
- Comment les enjeux du changement climatique s’inscrivent-ils dans le temps ?
- Se représenter le changement climatique au travers du risque
- L’adaptation des acteurs et des activités socio-économiques
- Une gouvernance territoriale à réinventer
- Les citoyen.nes, des actrices et acteurs incontournables
- Conclusion
- Remerciements