Le droit serait-il en avance sur les élus et les acteurs locaux du tourisme pour penser l’adaptation aux changements climatiques des territoires de montagne ? Les chercheurs en droit qui ont analyse le volet 2 de la loi Montagne (Joye, 2017) mettent en avant une vision
anthropocentrée du développement durable : la montagne resterait un espace de conquête et non un espace à protéger. Néanmoins, le législateur reconnaît le besoin d’un changement de modèle, mais celui-ci reste au stade théorique.
 Photo 17. Prapic enneigé
Photo 17. Prapic enneigé
Deux points sont essentiels dans l’évolution juridique du développement durable des territoires de montagne (Photo 17) :
- de par sa réforme récente des unités touristiques nouvelles (UTN), l’État renforce le pouvoir des collectivités locales et le rôle de la planification territoriale. C’est également la première apparition du concept de vulnérabilité au changement climatique dans le code de l’urbanisme appliqué à une procédure administrative. En effet, le développement touristique et en particulier la création des UTN « prennent en compte la vulnérabilité de l’espace montagnard au changement climatique ». De ce point de vue, c’est un progrès car il sera, par exemple, possible de traiter un « projet restreignant la ressource en eau, le territoire agricole, l’artificialisation du sol, etc. ». Certes, cette inscription dans la loi n’interdit pas les projets d’aménagement, mais elle revient à imposer un « principe de prudence aux investisseurs » ;
- avec la loi du 28 décembre 2016, la législation « tente de prendre en compte la réversibilité des équipements, la remise en état des sites et leur reconversion ». L’autorisation de réalisation de travaux dédiés aux remontées mécaniques est dorénavant assujettie au démontage de celles-ci et de leurs constructions annexes, et à la remise en état des sites dans un délai de trois ans après l’arrêt définitif des remontées mécaniques. Actuellement, un certain nombre de questions juridiques restent toutefois en suspens : il n’existe pas d’obligation pour l’exploitant de constituer une provision financière. Sur qui pèsera cette mesure ? Et quelle autorité viendra constater la mise en arrêt d’un équipement de remontées mécaniques, et à l’aide de quel acte juridique ? Néanmoins, ces avancées démontrent une prise de conscience par le législateur du risque de créer des friches par des investissements anachroniques au regard des aspirations des touristes ou du changement climatique.
Il est encore difficile de savoir comment la loi va évoluer et de quelle manière le législateur prendra en considération la problématique du changement climatique, mais le droit en montagne tend vers une meilleure gestion des territoires.
« L’autorisation de réalisation de travaux dédiés aux remontées mécaniques est dorénavant assujettie au démontage de celles-ci et de leurs constructions annexes »
Zoom 6. Changement climatique et adaptation, comment sensibiliser et former les acteurs alpins ?
Pour l’éducation citoyenne, le changement climatique est l’un des enjeux les plus difficiles à appréhender : le thème est scientifiquement complexe ; les connaissances comportent de nombreuses incertitudes ; le phénomène est difficilement perceptible par les sens ; les effets sont considérés comme lointains à la fois dans l’espace et dans le temps ; les risques parfois oubliés. À cela s’ajoute un traitement médiatique qui alimente parfois le scepticisme et la remise en cause de nos modes de vie, ce qui rend difficile la mise en mouvement individuelle et collective.
Face à ces freins, les acteurs du pôle Éduc’alpes Climat expérimentent depuis 2010 diverses méthodes pour sensibiliser les publics alpins (jeunes, citoyens, professionnels, élus…) aux impacts du changement climatique, et font ressortir plusieurs points clés :
- l’importance de l’apport de connaissances locales développant la vision systémique du changement climatique. Les efforts sont à poursuivre sur le massif alpin pour rendre ces informations accessibles ;
- l’intérêt de s’appuyer sur le terrain physique et humain : la montagne permet de montrer les impacts du changement climatique. On pense à la fonte des glaciers ou à la migration d’espèces, mais faire témoigner des professionnels (agriculteurs, gestionnaires de stations, guides…) sur les changements qu’ils observent dans le milieu et leurs pratiques peut aussi être un puissant levier de prise de conscience ;
- l’utilisation de pédagogies actives et méthodes participatives qui développent l’esprit critique, les échanges, les débats, redonne du pouvoir d’action aux groupes et individus sur un sujet face auquel ils se sentent souvent impuissants ;
- enfin, aborder le changement climatique par un versant plus personnel (approches émotionnelles, sensorielles, artistiques, vécu…) est essentiel pour que chacun se sente concerné par ce sujet. Les dimensions psychologiques et sociales du changement climatique ont été encore peu investies dans les Alpes et les recherches gagneraient à être développées pour renouveler l’approche du sujet.
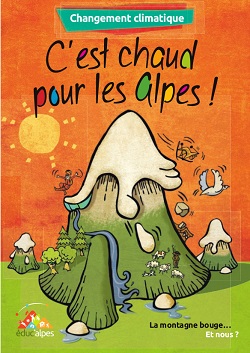
Sommaire du cahier
- L’or blanc s’écrit-il en pointillé dans les Alpes du Sud ?
- Les stations de montagne du futur, un visage polymorphe ?
- La loi Montagne 2 : une intégration des changements climatiques dans la législation ?
- Économie circulaire et numérique dans les Alpes du Sud, des modèles d’atténuation ?
- Stratégies territoriales de transition(s) et leur reconnaissance, catalyseur d’une mise en mouvement collective et coopérative ?
- La mobilité, le parent pauvre des territoires alpins ?
- Quel urbanisme demain en montagne ?
- Évolution de l’enneigement dans les Alpes du Sud entre 1971 et 2019
- Skierons-nous encore à l'avenir dans les Alpes du Sud ?
- Quatre communes des Préalpes du Sud se préparent aux transitions
- Les propositions de FNE Auvergne-Rhône-Alpes pour assurer le devenir de la montagne
- Découvrez les résultats du projet AdaMont porté par l'Irstea !
- Le tourisme à l'épreuve du changement climatique
- Le cahier « Montagne » à l'honneur à la mairie de Lardier-et-Valença