- 5.18. Quels loisirs dans les espaces ruraux pour limiter l’empreinte carbone ?
- 5.19. Le développement du slow tourisme dans les territoires ruraux
- 5.28. Les principales vulnérabilités du tourisme rural face au changement climatique
À mi-chemin entre la mer et la montagne, les espaces ruraux de notre région attirent de nombreux touristes même
si les affluences et flux ne sont souvent pas comparables à ceux du littoral. Le tourisme rural a la particularité de
proposer une philosophie et une offre d’activités différentes alliant détente, repos, sport, authenticité, découverte du
patrimoine, dégustation de produits du terroir, bien-être, points d’eau pour se rafraîchir… La moindre fréquentation
est à relativiser car si les touristes sont répartis sur de vastes territoires, la renommée des sites remarquables génère des pics de fréquentation à certaines périodes de l’année qui nécessitent des modalités d’accueil spécifiques
et des aménagements. Face au changement climatique, le tourisme rural est confronté à de nouvelles contraintes.
5.18. Quels loisirs dans les espaces ruraux pour limiter l’empreinte carbone ?
Les chiffres dévoilés au printemps 2021, lors des Rencontres du tourisme durable, témoignent de la volonté des touristes de se diriger vers des pratiques plus durables : 61 % des Français se disent davantage préoccupés par la préservation de la nature et de l’environnement depuis la pandémie Covid-19 et aspirent à adopter de nouvelles pratiques et habitudes pour réduire leur empreinte carbone durant leurs vacances. Les espaces ruraux concentrent un tiers des séjours des Français et l’équivalent de leurs nuitées, et correspondent à une réelle demande des visiteurs, en particulier des publics citadins.
Certains espaces ruraux, grâce aux réseaux de gestionnaires d’espaces naturels ou aux sites patrimoniaux, comme les parcs nationaux ou les parcs naturels régionaux, promeuvent désormais un tourisme durable et responsable. En concertation avec les acteurs locaux privés et publics, des aménagements et des services les rendent accessibles en excluant l’usage de la voiture, avec des modes de transports publics, des navettes spécifiques, des réseaux cyclables et voies vertes… Dans le Parc naturel régional du Luberon, depuis 25 ans, l’association Vélo Loisir Provence a réalisé un important travail de structuration des itinéraires à vélo (tours du Luberon ou des Ocres, Pays de Forcalquier Montagne de Lure, Gordes, Pays d’Aigues, Véloroute du Calavon) à destination des visiteurs et des habitants. Un espace VTT Provence Luberon Lure labélisé FFC (Fédération française de cyclisme) a été créé en 2020 regroupant 63 circuits balisés et 2 grandes itinérances (L’Alpes-Provence et la Grande Traversée de Vaucluse).
La randonnée constitue un loisir largement plébiscité par les touristes avec un réseau d’itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) dans le Luberon de plus de 3000 km, composé de 8 GR et 3 GR de Pays. Les itinéraires équestres représentent plus de 500 km, comptent une vingtaine de circuits identifiés et 2 grandes itinérances. La pratique de l’itinérance à pied, à vélo ou à cheval favorise les modes de déplacement doux des visiteurs ce qui permet d’agir contre la pollution atmosphérique (rejets de polluants très limités) et le réchauffement climatique (moins d’émissions de GES). L’escalade, les sports nautiques et d’eaux vives complètent une offre touristique dans les espaces ruraux peu émettrice de GES et adaptée aux enjeux de préservation de l’environnement, de la biodiversité et des paysages. Cependant, une pratique non maîtrisée des activités de pleine nature est potentiellement source d’impacts écologiques significatifs et nécessite une régulation de la fréquentation touristique de certains sites emblématiques (calanques, ocres, gorges du Verdon, par exemple). L’objectif est d’accompagner le développement raisonné des loisirs et sports de nature dans les espaces ruraux, en privilégiant la création, l'entretien et la qualité des équipements structurants de loisirs supportables à long terme sur le plan écologique et d’assurer leur promotion tout en sensibilisant les pratiquants.
Un réseau de professionnels du tourisme bénéficiant de la marque Valeurs Parc naturel régional (Photo 18) et Esprit parc national encourage les visiteurs à adopter des comportements vertueux en matière d’économies d’énergie, de consommation d’eau pour réduire l’impact carbone et assurer la transition écologique (dont énergétique) des territoires.

Info+
La Métropole Aix-Marseille-Provence disposera d’un nouveau schéma métropolitain d’organisation et de développement du tourisme au cours de l’été 2024. La volonté affichée est d’engager les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), avec ses partenaires, dans une démarche de développement durable et de valoriser tous ses territoires, dont les espaces ruraux, grâce à une mise en avant de leurs atouts et une meilleure répartition géographique des touristes (assortie d’une régulation des flux) tout au long de l’année. L’expérience de vivre le territoire comme les habitants (qui deviendraient les premiers hôtes) serait proposée aux visiteurs.
5.19. Le développement du slow tourisme dans les territoires ruraux
Le slow tourisme est un mouvement qui privilégie la découverte en profondeur d’un territoire et de ses acteurs, à un rythme lent. Pour certains publics, il offre une alternative à l’accumulation de visites et activités, et à la consommation passive souvent associées au tourisme de masse.
La crise de la Covid-19 a initié une certaine relocalisation des séjours touristiques, comme la crise écologique qui devient une interrogation prégnante même en temps de vacances. Donner un sens à ces dernières, ralentir, apprendre, contribuer à la vie locale ou encore expérimenter des pratiques alternatives souvent transposables à la vie quotidienne (transports doux, pratiques sensorielles, corporelles et alimentaires…) sont autant de motivations pour les amateurs du slow tourisme. Du côté des territoires et des professionnels, cette forme de tourisme est une approche séduisante car elle offre une « vraie » rencontre avec les visiteurs, valorise les savoir-faire et les patrimoines tant humains que naturels, lors de séjours souvent plus longs et à forte valeur ajoutée. Pour les territoires ruraux et de montagne, le slow tourisme est aussi un moyen de répondre aux enjeux climatiques et environnementaux, alors que le tourisme de masse est actuellement décrié et mis à l'épreuve de l’adaptation, de l’atténuation et de la diversification.
L’immersion est souvent un maître-mot pour les adeptes du slow tourisme. Elle peut se traduire par des activités décalées qui mettent les participants à contribution grâce aux sciences participatives ou à travers une « épreuve » consentie et mesurée, comme dormir dans un refuge ou en bivouac. Ce type d’expérience mêlant sobriété, partage (Photo 16) et acquisition de compétences et d’autonomie change le regard posé par le visiteur sur le territoire et la nature. L’immersion permet de dépasser la « nature-décor » et d’acculturer en profondeur les visiteurs aux réalités locales, répondant ainsi aux reproches souvent adressés par les habitants au tourisme de masse ou exclusivement sportif.
Pour éviter les écueils du tourisme de masse, il est nécessaire d’évaluer collectivement les impacts des séjours touristiques proposés (quid de la multiplication des bivouacs par exemple ?), d’échanger et de collaborer afin que les retombées économiques sur le territoire rural soient optimales sur le long terme.

Zoom 5. L’agritourisme, entre diversification des activités agricoles et tourisme à échelle humaine
L’agritourisme (ou agrotourisme) concerne les activités et la vente directe à la ferme, et les séjours immersifs dans les exploitations agricoles. Son principal intérêt est de permettre la visite des fermes, la rencontre avec les agriculteurs et éleveurs, la découverte de métiers parfois ancestraux, les modes de vie ruraux, les savoir-faire, les spécialités culinaires, les traditions et cultures locales, etc., et de favoriser les circuits (très) courts qui réduisent les émissions de GES. Cette pratique, bénéficiant d’aides financières régionales, nationales et européennes, grandit, mais elle est encore très minoritaire dans les exploitations agricoles.
Bienvenue à la ferme, marque des chambres d’agriculture, et Accueil paysan, association valorisant l’agriculture paysanne, sont les deux principaux réseaux nationaux qui orientent les touristes vers les sites d’accueil pour, par exemple, déguster et acheter des produits du terroir (fruits et légumes [Photo 17], huile d’olive, vin…) ou apprendre à fabriquer du fromage. Les fermes accueillent principalement des familles, des classes scolaires, mais aussi les curieux qui recherchent un tourisme alternatif, loin des sites surfréquentés.
Cette forme de tourisme offre, dans une majorité des cas, des tarifs raisonnables et procure jusqu’à la moitié des revenus des agriculteurs, à condition que ces derniers respectent la règlementation (accès handicapés, hygiène alimentaire…).
Cette diversification des activités pour les exploitants agricoles joue un rôle social et économique essentiel dans les territoires ruraux, et contribue souvent à la protection de l’environnement (agriculture biologique par exemple). Dans la région, les acteurs de l’agritourisme peuvent bénéficier de la marque Valeurs Parc naturel régional qui promeut les pratiques durables dans les parcs naturels régionaux.
Photo 17. Potager d’une ferme proposant un gîte (© Olives en Provence).

5.28. Les principales vulnérabilités du tourisme rural face au changement climatique
Le tourisme rural présente des vulnérabilités climatiques qui conduisent à une évolution générale des pratiques. Pour compléter les éléments suivants, se référer aux cahiers du GREC-SUD.
Des conditions climatiques plus contraignantes
Depuis 1960, l’évolution rapide du climat dans les espaces ruraux présente des caractéristiques similaires à celles du littoral et de la montagne. Dans le parc naturel régional du Luberon, par exemple, le nombre de jours anormalement chauds a bondi de 8 à plus de 70 jours en moyenne par an à Apt, entre la fin des années 1960 et aujourd’hui. Les vagues de chaleur, quasi absentes avant les années 1980, se multiplient ces dernières années avec plus de 22 vagues de chaleur en moyenne par an. Les pics de chaleur peuvent dépasser 40 °C (à Cabrières d’Avignon, 43,2°C le 28 juin 2019), ce qui accentue les îlots de chaleur urbains, même dans les villages du Parc. Pour les cumuls de précipitations, les tendances générales sont contrastées selon les saisons : -30 % en hiver, +10 à +20 % au printemps, -45 à -20 % en été, +10 à +20 % en automne. De manière générale, la diminution des précipitations en été se traduit par une fragilisation de la ressource en eau avec une augmentation du nombre de jours de débit faible ou d’assecs (absence d’eau) des cours d’eau et de basses eaux des nappes phréatiques se rechargeant difficilement. L’accès à l’eau potable est même remis en question l’été dans certaines communes du Var, par exemple. L’eutrophisation des écosystèmes aquatiques (lacs, étangs, rivières…), le dépérissement des forêts et le renforcement du risque incendie (le nombre de jours de fermeture des massifs forestiers a tendance à augmenter) sont aussi des réalités. L’agriculture est sous tension avec des conflits d’usages, le gel tardif à répétition (perte de récoltes), la difficile adaptation des cultures… L’urbanisation des espaces ruraux accentue aussi leur vulnérabilité (risque d’inondation renforcé).
D’ici 2050, ces phénomènes s’aggraveront, quel que soit le scénario socio-économique du GIEC. Le changement climatique peut provoquer à terme une mutation des paysages ruraux et de leur identité si appréciée par les touristes, une aggravation des risques sanitaires (malaises, hospitalisations, surmortalité…) avec des températures maximales en été susceptibles de dépasser 47 °C en cas de scénario pessimiste, une moindre capacité des sols agricoles et forestiers et de la biomasse à séquestrer du carbone, un accroissement du nombre d’espèces invasives pouvant perturber la faune et la flore, les chaînes alimentaires... L’artificialisation des sols (constructions de bâtiments, d’infrastructures routières, etc.) des espaces ruraux, grignotés par la périurbanisation et l’accueil de néoruraux attirés par les paysages agricoles et naturels, questionnent aussi les usages récréatifs et touristiques. Et la ressource en eau devient une source de tensions entre agriculteurs, entrepreneurs, acteurs de l’énergie, industriels, habitants et professionnels du tourisme.
Une évolution des pratiques touristiques dans les espaces ruraux
Longtemps un atout, le climat pourrait devenir un handicap dans les espaces ruraux régionaux. En France, le réchauffement climatique pourrait en effet orienter les flux touristiques vers la mer Méditerranée, l’océan Atlantique ou la Manche pour les amateurs de baignade et de fraîcheur ou en montagne (altitude, forêts, cours d’eau…), même si les contraintes climatiques affecteront, à des degrés divers, tous les territoires. En été, les touristes français et internationaux, dont la clientèle âgée plus vulnérable, pourraient choisir des destinations situées au nord de l’Europe ou dans l’hémisphère Sud pour des raisons de bien-être et de santé, ce qui renforcerait les émissions de GES si les modes de transport n’évoluent pas ou peu.
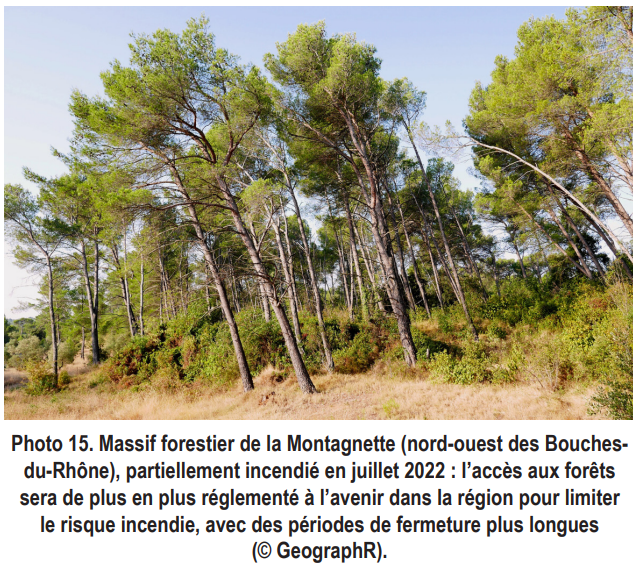
Dans les espaces ruraux, en saison estivale, les contraintes climatiques feront évoluer la pratique des activités sportives de plein air (vélo, escalade, randonnée, trail…). Les guides, par exemple, programment déjà des randonnées pédestres en tout début de journée ou en soirée pour garantir le confort thermique des touristes. Les épisodes de sècheresse limiteront la pratique des sports nautiques (canoé, canyoning…), l’utilisation des plans d’eau et des lacs pour la baignade et les jeux aquatiques. La multiplication des évènements extrêmes (feux de forêts, sécheresses, épisodes méditerranéens, glissements de terrain…) et/ ou la répétition de conditions climatiques défavorables (stress hydrique chronique ponctué de brefs épisodes de pluie par exemple) restreindraient, voire empêcheraient, certaines activités touristiques (balades en forêt par exemple, Photo 15), parfois sur de longues périodes, gêneraient l’approvisionnement de sites, et pourraient favoriser la destruction d’infrastructures (routes, hébergements…). Dans ces conditions, le tourisme dans les espaces ruraux centré sur la période estivale pourrait devenir une source de tensions. Hors été, la situation serait bien plus propice avec des flux touristiques qui se concentreraient sur les ailes de saison (avril-juin, septembre-novembre), à condition d’adapter l’offre à cette nouvelle clientèle.
Le secteur du tourisme doit inventer de nouveaux modèles en misant sur l’adaptation et l’atténuation dans les domaines suivants : le transport, la rénovation thermique des logements touristiques, la ressource en eau, la biodiversité, les incendies, l’agriculture, l’alimentation et le développement des énergies renouvelables.
Sommaire du cahier
- Introduction générale
- Le tourisme régional au coeur des enjeux actuels
- Le tourisme côtier face au changement climatique
- Le tourisme de montagne face au changement
- Le tourisme des territoires ruraux face au changement climatique
- L'attractivité touristique de nos villes dans un contexte de changement climatique
- Quelles pistes pour réinventer le tourisme ?
- Conclusion
- Contributeurs