Pour atteindre la neutralité carbone et faire évoluer les pratiques, les acteurs du tourisme côtier régional doivent faire des choix stratégiques. Les actions durables des professionnels se multiplient et la responsabilité des visiteurs s’affirme, mais le tourisme reste un secteur économique encore fortement émetteur de GES. Pour inverser définitivement la tendance et se donner des perspectives désirables et réalistes, une démarche prospective a été engagée par le Plan Bleu, l’un des centres d’activités régionales du Plan d’action pour la Méditerranée (PAM) du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), avec le soutien financier de l’ADEME régionale et l’appui technique de GeographR, pour dessiner des évolutions contrastées du tourisme côtier, de la Camargue à la frontière italienne. Cette initiative s’inscrit dans un processus régional en Méditerranée avec l'exercice de prospective MED 205019. À travers un état des lieux et des récits prospectifs se basant sur les scénarios Transition(s) 2050 de l’ADEME, l’étude20 propose quatre chemins :
- la génération frugale (S1, Figure 5a) : la « gourmandise de la simplicité » est privilégiée par les acteurs du tourisme. La sobriété énergétique et foncière, la préservation des ressources naturelles et des terres agricoles, la relocalisation des biens, services et personnes, l’usage des matériaux biosourcés, l’intermodalité du transport, la baisse drastique du trafic aérien, le nombre décroissant de résidences secondaires, la gestion partagée des risques (pénurie d’eau, incendie…), l’urbanisme responsable, le stockage de carbone dans la biomasse et les sols, la restauration collective des touristes intégrée aux projets alimentaires territoriaux, etc. façonnent le tourisme durable côtier ;
- les coopérations territoriales (S2) : les « Artisans du mouvement coopératif » ont mis en place un schéma régional universel de transition écologique, qui fusionne tous les plans, schémas et lois, et facilite la gouvernance multi-échelles. Les actions se concentrent sur le transport (prise en charge des touristes dès leur arrivée, mise à disposition d’omnibus privatifs, régulation du trafic aérien…), la rénovation énergétique des hébergements touristiques et des sites d’accueil, l’électrification des quais portuaires, la désimperméabilisation des sols, la défiscalisation partielle des EnR, la relocalisation progressive des biens et personnes... La décarbonation des modes de production et de consommation et la concertation territoriale sont les priorités ; les technologies vertes (S3, Figure 5b) : les « Aventuriers verts » s’appuient sur les entreprises et les technologies vertes. Le nombre de nuitées touristiques et le trafic des aéroports croissent, les collectivités, avec l’appui des acteurs économiques, aménagent les villes côtières et protègent habitants et visiteurs des aléas climatiques. Des digues flottantes ou en béton sont installées pour protéger le littoral. Les biens et services menacés, situés en première ligne sur le littoral, sont reconstruits sur pilotis. Les solutions technologiques sont mises en œuvre grâce aux financements publics et privés. Les visiteurs viennent des quatre coins du monde en avion (carburant vert), bateau de croisière hydride… ; le pari réparateur (S4) : les « Bâtisseurs » ne veulent pas renoncer aux modes de vie d’aujourd’hui. La réduction des émissions de GES (décarbonation des transports, captage direct du CO2 , rénovation thermique des hébergements…) est encouragée, mais les autorités publiques laissent le temps aux acteurs du tourisme de faire évoluer leurs pratiques. Tout le littoral est protégé par une digue en béton et des villes partent à la conquête de la mer. Face à l’augmentation du nombre de touristes et de la demande énergétique, les EnR complètent le système de production nucléaire. Les touristes sont à l’abri des aléas climatiques : refuges, climatisation, ombrage et brumisation des rues, désalinisation de l’eau de mer, surélévation d’aéroport…
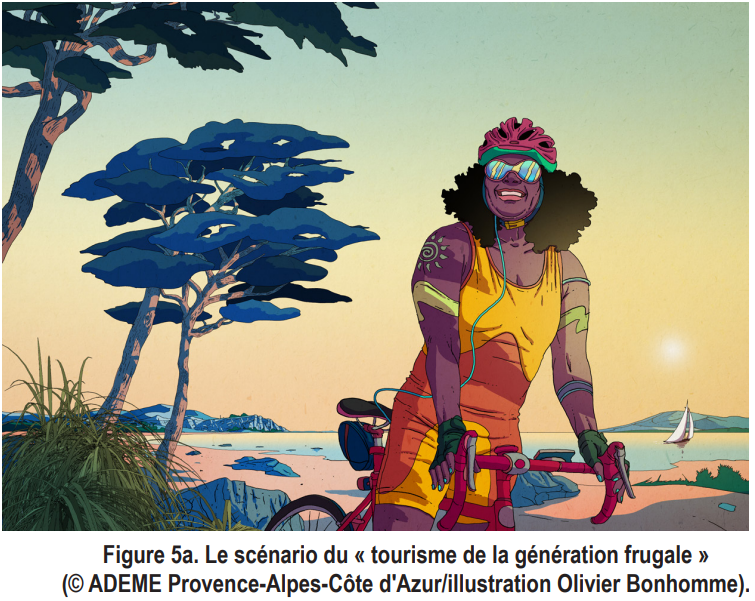
Pour atteindre la neutralité carbone, la sobriété s’avère facilitatrice tout en réduisant les risques et les menaces. Le pari réparateur (S4) est le scénario le plus hasardeux car il provoquerait de graves impacts environnementaux sans commune mesure avec les S1 et S2 qui misent sur la soutenabilité. De manière générale, les scénarios technologiques (S3 et S4), qui ne remettent pas en cause (ou peu) nos modes de vie actuels, reposent partiellement sur des technologies aujourd’hui peu matures, en particulier S4, avec le captage du CO2 dans l’air, qui rend sa réalisation très risquée.
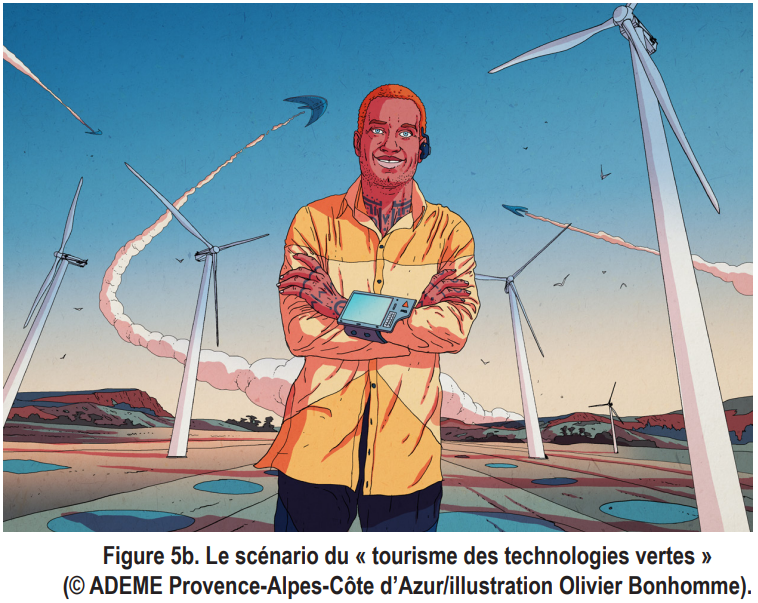
Ces quatre scénarios, ne présentant pas les mêmes garanties pour atteindre la neutralité carbone, offrent une certaine vision du tourisme côtier en vue d’anticiper le futur, questionner l’ensemble des acteurs du tourisme et faciliter la mise en débats des politiques et stratégies touristiques, mais aussi territoriales, susceptibles d’accompagner la transition écologique.
Sommaire du cahier
- Quelles sont les principales évolutions climatiques sur le littoral ?
- La relocalisation des biens, services et personnes en question
- La prise en compte du tourisme dans les PPRN : les exemples de Villeneuve-Loubet et Fréjus
- Quels enjeux de l'évolution de la saisonnalité du tourisme littoral ?
- Quatre scénarios pour le tourisme côtier régional