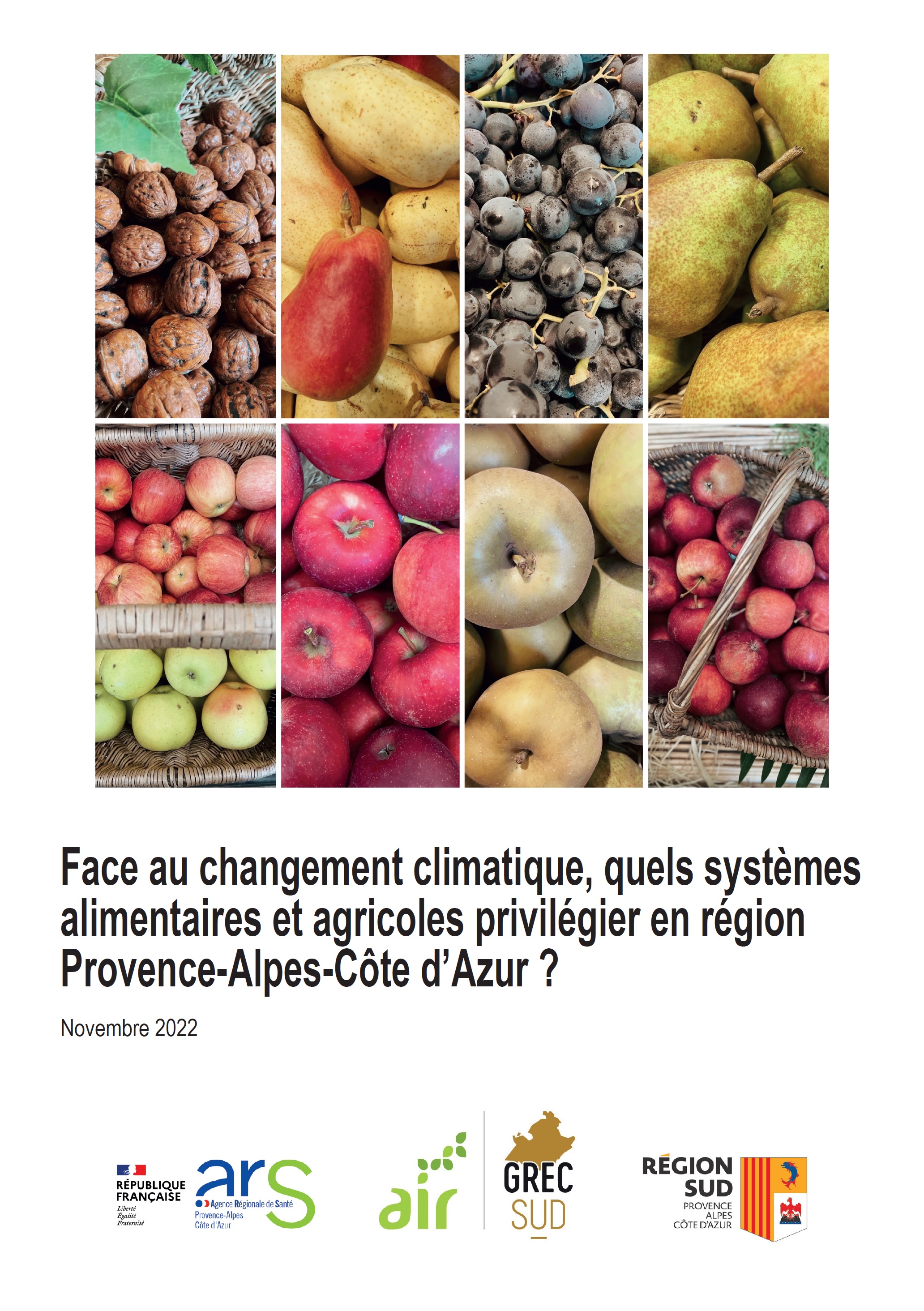Face au changement climatique, les systèmes alimentaires et agricoles sont exposés à de nombreux risques susceptibles de déstabiliser nos sociétés. Pour réduire leur vulnérabilité et renforcer leur résilience, il est nécessaire de faire évoluer les pratiques et de réinventer nos modes de production et de consommation, de la terre à l’assiette.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, des acteurs régionaux publics et privés se mobilisent pour réduire les émissions de GES, développer des systèmes alimentaires territorialisés favorisant la production et la consommation locales, améliorer la qualité des aliments, privilégier les ré-
gimes alimentaires qui protègent la santé et l’environnement, renforcer le lien social et économique entre toutes les parties prenantes… Pour contribuer à leurs efforts, 46 spécialistes de l’alimentation et de l’agriculture font un état des connaissances actuelles, partagent leurs expériences et apportent des solutions pour changer la donne.
> cliquez sur l'image ci-dessous pour télécharger le cahier au format pdf
Sommaire
Sommaire du cahier
- Résumé
- Introduction générale
- Les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture
-
L'alimentation régionale au cœur des problématiques sanitaires et climatiques
- Production et consommation alimentaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Quelles sont les évolutions générales de nos pratiques alimentaires et agricoles dans les régions françaises ?
- La durabilité et la résilience dans les systèmes alimentaires territorialisés
- Quelle est l’empreinte carbone de l’alimentation et de l’agriculture régionales ?
- Quels sont les régimes alimentaires et recommandations nutritionnelles ?
-
Des pistes pour changer nos systèmes agri-alimentaires
- Comment réinventer la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur ?
- Tendre vers la souveraineté alimentaire
- Quelles pratiques agricoles pour s’engager dans la transition agroécologique et optimiser la séquestration du carbone ?
- Les exploitants agricoles qui s’engagent dans la transition énergétique
- Vers une aquaculture fondée sur la durabilité et l'économie circulaire
- Plus de repas végétariens à la cantine : double pari pour la nutrition et l’environnement
- Les mesures sociales et collectives pour accélérer les transitions alimentaires et agricoles régionales
- Pour conclure...
- Contributeurs
-
Résumé
Face au changement climatique, et plus largement au changement global, nos systèmes alimentaires et agricoles, complexes et inégalitaires, sont fragiles. Leur robustesse est conditionnée par le type d’agriculture, la consommation et les régimes alimentaires associés, le transport, la transformation et la commercialisation des produits, les pollutions eau-sol-plante-atmosphère, la météorologie, le climat, le portage politique, l’organisation socio-économique... Aujourd’hui, le système « agriculture-alimentation » n’est ni satisfaisant, ni durable, aussi bien à l’échelle mondiale que locale. Nos modèles alimentaires et agricoles, encore dominés par l’agriculture intensive, les spécialisations, les mécanismes et procédés industriels, la mondialisation, sont en danger.
Ces dernières décennies, en France, la surconsommation de produits transformés, viandes, produits laitiers et œufs, émettrice de gaz à effet de serre (GES), défavorable à la santé humaine et aux équilibres des écosystèmes, a augmenté ou reste élevée, tandis que celle des produits bruts a diminué. Par personne et par an, le régime alimentaire moyen actuel génère entre 1400 à 1800 kg eqCO2 d’émissions de GES, nécessite 4000 à 4500 m2 de surface agricole et une consommation d’énergie de 6000 mégajoules, loin de toute soutenabilité. Par ailleurs, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur exporte 61 % de sa valeur agricole produite, alors que la consommation de produits agricoles et agroalimentaires est principalement issue d’importations.
Pour éviter des crises majeures et une déstabilisation des chaînes de production ces prochaines années, il est nécessaire de transformer nos systèmes alimentaires et agricoles, aux échelles régionale et territoriale, avec la volonté de répondre aux besoins des habitants, préserver leur santé, valoriser des pratiques agricoles et alimentaires à faible empreinte carbone, protéger les agrosystèmes, stopper l’érosion et la dégradation des sols et de la biodiversité, privilégier la qualité et le goût, réduire les inégalités sociales, contribuer aux efforts des acteurs régionaux publics et privés engagés dans l’amélioration des pratiques au quotidien… Le but est de basculer d’un système destructif de l’humanité et de l’environnement à un système agroécologique et plus juste. Ce dernier passe notamment par :
- Une alimentation à base végétale, plus saine et durable, respectant les recommandations nutritionnelles ;
- Des régimes alimentaires moins énergivores et plus équilibrés. En ce sens, le régime méditerranéen « traditionnel » favorable à la santé est vivement recommandé dans notre région : consommation de produits végétaux (céréales peu raffinées, légumes secs, légumes et fruits frais de saison, noix, amandes, huile d’olive), de plantes aromatiques (ail, thym, romarin, marjolaine...), de poissons, de produits laitiers et volailles en quantité raisonnable, charcuteries, viandes rouges et produits sucrés en faible quantité ;
- Le développement de l’agroécologie, de l’agroforesterie, de l’agriculture biologique, et des circuits courts, même si la région est plutôt plus avancée que d’autres en France ;
- Une sélection de variétés de cultures résistantes au changement climatique et aux événements climatiques extrêmes ;
- Des productions diversifiées, avec des rotations réduisant l’apport d’engrais et l’usage de produits phytosanitaires ;
- Une agriculture locale faiblement émettrice de gaz à effet de serre, préservant les ressources locales au détriment des produits importés subventionnés ;
- Mettre en place des pratiques agricoles séquestrant davantage de carbone dans les sols ;
- Produire et consommer des énergies renouvelables ;
- Privilégier l’économie circulaire et l’innovation pour rendre les systèmes plus durables et résilients (aquaculture par exemple) ;
- Tendre vers la souveraineté alimentaire pour éviter de subir des systèmes mondialisés incohérents, augmenter nettement l'autosuffisance alimentaire ;
- Le développement de systèmes alimentaires territoriaux : maintien des petites fermes, reconnexion des citoyens avec la vie et les besoins d’un environnement productif… ;
- Un accès facilité à la terre pour tous pour éviter les discriminations ;
- La formation des acteurs des filières alimentaires et agricoles pour accélérer les changements de pratiques ;
- La sensibilisation des citoyens pour orienter leurs choix alimentaires et élever leur degré d’exigence en matière de nourriture, nutrition, qualité et environnement…
Cette liste non exhaustive montre combien le chemin à parcourir est encore long, mais des signes encourageants se manifestent. Les critères de choix en faveur de la santé et l’environnement prennent de plus en plus d’importance dans la société, comme en témoignent l’augmentation de la production et de la consommation de produits biologiques, et l’attrait croissant des consommateurs pour les produits locaux et les circuits courts.
Les ruptures vis-à-vis des systèmes alimentaires et agricoles impliquent une approche territoriale multi-échelles et collective. Rien ne sera possible sans l’adhésion de tous les acteurs des filières alimentaires et agricoles (du paysan à l’industriel, de l’épicerie de quartier aux centres commerciaux), des restaurateurs, des acheteurs… Les décideurs à l’échelle territoriale ont aussi un rôle majeur à jouer pour orienter les politiques locales, tout en s’appuyant sur la réglementation (loi Égalim, projets alimentaires territoriaux, restauration collective…) et les recommandations nutritionnelles françaises et internationales. Rendre les systèmes alimentaires et agricoles régionaux plus attractifs, durables et résilients nécessite une réflexion globale sur les processus qui lient production, distribution, consommation et alimentation, et une adhésion croissante de la société.
Pour réussir les transitions alimentaires et agricoles, garantir la sécurité alimentaire et lutter contre le changement climatique, il est primordial de réinventer nos systèmes aujourd’hui souvent dépassés. L’alimentation a une dimension sociale, culturelle, symbolique et politique. Son accessibilité dépend de notions complexes qui dépassent la proximité géographique ou le prix. Il faut prendre en compte les contraintes pratiques (absence de cuisine fonctionnelle, mobilité difficile) et les besoins (adéquation des denrées avec les préférences, habitudes et croyances). En ce sens, il est important de soigner les diagnostics territoriaux, en restant à l’écoute des bénéficiaires et participants, en vue d’adapter les initiatives en fonction des perceptions et des attentes. Les démarches de concertation, l’inscription des publics ciblés dans les processus décisionnels et l’implication des usagers bénévoles sur les lieux de vente soutiennent l’implication citoyenne dans les systèmes agri-alimentaires…
Des mesures fortes sont également à explorer comme la mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation, encouragée par des scientifiques et des politiques, qui, comme la sécurité sociale de la santé, serait financée par la cotisation sociale. Le renforcement des projets alimentaires territoriaux (PAT), qui entrent dans une dynamique collective, a pour ambition de faciliter les interconnexions, les complémentarités et les échanges d’expériences, afin d’améliorer la résilience alimentaire régionale, et doit s’accompagner d’ambitions écologiques qui sont à ce jour limitées.
Il est temps de mobiliser les acteurs des filières alimentaires et agricoles et de passer à l’action. L’urgence climatique est un obstacle supplémentaire au bon fonctionnement des systèmes, mais il est surmontable, au moins partiellement, si les émissions de gaz à effet de serre sont massivement réduites à court terme, si l’agriculture se tourne vers l’agroécologie, si l’alimentation se végétalise… Les changements d’habitudes alimentaires requièrent l’apprentissage de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques. Les situations collectives offrent des contextes idéaux pour agir sur les leviers disponibles tout en créant des situations conviviales facilitant l’interaction et l’apprentissage entre pairs.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est appelée à renforcer ses pratiques agricoles durables. Elle atteindra difficilement l’autosuffisance alimentaire sur l’ensemble des filières d’ici 2050, mais, en prenant des décisions courageuses, elle pourrait davantage couvrir les besoins de la population en valorisant notamment la « modification de l’assiette » et en relocalisant ses débouchés.
-
Introduction générale
L’alimentation est certainement la problématique la plus partagée par les êtres vivants sur Terre. Elle est la préoccupation majeure de tous les êtres humains, au quotidien, pour assurer leur survie, leur santé, leur bien-être et leur plaisir. Se nourrir est un besoin naturel, mais, dans nos sociétés, il n’est ni anodin, ni simple à satisfaire. En effet, derrière la production et la consommation d’aliments bruts ou transformés se cachent des systèmes agricoles, environnementaux, économiques, sociaux, culturels et politiques, qui sont complexes et fortement inégalitaires. Selon les pays, les régions, les localités, les quartiers, les foyers et même les individus, l’alimentation peut être synonyme de sous-nutrition, malnutrition, famine, carence, pauvreté, injustice, détresse, pénurie, surconsommation, gaspillage, richesse, confort, partage, égoïsme, solidarité, santé, maladie, pression, risque, tension, conflit, migration… Elle est au cœur de nos organisations mondiales et locales, et détermine notre présent et notre futur.
Nos systèmes alimentaires et agricoles, de la graine plantée à la bouche, sont fragiles à tous les niveaux, et ce en permanence, même dans les pays les plus riches. Les raisons de cette fragilité sont les suivantes :
- La robustesse des systèmes est conditionnée par la production agricole, l’organisation sociale, la météo, le climat, la quantité, la qualité, le transport, la transformation des produits, la commercialisation, les régimes alimentaires, la concurrence, les crises économiques et politiques… Ces facteurs évoluent en fonction des contextes, des situations, des choix et des impondérables ;
- L’agriculture intensive, avec tous ses travers (appauvrissement des sols, utilisation de pesticides et d’engrais chimiques, mécanisation à outrance, mondialisation des échanges, monoculture, recours aux organismes génétiquement modifiés, etc.) altère la santé des êtres vivants, pollue et détruit les écosystèmes agricoles et naturels, provoque une perte de qualité, de saveurs, de goûts, de repères culturels… ;
- Le changement global (déforestation, modification de l’occupation des sols, pollutions, érosion de la biodiversité…) représente une lourde menace susceptible de déstabiliser sur le long terme nos chaînes de production alimentaire et agricole. Plus spécifiquement, le changement climatique d’origine anthropique, provoqué par les émissions massives de gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, et l’augmentation de la fréquence et de l’intensité des événements climatiques extrêmes (sécheresses, vagues de chaleur, pluies diluviennes, gels tardifs…), combinés aux mutations de nos pratiques alimentaires et agricoles, notamment dans les pays les plus industrialisés, font peser des risques croissants sur nos sociétés ;
- Le surpoids et l’obésité se généralisent et s’amplifient, même dans des pays présentant un niveau de vie modeste, au même titre que les maladies cardiovasculaires, les allergies alimentaires, les cancers…
De manière générale, les enjeux sanitaires et écologiques liés à l’alimentation et l’agriculture sont majeurs. Ils doivent être appréhendés dans leur globalité, de manière transversale, pour éviter des conséquences dramatiques et irréversibles.
Le contexte alimentaire et agricole en France, et plus particulièrement dans notre région Provence-Alpes-Côte d’Azur, est très contrasté. Les besoins alimentaires sont assurés pour la majorité de la population, mais les inégalités sociales sont très marquées mettant en évidence des cas de détresse, et les contradictions sont nombreuses. Par exemple, la qualité de nos produits emblématiques (vin, huile d’olive, fromages, céréales, riz, fruits, légumes, truffes, plantes à parfums et aromatiques…) est reconnue et recherchée, mais nos agriculteurs rencontrent de grandes difficultés économiques et sociales pour vivre décemment ; l’agriculture biologique représente une part significative de notre production agricole régionale (32 %), et nos pratiques agricoles s’éloignent peu à peu des pratiques intensives, mais l’utilisation des pesticides résiste et continue à empoisonner nos écosystèmes et à nous intoxiquer ; pour des raisons essentiellement économiques et logistiques, les productions régionales sont exportées massivement vers d’autres régions et pays, alors que l’autosuffisance alimentaire locale reste très nettement insuffisante. Notre dépendance des systèmes agricoles et alimentaires, et plus largement de la mondialisation, est ainsi manifeste, alors que nous avons les moyens de partiellement nourrir nos habitants. En outre, nos régimes alimentaires se sont peu à peu éloignés de la diète méditerranéenne si favorable à la santé. En effet, nos habitudes alimentaires ont tendance à s’uniformiser et s’inspirent de pratiques en inadéquation avec la préservation de notre santé, de nos agroécosystèmes, du climat, de la biodiversité…
Pour faire un point sur la situation en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et apporter des pistes d’adaptation au changement climatique et d’atténuation des émissions de GES, 46 spécialistes de l’alimentation et de l’agriculture se sont mobilisés pour participer à cette publication du GREC-SUD. L’objectif est de contribuer aux efforts des institutions, collectivités, associations, coopératives, entreprises, agriculteurs, etc. engagés dans l’amélioration des pratiques, mais aussi d’inspirer les acteurs territoriaux pour rendre les systèmes alimentaires et agricoles plus durables et résilients aujourd’hui et demain, en sécurisant les ressources alimentaires, en proposant une nourriture plus saine et en répondant aux besoins d’une population grandissante. Les enjeux sanitaires et écologiques liés à l’alimentation et l’agriculture sont majeurs. Ils doivent être appréhendés dans leur globalité et de manière transversale.
Les enjeux sanitaires et écologiques liés à l’alimentation et l’agriculture sont majeurs. Ils doivent être appréhendés dans leur globalité et de manière transversale.
-
Les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture
À l’heure du changement climatique et des engagements en faveur de la transition écologique, incluant les volets énergétiques, environnementaux, sociaux, économiques et politiques, il est important de s’interroger sur le fonctionnement de nos systèmes alimentaires et agricoles qui sont le reflet de nos modèles socio-économiques et de nos politiques environnementales et sanitaires. Le thème de l’alimentation et de l’agriculture ne laisse personne indifférent car nous sommes tous concernés par la nourriture. Des émissions de gaz à effet de serre à la surexploitation des ressources, en passant par la surconsommation de produits animaux et le gaspillage alimentaire, ce chapitre énonce les principaux enjeux associés aux problématiques croisées de l'alimentation et l'agriculture.
-
Quels sont les défis de l’agriculture et de l’alimentation de l’échelle mondiale à territoriale ?
Il existe mille manières de produire de la nourriture et de s’alimenter, mais le système « agriculture-alimentation » n’est aujourd’hui ni satisfaisant, ni durable, aussi bien à l’échelle globale que territoriale.
Les principales raisons de la fragilité du système agricole sont :
- La baisse du nombre d’agriculteurs, avec agrandissement des fermes et augmentation du nombre de travailleurs précaires, pouvant conduire à la désertification de certains territoires ruraux ;
- La surexploitation de ressources non pérennes par l’agriculture intensive ;
- L’érosion et la dégradation des sols trop souvent nus et profondément labourés : perte de matière organique, détérioration des cycles de l’eau et des nutriments, supports de la croissance végétale ;
- La perte de la compréhension du fonctionnement écologique des agroécosystèmes nourris et protégés par des intrants d’origine synthétique, selon des itinéraires techniques standardisés ;
- La perte de savoirs traditionnels, dont la sélection variétale pratiquée à la ferme ;
- L’élimination des éléments semi-naturels du paysage dont l’utilité n’est plus reconnue ;
- La pollution des systèmes aquatiques due au lessivage des nitrates et des pesticides ;
- La pollution de l’air due aux particules fines et à l’ammoniac émis lors des épandages d’engrais, et aux pesticides ;
- La pollution due à l’utilisation de plastiques sur de grandes surfaces produisant une masse mal gérée de déchets non recyclables ;
- Les maladies professionnelles affectant les personnes manipulant les pesticides ;
- La contamination des populations et des aliments proches des épandages ;
La baisse de la biodiversité des populations d’insectes et d’oiseaux des champs, de la flore des champs, de la vie des sols et des services qui en découlent ;
- La perte de diversité génétique (cultures et élevage) et l’homogénéisation des variétés sélectionnées surtout pour leur haut rendement, nécessitant beaucoup d’intrants ;
- La simplification des paysages favorisant la circulation des maladies et des ravageurs, et la disparition d’agroécosystèmes multifonctionnels (où arbres, animaux et cultures diverses sont associés) de grande valeur culturelle ;
- Les émissions de gaz à effet de serre : l'agriculture représente 19 % des émissions totales (source : CITEPA* ; seulement 2 % dans notre région, « grâce » notamment au poids de l’industrie, du transport et de la production d’énergie) et même plus de 25 % si le système agri-alimentaire complet est inclus. Les émissions de gaz carbonique sont liées à la fabrication d’engrais de synthèse et à l’emploi fréquent de machines ; les émissions de méthane à la fermentation digestive des ruminants et à la culture de riz inondé ; le protoxyde d’azote à l’épandage des déjections issues de l’élevage et l'utilisation d’engrais azotés ;
- La grande vulnérabilité face au changement climatique en lien avec la moindre capacité des agroécosystèmes à absorber et retenir l’eau, et à maintenir un microclimat protégeant des canicules et des tempêtes.
*Par ordre d’importance (chiffres 2019 à 2021) : élevage (environ 50 %), cultures (environ 40 %), tracteurs, engins et chaudières agricoles (environ 10 %).
Le système « agriculture-alimentation » n’est aujourd’hui ni satisfaisant, ni durable.
Le système alimentaire présente quant à lui les lacunes suivantes :
- La trop faible consommation d’aliments végétaux et la forte consommation de produits animaux à bas coût ;
- Les ingrédients de base (farines raffinées, sucre, matières grasses végétales) d’aliments denses en calories, pauvres en fibres et autres nutriments protecteurs, dont la surconsommation fragilise le système immunitaire et augmente le risque de maladies chroniques ;
- La consommation d’une alimentation trop carnée augmentant les risques de maladies cardiovasculaires et de cancers ;
- La surconsommation de produits animaux, en général. La viande de ruminants est la plus émettrice de GES, même si les prairies et parcours, hors surpâturage, séquestrent du carbone ;
- La surconsommation de produits très transformés, avec nombreux additifs ;
- Les aliments très souvent contaminés par des résidus de pesticides (la moitié des aliments végétaux), favorisant de nombreuses pathologies chroniques ;
- La persistance de fortes inégalités sociales de santé liées notamment à un accès économique et physique facilité aux produits gras et sucrés, et à un accès inégalitaire aux fruits et légumes.
Ces multiples points permettent de comprendre les enjeux majeurs auxquels doivent répondre l’agriculture et l’alimentation. Il s’agit de basculer d’un système non protecteur de l’humanité et de l’environnement, contribuant au changement climatique, à un système agroécologique. S’appuyant sur le fonctionnement écologique, ce dernier nourrit sainement et protège les humains, préserve l’environnement dont il dépend, et soutient les acteurs de la transition. Les différents points caractérisant ce système seront détaillés dans cette publication :
- Alimentation saine et durable pour tous : il faut promouvoir un accès physique et économique, égalitaire, à des aliments culturellement désirables issus de modes de production plus durables et à une alimentation diversifiée plus végétale, riche en céréales complètes, légumes secs, fruits et légumes frais, et intégrant des quantités modérées de produits animaux.
- L’élevage restera cependant une importante source de nourriture dans les régions sèches ou froides où les cultures sont difficiles ;
- Agroécologie : il faut soutenir le fonctionnement écologique des agroécosystèmes en multipliant les interactions bénéfiques entre le sol, les arbres, la diversité gérée (polyculture-élevage) et la biodiversité hébergée dans les agroécosystèmes. L’agroécologie favorise l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre et l’adaptation au changement climatique ;
- Besoin de développer des systèmes alimentaires territoriaux : ces derniers favorisent le maintien de petites et moyennes fermes et leur écologisation, et participent à la reconnexion des citoyens avec la vie et les besoins d’un environnement productif ;
- Protéger l’accès à la terre et la protection de l’environnement qui ne sont pas incompatibles ;
- Ne pas concurrencer l’agriculture locale par l’importation de produits subventionnés.
- Tous ces enjeux dépendent à la fois de la volonté et de la puissance des politiques publiques, et des comportements individuels. Les travaux de recherche et de nombreuses initiatives démontrent qu’un tel système « agriculture-alimentation » est possible et attractif, avec une adhésion croissante de la société.
Il s’agit de basculer d’un système non protecteur de l’humanité et de l’environnement, contribuant au changement climatique, à un système agroécologique.
-
Pourquoi la santé publique et la nutrition sont-elles indissociables ?
Actuellement, les populations subissent le triple fardeau de la malnutrition, et ce à des degrés divers : la sous-nutrition chronique (rare dans les pays développés), les carences ou déficits en nutriments (assez répandus) et le surpoids-obésité en progression (52 % des adultes en France ; une « épidémie mondiale » selon l’Organisation mondiale de la santé) très souvent liée à une alimentation trop abondante et de faible qualité nutritionnelle. Le surpoids-obésité précède une autre épidémie qui est celle des maladies dites « non transmissibles » (ou non infectieuses) qui deviennent progressivement majoritaires dans le monde : maladies cardiovasculaires ou neurodégénératives, cancers, etc. (Figure 1). La pauvreté en est très souvent un déterminant important. De manière générale, une alimentation de faible qualité est une cause majeure de maladies et provoque une partie notable de la mortalité totale.
Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les rapports officiels français, une bonne alimentation repose sur des apports alimentaires en énergie proportionnels aux dépenses physiques, des choix d’aliments variés, riches en nutriments et fibres indigestibles. Or, des études (INCA-3 en France par exemple) montrent qu’une partie non négligeable des populations des pays développés ont des apports en énergie excédentaires, en nutriments (minéraux, vitamines) et en fibres insuffisants, surtout chez les femmes. En effet, le type d’alimentation moyen actuel est de type omnivore, mais avec une forte part d’aliments d’origine animale (viande, charcuterie, produits laitiers) et une proportion de plus en plus importante d’aliments très ou ultra-transformés, à faible qualité nutritionnelle. Contrairement à une idée reçue, ce sont les alimentations à base végétale qui ont les meilleures qualités nutritionnelles. C’est pourquoi, depuis des décennies, l’OMS et les recommandations françaises (Programme national nutrition santé, PNNS) insistent sur la nécessité de végétaliser son alimentation, de limiter les aliments très raffinés (par exemple, aliments ultra-transformés), le sel, le sucre et les boissons sucrées et les aliments trop gras.
Cette insistance sur les recommandations s’explique par l’impact des mauvaises habitudes alimentaires sur la santé publique et le bien-être des populations.
En effet, des alimentations aux qualités nutritionnelles insuffisantes favorisent les principales pathologies non infectieuses en lien avec le développement récent des sociétés, abandonnant les bienfaits des alimentations traditionnelles (souvent à base végétale) dont les effets bénéfiques sur la santé sont démontrés (alimentation méditerranéenne ou alimentation asiatique par exemple). Une bonne alimentation est aussi nécessaire pour prévenir des maladies infectieuses ou leur gravité.
L’OMS et les recommandations françaises insistent sur la nécessité de végétaliser son alimentation, de limiter les aliments très raffinés, le sel, le sucre, les boissons sucrées et les aliments trop gras.
Cependant, les aliments végétaux usuels sont très souvent contaminés (48 % en moyenne) par des résidus de pesticides en mélange, et les effets négatifs des pesticides chimiques sur la santé humaine (sans oublier celle des écosystèmes) sont progressivement établis. Ceci conduit maintenant à favoriser les aliments végétaux biologiques qui sont recommandés, car ils sont très peu contaminés et leur consommation régulière a des effets protecteurs contre le surpoids, l’obésité et certaines pathologies chroniques.
-
L’alimentation, l’un des piliers des cultures et des traditions dans le monde
Le répertoire et les interdits alimentaires – ce qu’une société s’autorise ou non à manger et à boire – et plus encore les façons de transformer et de cuisiner les produits, et les habitudes de table, sont des pratiques éminemment culturelles. Si plusieurs sociétés peuvent manger les mêmes produits agricoles, elles se différencient par les modes de préparation et de consommation. Ce marquage culturel se lit aussi dans les façons de penser l’alimentation. Celle-ci nous relie à la biosphère et les rapports aux animaux ou aux paysages varient d’une société à l’autre. Elle nous maintient en bonne santé et l’importance accordée à cette préoccupation par rapport à d’autres (sociales, hédoniques ou identitaires) varie également selon les cultures. Elle organise la gestion des ressources dans la production agricole, le commerce et la cuisine. La répartition selon le genre de ces activités diffère en fonction des sociétés, même si l’on retrouve des invariants comme celui du travail et de la charge mentale des femmes vis-à-vis de la cuisine.
Avec la mondialisation des échanges, la diffusion de produits industriels, de modèles de distribution (supermarchés) ou de restauration (rapide), d’informations via internet et les réseaux sociaux, se pose la question d’une possible uniformisation de notre alimentation. Allons-nous perdre des spécificités culturelles, abandonner des produits de terroirs, standardiser notre alimentation ? Certains observateurs parlent de « coca-colonisation », soulignant à la fois la domination croissante de quelques grandes firmes et le développement de la « malbouffe » que certaines d’entre elles véhiculent. À regarder de près les styles alimentaires, force est de constater que si, d’un côté, se perdent des aliments ou des spécialités culinaires, d’un autre côté, s’incorporent de nouveaux aliments dans nos répertoires gastronomiques.
Parfois oubliés un temps et revisités aujourd’hui, les usages et les cuisines qui s’inspirent de diverses sources géographiques et culturelles se réinventent et prennent de nouvelles formes. L’alimentation est un ensemble vivant où chaque pays et plus encore chaque ville inventent son alimentation contemporaine avec de plus en plus de préoccupations environnementales, sociales, sanitaires et politiques. Dans notre contexte régional, l’alimentation été façonnée depuis des millénaires par les apports des Grecs, Romains, Arabes, Américains… Les brassages migratoires ont plus récemment accentué certains traits avec des recettes venant du Sud (couscous, paëlla, pizza) ou du Nord (steak-frites, sauces à la crème…). Le modèle méditerranéen « traditionnel », inscrit au patrimoine mondial immatériel de l’humanité par l’Unesco en 2010, est devenu un modèle de référence international soutenu par les connaissances scientifiques et médicales actuelles. Mais à présent, seule une minorité des populations des pays méditerranéens y adhère.
Le modèle méditerranéen à base d’aliments végétaux produits localement est devenu un modèle de référence international.
Zoom 1. Le vocabulaire de l’alimentation
Circuit court alimentaire (définition du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire) : mode de vente de produits agricoles et alimentaires mobilisant au plus un intermédiaire entre le producteur agricole et le consommateur. Un circuit court peut être de plus « local » ou « de proximité » lorsque le producteur agricole et le consommateur sont proches géographiquement (sans distance définie a priori, mais en général ne dépassant pas l'échelle régionale).
Précarité alimentaire (Paturel D., 2017, États généraux de l'alimentation, Atelier 12, ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation) : conjonction entre une situation de pauvreté économique et une série d’empêchements socio-culturels et politiques dans l’accès à une alimentation durable.
Résilience alimentaire (Tendall, D.M., et al., 2015) : capacité, dans le temps, d’un système alimentaire à procurer à tous une alimentation suffisante, adaptée et accessible, face à des perturbations variées et même imprévues.
Sécurité alimentaire (World Food Summit, 1996 ; Committee on World Food Security, 2009) : la sécurité alimentaire est assurée lorsque toute la population a un accès physique et économique permanent à une nourriture saine et nutritive, en quantité suffisante, qui répond à ses besoins et préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. La dimension nutritionnelle fait partie intégrante de la sécurité alimentaire.
Souveraineté alimentaire (définition Via Campesina) : droit des peuples à définir des politiques agricoles et alimentaires adaptées à leurs spécificités, sans que celles-ci aient un effet négatif sur les populations des autres pays. Cette notion vient reconnaître le droit des peuples à accéder à une alimentation saine et durable, mais aussi à produire leur propre alimentation, c'est-à-dire à développer leur autonomie alimentaire.
Système alimentaire (définition Louis Malassis) : la manière dont les hommes s'organisent, dans l'espace et dans le temps, pour obtenir et consommer leur nourriture.
-
-
L'alimentation régionale au cœur des problématiques sanitaires et climatiques
L’alimentation évolue avec nos sociétés en jouant un rôle fondamental sur la santé et le climat. Se nourrir n’est pas un geste neutre et ce dernier n’est pas à la portée de tous. Notre assiette est le résultat de toute une chaîne de production et de consommation, complexe, énergivore à divers degrés, composée de profondes ramifications, dépendante de nombreuses variables physiques, biologiques et humaines. Ce chapitre fait un point sur les évolutions générales des pratiques alimentaires et agricoles dans les régions françaises, avant d'aborder de manière spécifique la production et la consommation en Provence-Alpes-Côte d'Azur en mettant l'accent sur nos productions agricoles phares, évalue l'empreinte carbone des différents régimes alimentaires et aborde la durabilité et la résilience dans les systèmes alimentaires territorialisés.
-
Production et consommation alimentaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’enjeu d’une production alimentaire saine, durable et locale est un vrai défi en région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui connaît une forte croissance démographique et un taux élevé de pauvreté, et qui est exposée à des facteurs de risques, comme le changement climatique, les tensions sur la disponibilité des ressources en eau et l’artificialisation des sols, susceptibles d’affecter directement ou indirectement les différentes productions agricoles. Commercialement, la région a développé un marché d’export pour certaines productions, en France et à l’étranger, ce qui lui assure une certaine stabilité économique. Dans ce contexte, il faut concilier à la fois les besoins d’évolution du régime alimentaire, l’adaptation des pratiques agricoles et la stratégie commerciale de certaines filières. La région se caractérise par des productions phares (Figure 4), comme le vin, l’huile d’olive, le riz, l’agneau, les fruits et les légumes. Elle est très bien classée en termes d’agriculture biologique (21 % du nombre d'exploitations), de circuits courts et de produits de qualité (respectivement 42 % et 44 % des exploitations).
Figure 4. Diversité de la production agricole en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (source : Agreste, recensement agricole 2020).
Cependant l’autosuffisance alimentaire globale est faible : les surfaces agricoles, notamment les terres labourables, sont insuffisantes pour nourrir la population et le système alimentaire régional présente une certaine déconnexion entre production et consommation. La région exporte en effet 61 % de sa valeur agricole produite, alors que la consommation de produits agricoles et agroalimentaires est principalement issue d’importations. Les niveaux d’autosuffisance alimentaire6 varient selon les secteurs :
● l’autosuffisance est faible dans des filières où la production est largement inférieure à la consommation. C’est le cas par exemple de l’élevage. Seuls 50 % des achats de lait bovin des industries locales sont issus de la production régionale. Le secteur des œufs et de la viande (porcs, volailles, bovins) est aussi très déficitaire, sauf ovins. Les produits sont en revanche de qualité et ont de fortes aménités environnementales7. Avec peu de surfaces et des rendements faibles, la région doit importer des céréales et des oléoprotéagineux8. Les surfaces diminuent, mais la filière régionale s’avère contrastée, puisqu’elle est exportatrice de produits de boulangerie, de riz, de blé dur et de semoule ;
● l’autosuffisance est bien plus forte en légumes (production deux fois supérieure à la consommation), fruits et produits à base de légumes et de fruits. Pour autant, la part tournée vers le marché local reste modeste avec un export important vers la France et l’Union européenne. La consommation reste largement couverte par des produits importés et la balance commerciale est structurellement déficitaire.
La déclinaison régionale du scénario Afterres20509 (Figure 5) prend en compte les besoins alimentaires de la population régionale actuelle et future, les évolutions probables (pratiques agricoles plus durables, perte de terres agricoles, extension des espaces forestiers, recul des jachères…), mais aussi les spécificités de la région en matière de production agricole au regard de la demande nationale.
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, appelée à renforcer ses pratiques agricoles durables, atteindra difficilement l’autosuffisance sur l’ensemble des filières d’ici 2050, mais elle pourrait davantage couvrir les besoins alimentaires de la population en popularisant notamment la « modification de l’assiette » (en phase avec l’alimentation méditerranéenne et des recommandations alimentaires du Programme national nutrition santé de 2019) et en relocalisant une partie de ses débouchés. Ces orientations sont possibles à condition d’effectuer des choix forts et stratégiques.
La région exporte 61 % de sa valeur agricole produite, alors que la consommation de produits agricoles et agroalimentaires est principalement issue d’importations.
Figure 5. Le taux d’autosuffisance alimentaire, correspondant au taux potentiel de couverture des besoins alimentaires procurés par la production régionale10, en Provence-Alpes-Côte d’Azur par grand groupe d'aliments en 2010 et 2050 (source : Solagro).
-
Quelles sont les évolutions générales de nos pratiques alimentaires et agricoles dans les régions françaises ?
Les consommations alimentaires nationale et régionales ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Les traits majeurs et communs de ces évolutions sont la croissance de la consommation de produits transformés et prêts à consommer, la réduction de la consommation de produits bruts, l’augmentation de la consommation de viande, de produits laitiers et d'œufs, la réduction de la consommation de boissons alcoolisées et la croissance de la consommation de boissons non alcoolisées. À cela s’ajoute une forte augmentation de la restauration hors du domicile. Ces évolutions des choix alimentaires et des prix des produits se sont traduites par une baisse significative du budget affecté à l’alimentation par les ménages. L’alimentation représentait 34 % des dépenses des Français en 1960, à peine plus de 20 % en 2020 (Figure 2).
Figure 2. Part de l’alimentation dans les dépenses de consommation (en %) : évolution entre 1960 et 2020 (source : Agreste, Graph'Agri 2021).
Plus spécifiquement, depuis une dizaine d’années, une baisse d’environ 12 % de la consommation de viande est constatée : elle résulte principalement d’une réduction de la consommation de viande bovine, partiellement compensée par l’augmentation de la consommation de volaille (Figure 3). La proportion de Français qui déclarent être flexitariens3 a un peu augmenté et atteint environ 30 %. Une légère progression du végétarisme4 est notée, mais qui reste très faible, environ 2 %. Ainsi, le régime alimentaire moyen actuel des Français est riche en produits animaux, très transformés et trop pauvres en aliments végétaux et peu raffinés.
Info+
Tendances alimentaires ces dernières décennies :
+ produits transformés et prêts à consommer
+ viande, produits laitiers et œufs
+ boissons non alcoolisées
+ restauration hors domicile
- produits bruts
- boissons alcoolisées
Figure 3. Consommation française de viande5 en kg par habitant et par an (source : Agreste, Graph'Agri 2021).
Les critères de choix des consommateurs restent très liés aux prix des produits, à leur praticité et aux préférences gustatives, tandis que la part des achats en grande distribution, bien qu’en recul, reste très largement dominante. Néanmoins, des critères en faveur de la santé et l’environnement prennent de plus en plus d’importance aujourd’hui, comme en témoignent l’augmentation de la consommation de produits bio et l’attrait croissant des consommateurs pour les produits locaux et les circuits courts. Ces évolutions sont néanmoins modestes.
Du côté de la production agricole, les mutations s’avèrent tout aussi significatives ces dernières décennies : intensification (mécanisation, intrants chimiques, sélections végétales et animales, etc.), spécialisation (à l’échelle des exploitations et des régions agricoles françaises), concentration (réduction du nombre et augmentation de la taille des exploitations) et globalisation (augmentation de la part de la production agricole échangée sur les marchés mondiaux).
Si la modernisation agro-industrielle semble avoir largement rempli sa mission, soit fournir une nourriture abondante et bon marché à une population sans cesse croissante, tout en permettant à la France de structurer un puissant secteur exportateur, nombre de travaux mettent en évidence ses limites et vulnérabilités : déficit commercial croissant pour les fruits, les légumes et les produits agroalimentaires hors boissons (vins), impacts négatifs des pratiques agricoles intensives sur le climat, la biodiversité et la qualité de l’eau et des sols, impacts des intrants chimiques et produits ultra-transformés sur la santé humaine (obésité par exemple), effondrement de l’emploi agricole, précarisation de la profession induite par les déséquilibres du partage de la valeur au sein des filières, distanciation croissante entre les territoires et leur alimentation…
-
La durabilité et la résilience dans les systèmes alimentaires territorialisés
Urbanisation, développement des cultures d'exportation entrant en concurrence avec les cultures dédiées à la consommation locale, intensification des systèmes de production, abandon de terres agricoles, évolution rapide du climat, crise écologique, etc. : quelles sont les conséquences de ces changements sur les systèmes alimentaires et agricoles, mais aussi l'autosuffisance alimentaire des territoires, aux échelles méditerranéenne et régionale ?
Le développement de systèmes alimentaires territorialisés présente des enjeux en matière de durabilité et résilience. L'expansion et l'intensification des productions déconnectées spatialement des zones de consommation urbaines ne favorisent pas l'autosuffisance alimentaire locale, sauf si ces productions sont accompagnées de politiques publiques adaptées aux spécificités territoriales et aux conditions du changement. Contrairement au présupposé associant productivité agricole et satisfaction des besoins, une production consommée localement dépend avant tout d’un système social et politique local qui crée les conditions d’émergence ou de développement des systèmes alimentaires localisés, et ce, quelle que soit la capacité du territoire à produire physiquement ou techniquement une denrée alimentaire. De fait, les politiques publiques sont la « clé de voûte » pour engager des changements durables dans les systèmes alimentaires, car leur adaptation à l’échelle territoriale dépend de multiples maillons différents, à la fois dans la définition de la vision du changement, mais aussi dans les procédés, comme les formes de gouvernance.
Rendre les systèmes alimentaires et agricoles plus durables et résilients en région Provence-Alpes-Côte d’Azur nécessite une réflexion globale sur les processus qui lient production, distribution et alimentation, avec un regard particulier sur des déterminants forts, comme la diversité des exploitations (versus homogénéisation), l’accès aux structures de transformation (versus l’industrialisation des filières) et la co-construction de politiques d’approvisionnement (versus la centralisation des décisions).
La transformation des systèmes concerne aussi les pratiques agricoles et s’intéresse à l’agroécologie. Cette dernière, soutenant le fonctionnement écologique dont elle dépend, contribue à la durabilité de l’agroécosystème. Dans notre région, elle offre aussi de meilleures capacités d’adaptation et de résilience face à l’augmentation de la fréquence et de l’intensification des sécheresses agricoles et des canicules à l’avenir.
Au-delà des liens entre production, distribution et alimentation, de nouvelles perspectives de recherche s’ouvrent sur la caractérisation de la forme et de la localisation des bassins alimentaires territoriaux (la zone d’achalandage de proximité). Les analyses ne peuvent pas se limiter à une distance isotrope conduisant à un cercle de production théorique autour de la ville, ne tenant pas en compte des contraintes pédoclimatiques ou historiques. Une distance isotrope reviendrait à considérer les mêmes propriétés dans toutes les directions. Les analyses doivent considérer l’ensemble des contraintes biophysiques, économiques, sociales et politiques qui déterminent la géographie des échanges, et aboutir à une configuration en archipel (par groupe de produits par exemple : la viande bovine de proximité, pour la ville de Marseille, provient d’un élevage non pas situé dans sa périphérie immédiate, mais sur les contreforts alpins, alors que les distances peuvent être plus courtes pour le maraîchage, Figure 8).
Une réflexion globale sur les processus qui lient production, distribution et alimentation est nécessaire.
Figure 8. Analyse d'un bassin alimentaire : approche méthodologique en trois étapes pour passer de l’évaluation de sa taille (cercle isotrope) à l’évaluation d’une configuration spatiale en archipel (source : Sanz Sanz E., et al., 2021).
Zoom 2. La reconnexion des systèmes agricoles et alimentaires comme enjeu local
Les interactions entre les trajectoires de changement des systèmes territoriaux d’usage des sols et les systèmes alimentaires locaux ont été modélisés sur le pourtour méditerranéen, à partir d’études de cas conduites dans sept pays (Italie, France, Malte, Portugal, Espagne, Tunisie et Algérie), incluant des approches qualitatives (entretiens, jeux sérieux…) et quantitatives (analyse spatiale, géomatique). La méthodologie originale a permis, dans un premier temps, de connecter les échelles locales et régionales, et de localiser précisément les processus de changement d'usage des sols dans le bassin méditerranéen. Dans un deuxième temps, les processus de changements ont été analysés en fonction des conditions de développement des systèmes alimentaires localisés. Une vidéo résume les principaux résultats du projet DIVERCROP : www.youtube.com/watch?v=iurr5ECgzdg
Interview I. Eau et alimentation dans la région
Fabrice DASSONVILLE, responsable régional Eaux, air extérieur (pollens/allergies), écophyto, périnatalité & santé-environnement, Département santé-environnement (DSE), Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (Photo 9 ci-contre, © ARS PACA)
1. L’eau potable est une composante de l’alimentation. L’eau du robinet a-t-elle des vertus nutritionnelles susceptibles de préserver durablement la santé humaine ?
L’eau du robinet est par définition une eau équilibrée, riche en sels minéraux (calcium, magnésium) et en oligo-éléments, indispensables à notre métabolisme. Selon la région, l’eau du robinet peut représenter jusqu’à 20 % de la dose quotidienne nécessaire en calcium. Par rapport aux eaux en bouteille, l'eau du robinet est souvent dédaignée, à tort : en effet, elle est le produit alimentaire le plus contrôlé en France et elle est 100 à 300 fois moins chère, sans tenir compte des considérations environnementales liées à l’utilisation de matières plastiques.
2. De manière générale, la qualité de l’eau du robinet est-elle suffisante en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ? Sera-t-il possible d’offrir à l’avenir une eau potable encore plus saine ?
L'eau distribuée dans la région est globalement de bonne qualité, mais il existe d'importantes disparités géographiques. Les problèmes de qualité bactériologique identifiés dans les départements alpins soulignent la nécessité de poursuivre la protection des captages et si nécessaire, de mettre en place des stations de désinfection. Des contaminations chimiques, plus ponctuelles, mais de grande ampleur, et des évènements climatiques majeurs ont mis en évidence un défaut d’approche anticipative des gestionnaires vis-à-vis de ce type de risque. D’autres problématiques concernent aussi le vieillissement des réseaux et la vulnérabilité des installations face aux actes de malveillance. Dans ce contexte, l’engagement des Plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE) constitue un levier d’amélioration pour offrir une eau potable encore plus saine.
3. Le changement climatique représente-t-il une menace pour la qualité et la quantité d’eau potable ?
À l’avenir, la disponibilité durable de l’eau de boisson sera remise en question si les systèmes d’approvisionnement ne s’adaptent pas à la variabilité et l’évolution rapide du climat. Le changement climatique modifie d’ores et déjà la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes (crues, inondations, sécheresses…), et il est susceptible d’affecter la quantité et la qualité des ressources en eau douce. Dans ce contexte, la sécurité sanitaire et la sûreté de l’eau de boisson deviennent des enjeux majeurs, d’autant plus que la croissance démographique, l’urbanisation croissante et les besoins industriels exercent aussi des pressions. Pour limiter les risques, il est indispensable de renforcer la résilience des services d’approvisionnement en eau.
4. Quelles solutions pour sécuriser les ressources en eau potable ces deux prochaines décennies ?
Le PGSSE constitue une approche proactive d’évaluation et de gestion des risques pour garantir la sécurité sanitaire et la sûreté des approvisionnements en eau de boisson. La démarche, recouvrant toutes les étapes d’approvisionnement, privilégie une approche anticipative plutôt que curative. Les PGSSE, introduits dans la réglementation française en 2015, s’appuient sur des méthodes d’analyse des dangers et de maîtrise des risques. L’objectif est de respecter trois exigences fondamentales : la disponibilité, la qualité sanitaire et la qualité organoleptique16 de l’eau délivrée à la population. Les PGSSE sont également des leviers d’action pour faire face aux changements climatiques à chaque étape de leur élaboration en intégrant les évènements climatiques passés et futurs.
-
Quelle est l’empreinte carbone de l’alimentation et de l’agriculture régionales ?
Les données relatives à l’empreinte carbone des régimes alimentaires n’étaient pas disponibles à l’échelle régionale jusqu’à récemment, alors qu’elles le sont depuis plus longtemps à l’échelle nationale et internationale. Cette anomalie a été corrigée, au moins partiellement, en 2017. Le régime actuel moyen des habitants de notre région est devenu proche de celui observé au niveau national, présentant une forte proportion d’aliments d’origine animale (produits laitiers, viandes et charcuteries). L’analyse des cycles de vie des aliments établit un net différentiel d’émissions de gaz à effet de serre (GES) entre les productions (Figure 6). Le rapport est au minimum 1 à 15.
Figure 6. L’équivalent en dioxyde de carbone (CO2 ) émis dans l’atmosphère pour 100 g de production agricole (source : Pointerau P et al., 2019).
Le niveau élevé des émissions de GES pour les produits animaux vient à la fois de l’énergie nécessaire pour produire les aliments du bétail, du protoxyde d’azote (N2 O) dépendant du cycle de l’azote et surtout, pour les ruminants, des émissions de méthane (CH4 ) qui a un pouvoir réchauffant nettement supérieur au dioxyde de carbone (CO2 ). De ce fait, par personne et par an, les émissions moyennes liées au régime alimentaire actuel et au périmètre de la ferme sont comprises entre 1400 et 1800 kilogrammes équivalent CO2 (dont 85-90 % d’entre elles sont dues aux produits animaux), et environ 4000-4500 m2 de surface agricole et 6000 mégajoules d’énergie sont nécessaires.
Dans ces conditions, il est légitime de se questionner : cette situation peut-elle évoluer ? Quelles options sont possibles pour diminuer l’impact des régimes alimentaires sur les émissions de GES ? Comme pour la construction du scénario Afterres 2050 à l’échelle nationale, des scénarios de changement en région ont été calculés à partir des données observées avec diverses options :
1. adopter un régime alimentaire qui respecte les recommandations alimentaires françaises (celles du Programme national nutrition santé, PNNS-3) ;
2. adopter un régime de type méditerranéen ;
3. adopter un régime qui respecte les recommandations nutritionnelles et de type méditerranéen.
Dans les trois cas, par rapport au régime moyen actuel, l’objectif est d’augmenter les produits céréaliers, les légumes frais et secs, les fruits et les poissons, et de diminuer de plus en plus (graduellement de l’option 1 à 3, liste ci-dessus) les apports en viandes rouges, volailles et gibiers, charcuteries et fromages. Ces changements réduisent fortement les émissions de GES en lien avec le régime alimentaire (Figure 7) : par habitant et par an, 1600 kg équivalent CO2 sont émis par le système actuel contre environ 650 kg pour une assiette avec deux tiers de protéines végétales en agriculture conventionnelle (et même 560 kg en agriculture biologique).
Les régimes à base plus végétale permettent de réduire aussi, et ce de manière significative, la surface agricole et la consommation d’énergie pour produire une alimentation de type méditerranéen, et favorisent l’adoption de méthodes de production issues de l’agriculture biologique. Ces scénarios, plus compatibles avec les capacités de production agricole régionale, doivent s’accompagner en parallèle d’une évolution des productions pour mieux garantir la capacité nourricière.
Figure 7. Comparaison des empreintes carbone des différents régimes alimentaires (source : Le revers de notre assiette, Solagro, 2019). INCA2 ANC : en moyenne, régime actuel (enquête INCA2 2006-2007) respectant l’apport nutritionnel conseillé (ANC). INCA2 observé : en moyenne, régime actuel (enquête INCA2 2006-2007) ne respectant pas l’ANC.
Info+
Dans son rapport spécial sur le changement climatique et les terres émergées, publié en 2019, le GIEC met en avant le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fonction de 8 régimes alimentaires différents : végétalien (ou vegan), végétarien, flexitarien, sain, équitable et frugal, pescétarien, carnivore (omnivore en réalité) sensible au climat (en limitant les émissions de GES), méditerranéen. Le régime méditerranéen12 présente un potentiel d’atténuation de GES de l’ordre de 3 gigatonnes eqCO2 par an, contre 5 gigatonnes pour le flexitarien13, 6 gigatonnes pour le régime végétarien14 et 8 gigatonnes pour le régime végétalien15. De nouvelles études affineront ces premières estimations. Ce constat ne signifie pas que le GIEC recommande à tous de devenir végétaliens ou végétariens, car chaque régime doit être adapté au contexte local, aux modes de production et de consommation, aux besoins des populations, etc., mais l’écart montre combien la réduction de la consommation de viande est un puissant levier pour diminuer les émissions de GES dans l’atmosphère.
-
-
Quels sont les régimes alimentaires et recommandations nutritionnelles ?
Les régimes alimentaires évoluent au gré de nos systèmes alimentaires et agricoles mis en place, de l’offre et la demande, mais, aujourd’hui, quelle est la composition de nos assiettes ? Nos besoins alimentaires sont-ils couverts ? Les apports nutritionnels favorables à la santé sont-ils assurés ? En toute logique, le régime alimentaire méditerranéen devrait être privilégié par les habitants de notre région : est-ce vraiment le cas ? A-t-il des effets protecteurs sur la santé, les écosystèmes et le climat ? Son adoption peut-il répondre aux enjeux de la transition écologique et permettre d’appliquer les recommandations nutritionnelles en phase avec les Objectifs de développement durable de l’ONU ? Ces questions sont abordées dans ce chapitre.
-
Quel est aujourd’hui le principal régime alimentaire dans notre région ?
Peu de données sont disponibles pour déterminer avec précision ce que nous mangeons dans notre région. Les données représentatives pour les adultes proviennent des études coordonnées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), la plus récente étant publiée en 2017. Vu le nombre limité d'études et le faible échantillonnage de personnes, les données de ce sous-chapitre sont indicatives. Les consommations notables sont les suivantes (par ordre décroissant) : fruits, légumes, laits et produits dérivés, céréales et pâtes, viandes rouges, volailles, huile d’olive, poissons et fruits de mer, légumes secs, café, thé, blé dur, riz, œufs, oléoprotéagineux (Figure 9).
Figure 9. Consommations alimentaires journalières (en grammes par jour) par grand groupe en régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et ex-Languedoc-Roussillon (source : INCA 3, 2017).
Si les consommations régionales sont comparées à celles de la moyenne nationale, les différences observées sont assez limitées : consommations équivalentes de fruits, légumes, pâtes, pain, riz ou poissons ; -20 % environ de consommation de pommes de terre, pâtisseries, beurre et margarine, viandes rouges (mais +30 % d’agneau) ; -10 % environ de légumes et fruits secs ; enfin, nettement plus d’huile d’olive (+50 %), un peu plus de boissons alcoolisées (+8 %), laits et fromages (+5 %). Ces données de consommation soulignent assez clairement que le type d’alimentation moyen dans la région diffère peu de celui de la moyenne nationale. Les seules caractéristiques marquantes sont la surconsommation d’huile d’olive et d’agneau. Il s’agit certes d’emblèmes de l’alimentation du bassin méditerranéen, mais les consommations des autres grands groupes alimentaires sont guère différentes. Ainsi, actuellement, l’alimentation moyenne dans notre région s’est fort éloignée de celle du milieu du XXe siècle,
qui était encore caractéristique du modèle méditerranéen traditionnel. Cela résulte de l’abandon progressif (et qui s'est accéléré ces dernières décennies) de ce modèle, conduisant à une grande transition et uniformisation à l’échelle du bassin méditerranéen, en France et en Europe. La grande majorité (environ 80 %) des aliments achetés en grandes surfaces, proposant, partout et toute l’année, les mêmes produits, et les mêmes publicités qui influencent les citoyens, explique cette évolution. Des données complémentaires indiquent qu’en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les citoyens adultes i) accordent plus d’importance à la variété et à la diversité des aliments, ii) ont une vision plus positive de l’équilibre de leur alimentation et iii) ont un score plus élevé pour les connaissances en alimentation. Les 1217 ans tendent aussi à consommer un peu plus de fruits et légumes, de poissons, de boissons sucrées, mais moins de produits laitiers et charcuterie.
-
Choisir le régime méditerranéen serait-il bénéfique à la santé, l’environnement et le climat ?
Un très large consensus scientifique international établit que les alimentations basées sur des végétaux sont bénéfiques aux écosystèmes et à la santé humaine, comparées aux régimes alimentaires omnivores à dominante animale. Elles sont recommandées par les instances internationales (Organisation mondiale de la santé) ou nationales (dont la France). Dans notre région, le type d’alimentation traditionnel est l’alimentation méditerranéenne, adaptée et produite essentiellement dans nos territoires. Ce n’est que récemment (deux à trois générations) que l’agriculture et les régimes alimentaires ont changé en profondeur, en copiant le modèle nord-américain riche en produits animaux, gras, salés et sucrés.
L’alimentation méditerranéenne est bénéfique pour le climat et les écosystèmes
Le mode de consommation le plus équilibré et adapté à notre contexte régional actuel est le régime méditerranéen puisqu’il se caractérise par une importante et dominante consommation de produits végétaux (céréales peu raffinées, légumes secs, légumes et fruits frais, noix, amandes, huile d’olive), de plantes aromatiques (ail, thym, romarin, marjolaine...), de poissons, et se compose aussi de produits laitiers et volailles en quantités raisonnables, de peu de charcuteries et viandes rouges, de produits sucrés en faible quantité (Figure 10). Parmi des plats typiques : la salade grecque ou niçoise, la soupe au pistou, le couscous, la paëlla, les
pâtes ou les pizzas, les fruits de saison. Moins de produits d’origine animale et de produits transformés signifie, pour leur production, moins de surfaces agricoles à cultiver (-70 %), moins de consommation d’énergie (-80 %) et de ressources naturelles comme l’eau douce (-60 %), et nettement moins d’émissions de GES (-70 %), ce qui limite le réchauffement climatique. L’alimentation méditerranéenne implique aussi des productions très diversifiées, avec des rotations qui réduisent l’apport d’engrais (légumineuses ou épeautre par exemple) et l’usage de divers produits phytosanitaires. L’alimentation méditerranéenne, comme les alimentations à base végétale, présente ainsi un double avantage : générer de faibles émissions de GES, préserver les écosystèmes et donc la biodiversité, surtout si les modes de production et de distribution sont durables (agroécologie, agriculture biologique, produits locaux et de saison) et si la consommation alimentaire est bien ajustée aux besoins de chacun.
L’alimentation méditerranéenne présente de nombreux avantages : générer de faibles émissions de GES, protéger la santé humaine, préserver les écosystèmes…
Figure 10. Nouvelle pyramide pour une alimentation méditerranéenne durable (source : Serra-Majem et al., 2020).
Le régime méditerranéen est bon pour la santé humaine
Depuis 1960, de nombreuses études scientifiques et médicales démontrent que l’alimentation de type méditerranéen est très bénéfique à la santé, surtout si les aliments sont typiques et sans pesticide. Les adeptes de cette alimentation, tous âges confondus, sont moins sujets au surpoids et à l’obésité, et les adultes sont moins affectés par nombreuses maladies (diabète T2, pathologies cardiovasculaires, Parkinson, certains cancers, dépressions…). Une activité physique régulière est également recommandée.
Miser sur l’éducation et les outils mis à disposition pour encourager une alimentation méditerranéenne
Dès le plus jeune âge, l’éducation à une alimentation plus végétale, une agriculture plus respectueuse de la nature et du climat (agriculture de conservation, agriculture biologique, agroforesterie, circuits courts…)
peut contribuer au retour du régime méditerranéen pour le bien de tous. La restauration scolaire, en accord avec les dispositions de la loi ÉGalim17, est aussi un bon vecteur pour privilégier ce régime, démontrer ses qualités gustatives (variétés paysannes par exemple), sanitaires et environnementales, et accompagner le changement de modèle de société. Les projets alimentaires territoriaux (PAT) sont également des outils efficaces pour favoriser le développement de l’alimentation méditerranéenne dans notre région et changer les pratiques sans déclencher de polémiques.
-
Le régime méditerranéen en phase avec les Objectifs de Développement Durable en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ?
Les recommandations alimentaires et nutritionnelles sont des repères issus des connaissances scientifiques et médicales, à travers lesquelles l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les États conseillent les populations sur les meilleurs choix pour la santé. Des alimentations plus végétales, moins raffinées et plus riches en micronutriments sont recommandées pour nos pays. Depuis 2015, l’OMS, comme la France, ont commencé à aussi prendre en compte la dimension de la durabilité, en s’inspirant de la définition des alimentations durables par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en 2010 et des Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU pour 2030. Plusieurs de ces objectifs ont des rapports privilégiés avec les questions alimentaires (faim « zéro », bonne santé, consommation et production responsables…) ou environnementales (eau propre, énergie propre, changement climatique…).
Concrètement, les nouvelles recommandations alimentaires du Programme national nutrition santé (PNNS-4, 2019-2023) proposent une alimentation nettement plus végétale (Figure 11) : augmentation de tous les groupes végétaux (fruits et légumes, légumes secs, céréales peu raffinées, fruits secs, oléagineux, huiles) en privilégiant ceux issus de l’agriculture biologique, diminution des produits animaux (viandes rouges et charcuteries), les produits laitiers (en évitant les carences en nutriments), consommation limitée de sucre et sel…
Figure 11. Alimentation et santé : repères nutritionnels (source : PNNS-4, 2019-2023).
Ce type d’alimentation est recommandable pour atteindre les ODD de l’ONU, même si certains effets restent à documenter, car il augmente la qualité nutritionnelle de l’alimentation et ses effets bénéfiques sur la santé humaine, réduit notablement l’utilisation des ressources (terre agricole, eau douce, énergie) et diminue fortement les impacts négatifs du système alimentaire dominant (pesticides, pollutions, perte de biodiversité, émissions de GES…). Il permet aussi de nourrir plus de monde à moyens constants, à condition de rendre accessible en parallèle cette diète au plus grand nombre.
Est-ce applicable en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ? Comme précédemment souligné, culturellement, notre identité alimentaire est méditerranéenne, à base fortement végétale, nutritive et savoureuse, et protectrice de la santé, des ressources et du climat. Les consommateurs se sont récemment éloignés de cette identité, mais, pour appliquer les recommandations nationales, elle présente de nombreux avantages : il est possible de la produire localement, les productions végétales étant le point fort de l’agriculture régionale (fruits, légumes, blé dur, pois chiches, fruits secs oléagineux, olives et huile d’olive) et de s’appuyer, au moins partiellement, sur la pêche locale (poissons). Les aliments d’origine animale sont produits en petites quantités (viandes, produits laitiers) dans notre région, ce qui va dans le sens des recommandations, mais ces productions pourraient augmenter pour mieux satisfaire les besoins de la population régionale. Un atout régional important est le niveau très élevé (32 %) de la surface agricole utile en production biologique.
En accord avec la FAO, l’OMS et les recommandations nationales, notre région a beaucoup d’atouts pour redévelopper une alimentation saine et durable, de type méditerranéen, bénéfique à la santé humaine et celle des écosystèmes, et qui renforcerait l’autonomie alimentaire.
Les consommateurs de la région se sont éloignés de l’alimentation méditerranéenne, mais son retour permettrait d’appliquer les recommandations nutritionnelles nationales.
-
-
Des pistes pour changer nos systèmes agri-alimentaires
Les systèmes alimentaires et agricoles subviennent aux besoins vitaux de la majorité de la population en France, mais leur fonctionnement ne permet pas aujourd’hui de pleinement protéger la santé de tous, préserver les agrosystèmes, les écosystèmes naturels, le climat… Face au changement climatique et la mondialisation, leur résilience est nettement insuffisante et l’autosuffisance alimentaire est faible, malgré leurs progrès. Comment y remédier ? Dans ce chapitre, des pistes réalistes sont présentées pour transformer les systèmes en place.
-
Comment réinventer la chaîne alimentaire, du producteur au consommateur ?
Dans les territoires agricoles proches d’espaces urbains et/ou périurbains, où la population est dense, il paraît facile de rapprocher producteurs et consommateurs à travers des circuits courts et de proximité. La question se pose différemment dans les communes rurales plus isolées, comme Barcillonnette, Lardier-et-Valença, Vitrolles et Esparron situées dans les Préalpes du Sud : agriculteurs et consommateurs peu nombreux et distants, faible présence de commerces de proximité et de marchés de plein vent… Réinventer la chaîne alimentaire appelle à imaginer différentes façons de tisser ou retisser des liens entre la production agricole locale ou environnante et les habitants du territoire, sans multiplier les déplacements de petits volumes pour limiter l’empreinte carbone. Cette perspective vient rappeler que la reterritorialisation de l’alimentation, loin d’être un repli défensif sur le local, consiste avant tout à donner aux acteurs territoriaux la possibilité de réorganiser leur système alimentaire, de manière à maîtriser l’origine et la qualité de leur alimentation. En permettant aux agriculteurs de mieux s’inscrire dans leur territoire et de conserver plus de valeur ajoutée, la reterritorialisation encourage notamment la transition agroécologique.
Quelles voies s’ouvrent pour les petites communes rurales ? Avant tout, les exploitations agricoles, même en faible nombre, sont des ressources à préserver, en facilitant leur reprise, en soutenant leur diversification, en créant un atelier en maraîchage bio ou en les accompagnant vers les circuits courts, par exemple. D’autres exploitations peuvent être créées, en favorisant l’accès
au foncier en échange de la fourniture d’aliments sains et locaux. Les habitants peuvent ensuite se regrouper pour commander leurs produits auprès de ces fermes, s’organiser pour les récupérer et les redistribuer au cours d’un déplacement domicile-travail par exemple. Depuis la crise de la COVID-19 en particulier, la population locale est souvent porteuse de solutions pour réinventer la chaîne alimentaire locale et durable, en s'appuyant sur des innovations sociales et logistiques que les communes rurales ont tout intérêt à catalyser et accélérer. Ces communes peuvent aussi se mobiliser pour soutenir ou renforcer la vente ambulante de produits locaux sur leur territoire, en encourageant la création d’une activité locale avec des emplois non précaires et à l’aide d’un véhicule écologique. La vente ambulante peut se combiner à des points de dépôts de produits locaux (mairie, Poste, école...) pour multiplier les possibilités offertes aux habitants. L’autoproduction, dans un jardin privé ou collectif, peut également être soutenue par les communes, via la mise à disposition de parcelles, mais aussi des formations au jardinage et au maraîchage agroécologique. Si elle n’a pas intérêt à concurrencer (le cas échéant) les producteurs en déficit de débouchés, l’autoproduction permet surtout aux habitants de se reconnecter à l’agriculture, de mieux en cerner les contraintes et de saisir l’intérêt de soutenir les productions agricoles locales. Les relations au sein du territoire doivent ainsi être repensés, adaptés et inventés pour éviter que les communes rurales ne deviennent des « zones blanches » agricoles et alimentaires.
-
Tendre vers la souveraineté alimentaire
Depuis le début de la pandémie COVID-19, souveraineté, sécurité ou encore résilience alimentaire sont très présentes dans les débats. En effet, cette crise sanitaire a montré combien produire localement son alimentation était stratégique. Alors que les rayons de la grande distribution soumis à des circuits longs étaient dévalisés et peu achalandés, les points de vente directe tels que la vente à la ferme ou les magasins de producteurs assuraient l'approvisionnement de la population. Beaucoup de consommateurs ont ainsi découvert ces alternatives locales, créatrices de lien social mis à mal pendant cette période. Cette situation inédite a permis de mettre en lumière la réalité de notre société de consommation et de sa fragilité en lien avec les approvisionnements extérieurs.
La souveraineté alimentaire est un concept développé et présenté pour la première fois par Via Campesina, mouvement international paysan, lors du Sommet mondial de l'alimentation, organisé par la FAO à Rome en 1996. Il a depuis été repris et précisé par divers courants altermondialistes. La souveraineté alimentaire est proposée comme un droit international qui laisse la possibilité aux États ou groupes d'États de mettre en place les politiques agricoles les mieux adaptées à leurs populations sans qu'elles puissent avoir un effet négatif sur les populations d'autres pays. Elle se construit dans le respect des droits des paysans et la valorisation de leur savoir, notamment en termes d’innovation et de transmission des pratiques agroécologiques et de respect du vivant. Elle s’appuie sur le maintien et le développement d’une agriculture familiale et diversifiée, davantage résiliente face aux aléas climatiques et assurant des revenus honnêtes aux agriculteurs. La souveraineté alimentaire est une rupture par rapport à l'organisation actuelle des marchés agricoles mise en œuvre par l'Organisation mondiale du commerce.
Ce concept est complémentaire à celui de sécurité alimentaire qui, selon la FAO, se traduit par un accès constant des populations à une nourriture suffisante, saine et nutritive, permettant de satisfaire les besoins énergétiques et les préférences alimentaires pour mener une vie saine et active.
La souveraineté alimentaire peut se concevoir à différentes échelles territoriales. Au niveau national, la loi d’avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt de 2014 a permis d’encourager les territoires à mettre en place des projets alimentaires territoriaux (PAT). Le Parc naturel régional du Luberon, par exemple, en anime un depuis 2017 et a pour objectif, inscrit dans la future charte 2024-2039, d’accroître sa souveraineté alimentaire. Cette charte comporte des mesures mettant en avant l’importance d’une approche systémique sur les questions liées à l’alimentation : depuis la préservation du foncier agricole jusqu’au développement de l’agriculture biologique et de l’agroécologie, en passant par la sensibilisation de la population et des élus à l'intérêt de consommer des aliments de qualité, locaux et de saison, les mesures énoncées sont gages de santé de la biodiversité des agrosystèmes et de la population. Chaque collectivité est responsable de l'orientation donnée à sa politique agricole et alimentaire et peut ainsi influer sur les productions locales.
À la sortie du premier confinement de la pandémie COVID-19 en 2020, une étude sur la résilience alimentaire en Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait prendre conscience de notre dépendance et de notre vulnérabilité. En effet, notre consommation dépend grandement des importations, alors que de nombreuses productions locales sont exportées. Les PAT de Provence-Alpes-Côte d’Azur, aussi bien communaux que départementaux, à l’échelle d’un parc naturel régional ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont des outils en capacité de contribuer à la reterritorialisation de notre alimentation et à l'amélioration de la souveraineté alimentaire.
-
Quelles pratiques agricoles pour s’engager dans la transition agroécologique et optimiser la séquestration du carbone ?
L’agroécologie, qui repose sur les fonctionnalités écologiques de l’agroécosystème, permet à la fois de favoriser la biodiversité, d’augmenter la résilience des cultures face à certains effets du changement climatique et, par l’amélioration des modes de gestion des sols et l’introduction d’espèces ligneuses, de séquestrer du carbone (atténuation des émissions de GES et par conséquent du changement climatique).
Améliorer la qualité des sols nécessite en premier lieu d’enrayer la baisse régulière de matière organique (et donc de carbone) dans les sols. D’une part, en évitant de laisser les sols nus (mettre en place des couverts entre deux cultures, des couverts inter-rangs…) et d’autre part, en augmentant les restitutions (laisser les résidus sur la parcelle ou composter les résidus de cultures, apporter des produits résiduaires organiques, tels que fumiers, lisiers, composts, boues de station d'épuration, déchets verts ou digestats de méthanisation, inclure des légumineuses dans les rotations…). Ces actions ne sont efficaces que si un sol vivant, riche en biodiversité, offrant un fonctionnement optimal de l’agrosystème et plus particulièrement du cycle du carbone, est maintenu. Pour y parvenir, il est important de limiter au maximum l’utilisation de produits phytosanitaires, d’optimiser le passage des machines sur les parcelles et de réduire, voire de supprimer, le labour afin de protéger la macrofaune et la structure du sol (pratiques préconisées en agriculture biologique, agriculture de conservation ou régénérative). D’un point de vue technique, la combinaison de ces pratiques peut s’avérer complexe ou contre-intuitive pour certains acteurs. Poursuivre les recherches, expérimentations et suivis des bénéfices sur l’adaptation des itinéraires techniques de l’agriculture de conservation des sols, en agriculture biologique ou sans herbicide et pesticide, permettra à terme d’optimiser leur mise en œuvre sur le territoire. En ce sens, un groupe d’agriculteurs (projet ABC-Sud porté par Agribio 04), répartis sur toute la région, a saisi la problématique pour développer l’agriculture biologique de conservation des sols.
L’introduction d’arbres au sein ou en bordure des parcelles, dans une approche d’agroforesterie (Photo 11) ou de complantage, permet également une augmentation du stockage de carbone dans la biomasse ligneuse et les sols (importante biomasse de la litière sous les arbres, exsudats racinaires en profondeur, etc.). En 2021, la politique « Plantons des haies » a permis de lancer le développement de ces pratiques auparavant bloqué dans la région par le manque d’aides à la plantation. Le maintien de cette dynamique régionale nécessitera des soutiens financiers supplémentaires à plus long terme.
Même avec des hypothèses de calcul optimistes, le stockage additionnel de carbone obtenu par l’application des pratiques décrites, représente moins de la moitié des émissions de GES du secteur agricole. Par conséquent, ces pratiques gagneront à être associées à une réduction des émissions de protoxyde d’azote liées à l’usage des engrais azotés (dont la fabrication émet beaucoup de dioxyde de carbone), et de méthane dépendant de l’élevage intensif. Concernant ce dernier, la majorité des élevages de la région sont extensifs et utilisent des prairies et parcours qui séquestrent du carbone (hors surpâturage). Le levier d’action consiste en une évolution des régimes alimentaires qui permettra de réduire sensiblement la consommation de produits provenant de l’élevage industriel. Favoriser la consommation locale de produits carnés ou laitiers locaux, mais aussi végétaux, permettra en outre de favoriser les filières locales et les pratiques agroécologiques.
L’agroforesterie ou le complantage permet une augmentation du stockage de carbone dans la biomasse ligneuse et les sols.
Photo 11. Vignes et oliviers à Bandol (© Thierry Gauquelin).
Zoom 3. La crise sanitaire de la COVID-19, un facteur de changement de pratiques alimentaires et agricoles ?
Dès le début de la crise sanitaire en France (mars 2020), un collectif de chercheurs et d’acteurs membres du Réseau mixte technologique (RMT) Alimentation locale a lancé une enquête en ligne pour saisir les impacts de cette crise sur les systèmes alimentaires. Plus de 800 témoignages ont été recueillis, dans lesquels des personnes de toute la France décrivaient ce qu’elles vivaient ou observaient dans leur ferme, leur supermarché ou sur leur territoire. Les résultats montrent que les circuits courts ont été très sollicités pour plusieurs raisons : plus sûrs pour certains ; plus attractifs quand on dispose de davantage de temps pour cuisiner et penser à son alimentation ; par solidarité envers les producteurs locaux. Ces derniers ont su s’adapter et innover pour répondre à la forte demande, en développant la vente en ligne notamment, mais aussi en collaborant parfois avec des producteurs en circuits longs. De plus, partout en France, des consommateurs ont créé des groupements d’achats entre voisins pour acheter à un producteur situé près de chez eux. Ces initiatives ont mis en mouvement des producteurs et des consommateurs n’utilisant pas, ou très peu, les circuits courts avant la crise, et ont favorisé les apprentissages entre initiés et non-initiés à l’alimentation durable et à la transition agricole et alimentaire. Les résultats de cette enquête ont servi à discuter d’actions concrètes avec des acteurs de l’action publique, depuis le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire jusqu’aux élus locaux, pour appuyer ces initiatives nées ou renforcées au début de la crise autour de l’alimentation locale, en tant que leviers de transition des systèmes alimentaires.
-
Les exploitants agricoles qui s’engagent dans la transition énergétique
Aujourd’hui, le défi le plus important du secteur agricole est la réduction des impacts environnementaux, tout en maintenant une activité économique. De nombreux agriculteurs sont engagés dans une démarche responsable, à la recherche de solutions durables pour renforcer la résilience de leur exploitation face au changement climatique. Ils sont accompagnés par différentes structures dont l’Inter-Réseau Agriculture Énergie Environnement21 (IRAEE), afin de mettre en place des actions comme :
● réduire ses consommations d’énergie pour conserver les récoltes au froid, chauffer les serres et produire des plants avec la mise en place de serres bioclimatiques (Photo 12 et Figure 12), en limitant les emballages avec la mise en place de consignes de verre (expérimentation menée de 2022 à 2023 avec l’IRAEE et Écosciences Provence) ;
Photo 12. Serre bioclimatique « 3 murs » de Fabrice Hours, agriculteur à Eygliers (© Geres).
Figure 12. Fonctionnement d’une serre bioclimatique (© Agrithermic). Les serres bioclimatiques, développées par le Geres, Agrithermic et le Groupe de recherche en agriculture biologique (GRAB), sont adaptées aux conditions climatiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et ont aussi l’avantage de répondre aux enjeux d’alimentation durable des territoires (relocalisation de la production alimentaire, soutien aux agriculteurs locaux, adaptation aux enjeux climatiques et énergétiques).
● mesurer ses consommations énergétiques, ses émissions de gaz à effet de serre et évaluer son stockage carbone avec un outil d’auto-diagnostic gratuit en ligne et/ou réaliser un Bon Diagnostic Carbone pour les agriculteurs installés depuis moins de cinq ans ;
● mettre en place des pratiques susceptibles de séquestrer du carbone dans le sol (accompagnement de 10 agriculteurs par l’IRAEE et le lycée agricole de Carpentras en faveur de l’initiative 4/1000) : implantation de haies, apport de matières organiques, intégration d’engrais vert (Photo 13), changement de rotations…
● développer le broyage des résidus agricoles, notamment en viticulture, arboriculture et maraîchage, pour une valorisation comme combustible ou un retour au sol, en alternative au brûlage à l’air libre, et la substitution des engrais azotés par l’introduction de légumineuses et l’utilisation de compost de fumier équin moins émetteur de polluants atmosphériques (particules, ammoniac) ;
● produire du gaz renouvelable, un fertilisant (digestat) et développer des passerelles entre le monde agricole et les collectivités via la mise en œuvre d’une économie circulaire des biodéchets (déchets verts et alimentaires) au travers la méthanisation (accompagnement Métha’Synergie)…
Photo 13. Intégration d’un engrais vert en interculture et renforcement de la fertilisation organique sur une parcelle de maraîchage par l’agricultrice Hélène Bertrand, à Avignon (© Pericard Conseil).
Des mesures utiles à mettre en œuvre : mesurer et réduire les consommations d’énergie et les émissions de GES ; mettre en place des pratiques séquestrant davantage de carbone dans les sols ; développer le broyage des résidus agricoles ; produire du gaz renouvelable…
-
Vers une aquaculture fondée sur la durabilité et l'économie circulaire
L'aquaculture, pratiquée actuellement dans la région (loups, daurades royales, moules, huîtres…) et ailleurs, ne répond pas au triple impératif de nourrir l'humanité, préserver le climat et la biodiversité, tout en garantissant la sécurité et la souveraineté alimentaire. L'innovation est cruciale pour développer des solutions durables et inclusives. Seule une vision écosystémique et durable de l'aquaculture, intégrant plusieurs ODD simultanément, permettra de protéger les océans et les mers, le climat, la biodiversité et les communautés locales. Sur ce principe est fondé le modèle de production d’aquaculture multitrophique28 intégrée terrestre, couplée aux principes de l’économie circulaire et placée au cœur des bassins de consommation.
L’aquaculture doit être régénératrice et réparatrice. En effet, elle dépend d’un système marin profondément vulnérable face au changement climatique, qui court aujourd’hui le double risque d’un effondrement écologique et d’une crise économique et alimentaire. En réponse à ce constat, la science doit développer des solutions innovantes, afin de permettre de réduire les impacts de nos systèmes de production et de consommation alimentaires. Les aliments utilisés pour nourrir les poissons d’élevage sont un domaine clé pour la recherche et la durabilité. Désormais, la science s’intéresse à l’élaboration d’aliments aquacoles alternatifs, composés de protéines d'insectes enrichies de microalgues et d’organismes marins. L’utilisation des insectes offre l'opportunité de développer une filière de valorisation de rejets agricoles et de déchets alimentaires. Cette bioconversion par les insectes rappelle l’importance des solutions inspirées du vivant. Des pistes de valorisation des sous-produits ou coproduits de pêche sont à l’étude. À l’heure où les systèmes alimentaires sont de plus en plus perturbés par le changement climatique et les crises à venir, contenir et valoriser des protéines, vitamines et micronutriments dans des boucles vertueuses locales s’avère essentiel.
L'impact carbone du secteur de l'aquaculture ne doit plus être ignoré : la pêche pour les farines des poissons ou la chaîne du froid pour la préparation, le transport et l’exportation. Le bilan carbone de la filière est très lourd et peut être atténué par une production à terre et locale. Il s’agit de remplacer la chaîne du froid par la chaîne du vivant. Les poissons devraient passer du bassin à l’étal du marché ou à l’assiette, en garantissant la fraîcheur et la traçabilité.
Chaque fois qu'un poisson sort de l'eau, il est conservé dans de la glace, qui est constituée de deux ressources si précieuses : l'eau et l'énergie. De plus, la science alerte sur les risques liés aux changements du milieu marin et d’événements météorologiques exceptionnels qui représentent des risques pour les productions offshores. L’avantage de ramener la production à terre pour limiter ces risques, mais également pour apporter des emplois accessibles de proximité, et plus particulièrement pour les femmes, est donc indéniable.
Enfin, pour accélérer cette transition du secteur, les programmes doivent être adaptés aux réalités des territoires et des communautés, afin de permettre la mise en œuvre de pratiques low-tech high efficiency (technologie simple, haute efficacité) réplicables. Une vision favorisant les petites unités de production à taille humaine, placées au plus près des bassins de consommation, connectées à des outils de suivi scientifique et technique, est aussi à privilégier. Les partenariats publics et privés multidisciplinaires joueront un rôle central dans l’atteinte de cet objectif. En effet, les collaborations entre les institutions, les organisations non gouvernementales (ONG), les universités et les entreprises ont montré toute leur efficacité dans l’accélération des innovations de rupture.
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, première région française en matière de pisciculture de pleine mer, l’aquaculture peut devenir une pratique régénératrice et réparatrice, permettant de lutter contre le changement climatique et de protéger les écosystèmes marins, tout en proposant des emplois dignes conduisant à la sécurité et la souveraineté alimentaire pour tous à l’échelle locale. Élever plusieurs espèces en même temps dans des bassins, afin que les déchets d’une espèce servent de nourriture à une autre, et transformer ainsi les déchets en ressources.
Dans notre région, l’aquaculture peut devenir une pratique régénératrice et réparatrice.
-
Plus de repas végétariens à la cantine : double pari pour la nutrition et l’environnement
La restauration scolaire française représente environ 8,5 millions de repas par semaine. Au-delà de la couverture des besoins nutritionnels, l’approvisionnement en denrées alimentaires pour les repas scolaires représente un véritable levier pour développer le tissu économique local et enclencher la transition vers des systèmes alimentaires plus durables.
Des règles spécifiques permettent d’assurer la qualité nutritionnelle des repas proposés aux élèves. La promulgation de la loi ÉGalim marque le début des mesures visant à améliorer la durabilité des repas servis en restauration scolaire. Les mesures principales sont le service d’au moins un repas végétarien hebdomadaire depuis le 1er novembre 2019 et l’obligation de proposer au moins 50 %, en valeur monétaire, de produits dits « durables et de qualité », dont 20 % de la valeur monétaire totale issus de l'agriculture biologique à partir du 1er janvier 2022. Les autres concernent la lutte contre le gaspillage alimentaire et l’interdiction du plastique.
La capacité d’une offre végétarienne à améliorer la durabilité des repas servis en restauration scolaire en France a été quantifiée par MS-Nutrition et l’UMR MoISA29, en co-construction avec le collectif EnScol. Des milliers de séries de 20 repas scolaires ont été générées automatiquement selon divers scénarios.
Les résultats montrent l’intérêt d’augmenter la fréquence des repas végétariens (jusqu'à 12 repas sur 20 au lieu de 4 sur 20 actuellement) et de servir du poisson et des viandes blanches aux autres repas. Ceci nécessite une révision de la réglementation actuelle qui impose encore le service de viande rouge à l’école (au moins 4 fois sur 20). Il serait ainsi possible de diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) des repas scolaires (jusqu'à -50 % par rapport au niveau actuel), tout en garantissant leur bonne qualité nutritionnelle.
Un travail complémentaire (Figure 13) a montré que le type de plat principal influençait plus l’impact environnemental (notamment les émissions de GES) des repas que leur qualité nutritionnelle (Adéquation Nutritionnelle Moyenne représentant la richesse en nutriments protecteurs comme les fibres, les protéines, les vitamines, les minéraux et les acides gras essentiels), soulignant l’intérêt d’augmenter la fréquence des repas végétariens et de favoriser le porc ou la volaille plutôt que la viande de ruminants. Associer les changements proposés et les initiatives locales (Miramas, Briançon, Mouans-Sartoux…) en faveur d’une restauration scolaire plus durable (produits bio, locaux et de saison, cuisine maison, actions de sensibilisation…) est un pari gagnant-gagnant pour la nutrition et l'environnement.
Figure 13. Émissions de gaz à effet de serre (en kg eqCO2 ) et adéquation nutritionnelle moyennes (% des recommandations pour 2000 kcal) de différents types de repas scolaires obtenus par génération automatique de séries de repas composés d’une entrée, d’un plat principal (plat protidique + accompagnement), d’un produit laitier et d’un dessert (source : Poinsot et al., 2021).
Zoom 4. Quelle sécurité alimentaire en Méditerranée à l’horizon 2030 ?
L’Objectif de développement durable 2 (ODD 2) vise à « éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable ». Cet objectif ne sera pas atteint en Méditerranée à l’horizon 2030. La répartition inégalitaire des richesses continue à entretenir l’insécurité alimentaire notamment au sein des territoires ruraux.
Au niveau méditerranéen, la disponibilité de la nourriture qui reste tributaire des importations a pour effet un déficit commercial agricole structurel. Représentant seulement 7 % de la population mondiale, les pays méditerranéens comptent encore pour un tiers des importations mondiales de céréales, car les ratios de dépendance aux importations céréalières restent très élevés (PNUE/PAM et Plan Bleu, 2020).
L’accès à la nourriture dépend d’une multitude de facteurs, notamment du pouvoir d’achat, des politiques de subventions dédiées à l’alimentation et de l’état des infrastructures. D’autres facteurs affectent la sécurité alimentaire dans la région méditerranéenne dont l’instabilité politique et les conflits, les changements climatiques, l’insécurité hydrique et l’érosion des ressources naturelles (sols, biodiversité). D’un point de vue nutritionnel, le surpoids et l’obésité atteignent un niveau alarmant dans de très nombreux pays méditerranéens et une forte prévalence de l’anémie affecte les femmes en âge de procréer.
D’ici 2030, la reconquête des sols et la préservation des eaux, conjuguées à une mise en œuvre efficace des mesures d’adaptation au changement climatique et une exploitation rationnelle des ressources naturelles, seront essentielles pour l’agriculture, base de l’alimentation des populations. L’Afrique du Nord est appelée à devenir la principale région importatrice de blé dans le monde et l’équilibre de la balance alimentaire pourrait être bien plus difficile à atteindre si les productions locales n’augmentent pas, affectant les budgets publics et la disponibilité des produits agricoles. La surnutrition et la malnutrition poseront des problèmes de santé publique préoccupants (maladies chroniques et obésité). Le coût de l'inaction pourrait être très élevé, car ne pas commencer à mettre en œuvre des politiques appropriées pourrait, dans un avenir proche, entraîner une instabilité sociale, et représente une politique dangereuse pour la région.
-
-
Les mesures sociales et collectives pour accélérer les transitions alimentaires et agricoles régionales
La mutation des systèmes alimentaires et agricoles, indispensable pour limiter le changement climatique, passera par davantage de justice sociale, tant d’un point de vue économique, environnemental que climatique. La transition écologique est un appel à changer nos pratiques pour réduire les impacts du changement climatique, mais aussi une opportunité pour rendre nos sociétés plus solidaires et résilientes. Les régions et les pays ne doivent plus accepter les grandes inégalités sociales qui séparent les populations en détresse des plus riches. Cette évolution passe par nos comportements individuels, mais surtout collectifs pour transformer en profondeur nos modèles de développement. Ce chapitre traite des mesures sociales et collectives susceptibles d’accélérer les transitions.
-
Vers des systèmes alimentaires et agricoles plus justes
Pour s’engager durablement dans les transitions, rien ne sera possible si la justice sociale est marginalisée dans les politiques et stratégies d’adaptation et d’atténuation. Lutter contre les inégalités sociales et de genre, rendre accessible l’alimentation de qualité aux plus démunis, préserver la santé de chacun, contribuer à sa mesure aux efforts en faveur des transitions, etc. ne représentent pas un simple espoir ou une aspiration, mais une nécessité. Ce sous-chapitre donne des premières pistes.
-
Comment mettre en place des systèmes alimentaires et agricoles durables en luttant contre les inégalités sociales ?
Les systèmes alimentaires et agricoles sont soumis à des pressions et des chocs découlant de l’augmentation de la demande (accroissement des populations, progression de la faim), des effets du changement climatique, de la surexploitation des ressources, de la survenue de différents types de crises (politiques, économiques ou sanitaires). La crise due à la COVID-19 a rendu visibles et a accentué les situations de précarité alimentaire en France. En 2020, des estimations chiffraient le nombre de personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, ne pouvant accéder à une alimentation sûre, diversifiée, de bonne qualité et en quantité suffisante, à 7 millions. Le nombre d’usagers de l’aide alimentaire a doublé en dix ans et aurait augmenté de plus de 10 % entre 2019 et 2020. De surcroît, la guerre en Ukraine a engendré une augmentation rapide de l’inflation des prix de l’alimentation qui risque de se poursuivre. Dans un tel contexte, les systèmes alimentaires doivent se transformer pour devenir plus durables en luttant contre les inégalités sociales.
En France, de nouvelles formes de systèmes alimentaires plus durables se développent, portées par la hausse de la consommation, la multiplication et la diversification des circuits de proximité, avec l’appui des politiques alimentaires (loi Égalim, PAT, etc.). Pour autant, l’accessibilité à ces circuits (groupement d’achats ou d’épiceries participatives, vente en ligne de produits bio ou locaux…) reste un obstacle pour la majeure partie de la population. Heureusement, certaines initiatives parviennent à réduire le prix des produits, grâce au bénévolat et aux financements publics et privés (fondations), ou lèvent des barrières culturelles et sociales en faisant des utilisateurs les porteurs des projets.
Pour autant, la fragilité et la diversité des modèles économiques et sociaux des initiatives, mais aussi le manque d’évaluation de la durabilité des systèmes agricoles soutenus et la non-représentativité de leurs utilisateurs, demeurent des faiblesses.
Du côté de l’aide alimentaire et des épiceries sociales, alors que la distribution d’une alimentation plus durable devient un enjeu plus prégnant ces dernières années et que des expérimentations ont émergé sur certains territoires, la généralisation de la distribution de produits de qualité n’est pas advenue. Face à ces limites, des ONG, des scientifiques et des politiques proposent la mise en place d’une sécurité sociale de l’alimentation (SSA). Comme la sécurité sociale de la santé, la SSA serait financée par la cotisation sociale. Elle se fonde sur le droit à l’alimentation durable et sur la démocratie alimentaire. Le principe est d’allouer à chacun une allocation universelle pour une alimentation durable dont le montant serait adapté au niveau socio-économique des foyers, et qui donnerait accès à des produits et/ou des lieux conventionnés, les critères de conventionnement étant élaborés démocratiquement dans les bassins de vie, ce qui contribuera à actionner la transition vers des systèmes alimentaires plus durables.
Pour faire face à la double urgence climatique et sociale, il est essentiel d’apporter une réponse ambitieuse en adéquation avec les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Pour évaluer les bienfaits et l’efficacité d’une telle mesure, il est primordial de comprendre que les gains de la SSA en faveur de la santé et de l’environnement dépassent largement son coût.
Interview II. Le genre au cœur de la transition agricole et alimentaire
Carine PIONETTI, chercheuse indépendante en écologie politique et spécialiste des questions de genre, affiliée au Centre for Agroecology, Water and Resilience, University of Coventry, Royaume-Uni (Photo 15 ci-contre, © Carine Pionetti)
1. Pourquoi est-il pertinent de s’intéresser au genre quand on parle de systèmes alimentaires et agricoles, et de changement climatique ?
Parler du genre présente l’avantage de s’intéresser aux différences entre les hommes et les femmes pour pouvoir les prendre en compte dans les projets ou les politiques publiques. Dans le monde agricole par exemple, les femmes qui s’installent ont plus difficilement accès au foncier, aux aides et crédits, et leurs fermes sont en moyenne moins grandes (36 ha contre 62 ha pour les hommes en 2012). Côté alimentation, des différences sont encore constatées : les hommes font moins les courses alimentaires, la cuisine, et sont globalement moins tournés vers le bio, même si cela évolue. Pour le changement climatique, c’est plus subtil. Il faut croiser les questions de résilience, de gestion de l’eau, de perceptions des aléas climatiques avec celles du genre. La capacité à faire face aux changements, qu’ils soient liés au climat ou au contexte économique, varie selon un grand nombre de facteurs, comme la maîtrise de l’eau et du foncier, les possibilités de diversifier sa production, de participer à des initiatives collectives… Sur tous ces sujets, il existe des différences entre les femmes et les hommes à considérer pour concevoir des stratégies d’adaptation « sensibles au genre ».
2. En quoi le genre peut constituer un levier pour rendre des actions plus efficaces ou dynamiser les territoires dans une perspective de transition agricole et alimentaire ?
À l’heure actuelle, la transition relève le plus souvent des femmes : elles sont très mobilisées sur le terrain pour faire évoluer les pratiques agricoles, transformer les habitudes alimentaires, favoriser le bio dans les cantines scolaires. Elles initient des démarches de vente directe ou de diversification dans les fermes et s’investissent dans des outils de transformation (fromageries, abattoirs de proximité) qui redynamisent les filières courtes et l’économie locale. En donnant aux femmes plus de reconnaissance et de moyens, mais aussi en défendant la parité entre femmes et hommes dans les instances décisionnelles et dans la sphère politique, il est possible d’accélérer ces processus de transition. La culture des organisations doit aussi évoluer vers une plus grande mixité. Les projets alimentaires territoriaux offrent des opportunités pour traiter les questions de genre, en intégrant des actions encourageant l’installation agricole des femmes, par exemple, ou en revalorisant les métiers dits « du care » (du soin) très féminisés et souvent mal rémunérés (exemple : postes d’aide de cuisine dans la restauration collective). Il est aussi important d’augmenter le pourcentage de femmes occupant des postes à responsabilités car si les femmes sont très présentes sur le terrain, elles ne sont pas assez représentées dans les instances décisionnelles qui jouent un rôle dans la transition !
3. Une expérience à partager ?
Je pense au Groupement d’intérêt économique et environnemental FAM dans les Hautes-Alpes, constitué uniquement d’agricultrices, probablement le seul Groupement d'intérêt économique et environnemental (GIEE) féminin à ce jour en France ! Ce groupe se réunit 5 à 8 fois par an, proposant des chantiers collectifs, de la solidarité et de l’entraide dans les fermes. Il est aussi à l’origine de Devenir Paysanne, un guide sur l’installation agricole au féminin.
-
Les défis d’une transition agri-alimentaire socialement juste
Groupements d'achats dans les quartiers politiques de la ville, paniers marchés et épiceries solidaires alternatifs à l’aide alimentaire classique, qui visent à la fois la transformation des systèmes agri-alimentaires et une accessibilité alimentaire à tous, constituent un levier de transition écologique et de justice sociale. Ces projets génèrent des changements conséquents dans le quotidien des participants, leur permettant de se procurer à des prix abordables et à proximité de leur lieu de vie, des produits de qualité issus de circuits courts ou de pratiques agroécologiques. Cependant, traiter en profondeur les inégalités d’accès à une alimentation saine, digne et durable s’accompagne de deux défis majeurs.
D’une part, l’alimentation étant une pratique sociale, culturelle, symbolique et politique, son accessibilité ne peut se réduire aux seules notions de proximité géographique et de prix. Aussi, il convient de prendre en compte les contraintes pratiques (absence de cuisine fonctionnelle, mobilité difficile) et les besoins (adéquation des denrées avec les préférences, habitudes et croyances) des publics visés, et ce, à tous les stades du projet. Pour ce faire, il est capital de soigner le diagnostic de territoire, tout en restant à l’écoute des participants, afin d’adapter les initiatives selon les perceptions et attentes émergeantes d’enquêtes qualitatives. Par ailleurs, les démarches de concertation, l’inscription des publics ciblés dans les processus décisionnels et l’implication des usagers bénévoles sur les lieux de vente soutiennent l’implication citoyenne dans les systèmes agri-alimentaires. Et il est pertinent de compléter les dispositifs d’aide alimentaire par des moments de convivialité, vecteurs de sensibilisation, tels que les visites de ferme, les ateliers-cuisine ou les repas partagés (Photo 16).
Et si les projets foisonnent, ils peinent à perdurer et à élargir leur portée. En effet, la vulnérabilité économique des initiatives cantonne leurs retombées positives à une échelle locale, un nombre limité de personnes et un temps court. Pour lutter efficacement contre l’insécurité alimentaire et œuvrer dans un même mouvement en faveur d’une transition écologique, il est indispensable de dépasser l’approche « projet ».
La diversification des modèles économiques atténue la dépendance aux seules subventions publiques, tandis que la coordination des initiatives multi-échelles appuie leur plaidoyer politique. À cet égard, les expérimentations de Territoire à VivreS rassemblent cinq réseaux et associations françaises (Réseaux Cocagne, CIVAM et VRAC, Secours Catholique, Union nationale des groupements des épiceries sociales et solidaires) engagés dans le renouvellement des politiques nationales de lutte contre la précarité alimentaire vers des logiques d’actions systémiques durables et émancipatrices. À l’instar des réseaux de villes engagées sur des objectifs ambitieux sur les questions climatiques, il serait pertinent de renforcer les réseaux de villes dédiés à la transition écologique des systèmes agri-alimentaires, et de les lier. Si la vision « projet » peut s'avérer pertinente pour concrétiser des mesures favorisant l’amélioration de la sécurité alimentaire à court terme, un changement de paradigme est nécessaire pour impulser des mutations systémiques et des réponses politiques, à la hauteur des enjeux structurels de justice sociale et écologique.
Photo 16. Visite de la ferme Capri par les enfants de l'école primaire Saint-Joseph Servières (© Cité de l’agriculture).
À ce titre, la proposition d’instauration d’une sécurité sociale de l’alimentation, précédemment évoquée, est prometteuse : elle permettrait de changer d’échelle, d’abandonner le statut de bénéficiaire au profit de celui d’ayant droit et de renforcer la transition agricole et alimentaire.
-
-
Les leviers collectifs pour engager les transitions
Pour engager et renforcer les nécessaires transitions, même si le comportement individuel peut avoir une incidence majeure sur les orientations alimentaires et agricoles d’un pays ou d’une région, les initiatives collectives sont à privilégier. Elles passent par des ambitions et des projets qui dépassent l’échelle des individus, et des dynamiques qui permettent d’accélérer les processus de changement. Ce sous-chapitre s’attarde sur les projets alimentaires territoriaux, la mobilisation des acteurs agricoles et les leviers de mobilisation collective.
-
Quelles ambitions des projets alimentaires territoriaux en Provence-Alpes-Côte d'Azur ?
Depuis 2014, la multiplication des projets alimentaires territoriaux (PAT) témoigne du fort succès que ces instruments d’action publique ont sur l’ensemble du territoire national. Ces PAT font de l’alimentation une question centrale pour agir en faveur d’une reterritorialisation des activités de production, de transformation, de distribution et, in fine, de consommation.
Actuellement, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, figurent 27 PAT reconnus par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire et 5 projets sont en phase de réflexion, ce qui couvre 91 % de la surface administrative et 95 % de la population régionale. Même si tous ces PAT n’affichent pas les mêmes objectifs prioritaires, ils entrent tous dans une dynamique collective qui a l’ambition de faciliter les interconnexions, les complémentarités et les échanges d’expériences, afin d’améliorer la résilience alimentaire régionale (Photo 17).
Les leviers d’action sont multiples : restauration collective, reconnexion besoins/ressources et producteurs/ consommateurs, accompagnement à l’installation, préservation, voire augmentation, du foncier agricole, réduction du gaspillage alimentaire, etc. Les PAT soulèvent néanmoins des questionnements inédits relatifs à la définition des objectifs ou aux procédés choisis par exemple. Les connaissances acquises et les expériences mettent en évidence certaines conditions susceptibles de favoriser la mise en œuvre et la réussite des projets.
Comme introduit, ces projets proposent de réformer non seulement les modes de production, mais aussi les modes de transformation, de distribution et de consommation. Pour ne pas oublier des acteurs clés autour de la table, il est important de reconnaître et prendre en compte tous les maillons de la transformation du système alimentaire et les différentes structures associées. Cette première condition mène naturellement à la gouvernance du projet. L’institution d’un comité de pilotage étant prévue par le cadrage du PAT, les porteurs du projet doivent y associer les acteurs concernés ou ciblés par le projet. L’implication de ces derniers, notamment en amont du montage, et l’ajustement des modes de gouvernance avec les ambitions du projet sont des éléments clés pour assurer la réussite des PAT.
Une troisième condition concerne l’intersectorialité. Le travail entre services (agriculture, économie, santé, urbanisme, social, éducation, culture, développement durable, etc.) n’est pas toujours évident du fait d’une spécialisation des compétences, mais aussi des enjeux politiques locaux. Néanmoins, une approche transversale est fondamentale pour considérer et traiter les blocages qui empêchent la transition du système alimentaire de s’engager vers plus de durabilité.
Photo 17. Repas collectif durant une action du PAT de Mouans-Sartoux qui répond aux enjeux de santé des habitants et des écosystèmes : cantine 100 % bio (80 % d’approvisionnement local), gaspillage alimentaire réduit, aide financière à l’installation des agriculteurs bio, éducation à l'alimentation durable… (© Gilles Pérole)
Une quatrième condition concerne la collaboration inter-PAT. Si la commune est un territoire pertinent (il permet le déploiement des actions d’un PAT), la réalité des filières alimentaires et agricoles, ainsi que l’importance de la question économique, impliquent les échelons intercommunaux, voire départementaux et/ou régionaux. Ces échelles sont tout autant pertinentes et complémentaires.
Enfin, des études montrent combien les ambitions écologiques de la majorité des PAT sont souvent invisibles. Sous couvert de relocalisation et de reterritorialisation, les enjeux écologiques sont souvent omis dans les structures représentées et les actions définies. Or, au vu de la crise écologique et climatique à laquelle nous faisons face, les PAT offrent des champs d’actions pour concevoir des systèmes alimentaires ambitieux sous l’angle social et écologique.
Les 27 PAT de la région entrent tous dans une dynamique collective visant à améliorer la résilience alimentaire régionale.
Zoom 5. Les projets d'alimentation locale et solidaire soutenus par le plan France Relance
La crise sanitaire a mis en exergue la difficulté pour certains publics à accéder, pour des raisons financières, mais aussi pratiques, à une alimentation locale, fraîche, saine et à un prix abordable. Face à l’accroissement du nombre de personnes isolées ou en situation de précarité, les initiatives, portées par des associations, des entreprises, des collectivités, des acteurs de l’économie sociale et solidaire, se sont multipliées sur tout le territoire.
Dans ce contexte, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation en place à l’époque a débloqué, dès le début de l’année 2021, 30 millions d’euros afin d’encourager les projets permettant aux personnes modestes ou isolées d’accéder à une alimentation locale et de qualité sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin, en s’appuyant sur la mesure 12 du plan de relance. Ce soutien est complémentaire aux mesures portées par le ministère des Solidarités et de la Santé qui aident les associations de lutte contre la pauvreté.
L’appel à projets de la mesure « alimentation locale et solidaire » se décline aux niveaux national et départemental pour laisser une large part aux projets de proximité. Dans son volet national, la mesure soutient les projets structurants et innovants des acteurs « têtes de réseaux ». Au niveau territorial, une enveloppe est dédiée aux initiatives locales de tous les acteurs de la société civile et de l’économie sociale et solidaire qui s’engagent à faciliter l’accès à une alimentation saine, sûre, durable, de qualité et locale aux citoyens qui en sont éloignés.
Une enveloppe de 1,5 million d’euros a ainsi été fléchée en région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui a permis de soutenir 49 projets (Figure 14) s’inscrivant dans une ou plusieurs thématiques :
• soutien aux producteurs agricoles ayant des démarches collectives de structuration de l’approvisionnement en produits locaux et de qualité ;
• soutien aux associations, aux entreprises (PME, TPE, start-up), aux communes et aux intercommunalités ayant des projets de mise à disposition d’une alimentation de qualité pour tous ;
• soutien aux initiatives locales de développement de commerces solidaires ambulants destinés notamment aux personnes isolées ou modestes.
La mesure participe au financement des investissements matériels (matériel roulant, équipements de stockage) et immatériels (dépenses de formation, prestations de conseil) avec un taux de subvention pouvant aller de 40 à 80 % suivant les cas. Par exemple, 25 camions frigorifiques, permettant de distribuer des produits alimentaires locaux et de qualité à des associations caritatives (banque alimentaire ou restos du cœur par exemple) ou pour approvisionner des épiceries sociales et solidaires, ont été financés.
Figure 14. Enveloppes financières allouées aux projets « alimentation locale et solidaire » par département au 31 décembre 2021 (source : France Relance).
-
Mobiliser les acteurs des filières agricoles et passer à l’action
Face au changement climatique, l’enjeu est désormais de savoir comment y répondre. Il n’est plus possible de définir des orientations stratégiques de long terme sans intégrer la vulnérabilité climatique. Au sein des filières, les acteurs de l’amont (agriculteurs, éleveurs) paraissent plus enclins à élaborer des stratégies actives d’adaptation du fait de leur exposition fréquente aux aléas climatiques. Le maintien ou l’évolution des bassins de production et des filières agricoles ne se fera pas sans l’implication de tous les acteurs de la chaîne de valeur, pour créer de nouveaux débouchés, adapter les cahiers des charges (labels, appellations, etc.), éduquer les consommateurs et communiquer auprès d’eux, etc. Dès lors, la question est de savoir : sur quel périmètre ? Comment mobiliser ? Et quelle stratégie adopter pour construire des systèmes résilients ?
En ce sens, un guide méthodologique à destination des acteurs des filières agroalimentaires intitulé « Comment développer sa stratégie d’adaptation au changement climatique à l’échelle d’une filière agroalimentaire ? » a été produit en 2019 (partenariat ACTERRA-ADEME). La méthode proposée repose notamment sur l’élaboration de trajectoires d’adaptation, permettant de dessiner des stratégies d’adaptation au changement climatique flexibles et ajustables dans le temps, en fonction de l’intensité du changement climatique. Les démarches d’adaptation (Figure 15) doivent s’inscrire dans des enjeux sociétaux et environnementaux plus larges, comme l’évolution de la consommation alimentaire et la nécessaire atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
Cette étude, dont les résultats ont été présentés à l’occasion du Sommet Virtuel du Climat 2021, a constitué un premier travail exploratoire dans l’accompagnement des filières. Elle s’est poursuivie en 2021 pour analyser les démarches d’adaptation au changement climatique dans les secteurs agricoles, mais aussi forestiers, en orientant plus particulièrement vers les modalités de mobilisation des acteurs et le passage à l’action. Plusieurs facteurs de réussite ont été identifiés. Les enseignements et recommandations formulés pour accompagner les acteurs dans leur démarche soulignent l’importance de :
1. définir l’échelle de travail la plus adaptée : entre filière(s) et/ou territoire(s) ;
2. s’appuyer sur les structures de portage existantes (autant que possible) ;
3. raconter le futur, esquisser les chemins possibles ;
4. proposer des trajectoires « sans regret » à court terme, pour préparer les transformations nécessaires à long terme ;
5. proposer des démarches de co-construction participatives et garder une flexibilité dans la gestion du projet ;
6. s’appuyer sur la pédagogie des aléas majeurs comme un argumentaire possible de mobilisation ;
7. mettre en avant les co-bénéfices créés ;
8. mobiliser les financements en faveur de l’adaptation.
Ces recommandations sont applicables pour faire évoluer les filières agricoles, mais aussi alimentaires en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Figure 15. Organisation de la démarche (source : ADEME, 2019).
Zoom 6. Le projet PARCEL en faveur d’une alimentation résiliente citoyenne et locale
PARCEL est un outil web simple, ludique et gratuit, permettant d’évaluer pour un territoire donné les surfaces agricoles nécessaires pour se nourrir localement. Il mesure aussi les emplois agricoles et les impacts écologiques associés à d’éventuels changements de mode de production agricole et/ou de régimes alimentaires (émissions de gaz à effet de serre, pollution des ressources en eau, effets sur la biodiversité…).
Développé par Terre de Liens, la Fédération nationale de l’agriculture biologique (FNAB) et le Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif (BASIC), PARCEL invite les citoyens et les élus à se saisir des enjeux actuels de l’alimentation en leur proposant de « jouer » sur trois des principaux leviers de durabilité de l’alimentation :
• la reterritorialisation des filières alimentaires ;
• les modes de production agricole ;
• la composition des régimes alimentaires.
Répondant aux préoccupations inscrites dans sa charte, le Parc naturel régional du Luberon s’est questionné sur le potentiel nourricier de son territoire et son évolution. C’est dans cet objectif qu’une analyse prospective très fouillée a été menée avec Le BASIC grâce à l’utilisation de l’outil PARCEL. Appliqué au Luberon, PARCEL a permis d’évaluer l’autonomie alimentaire du territoire, d’explorer deux scénarios pour 2030 et ainsi, de sensibiliser les élus sur l'importance de se mobiliser pour soutenir le maintien et l’installation de productions agricoles nourricières. Le premier scénario fournit un aperçu de l’évolution de l’agriculture si la tendance actuelle perdure, avec une diminution proche de 40 % du potentiel nourricier du territoire corrélé à un phénomène d’agrandissement des exploitations et de perte de diversité des productions. Le deuxième scénario prend en compte des actions en faveur d’une transition permettant de valoriser et soutenir la diversité des productions.
Ce diagnostic permet de fournir des éléments concrets aux acteurs locaux afin de développer plusieurs scénarios à leur(s) échelle(s) dans l’objectif de nourrir les nécessaires débats sur les enjeux de la transition alimentaire et de l’usage des terres agricoles.
-
Quels sont les leviers pour changer les comportements alimentaires ?
Activité sociale par excellence, les pratiques alimentaires sont le terrain d’actualisation de diverses ambitions sociales et interindividuelles. Les impacts de ces pratiques en termes de santé et d’environnement ont contribué à l’inscription des pratiques alimentaires dans l’agenda des politiques publiques depuis une vingtaine d’années (Programme national nutrition santé par exemple).
Les leviers pour orienter les comportements alimentaires vers plus de durabilité sont nombreux : éducation, marketing, régulation économique… Une partie importante de ces instruments repose sur l’image de « l’individu rationnel » dont les choix suivraient une logique de maximisation des intérêts individuels. Plus récemment, des travaux sur les pratiques alimentaires montrent que, loin de résulter exclusivement d’une négociation entre intérêts individuels et contraintes contextuelles, les modifications de pratiques dépendent de motivations complexes à l’interface entre les préoccupations individuelles, collectives et les dimensions cognitives, normatives et matérielles. La complexité de ces transformations est d’autant plus évidente dans un contexte de changement climatique où les dérèglements à l’œuvre résultent des dysfonctionnements entre les systèmes sociaux et les milieux biophysiques.
Autrement dit, au-delà de la motivation basée sur l’information, les changements d’habitudes alimentaires requièrent l’apprentissage de nouveaux savoirs et de nouvelles pratiques, ainsi que des arrangements matériels favorables. Se déplacer, choisir, reconnaître, acheter, ranger, transformer, conserver et modifier les habitudes alimentaires impliquent de modifier l’ensemble de ces actions réunissant à la fois des enjeux cognitifs (associer les produits biologiques et la santé par exemple), normatifs (valoriser socialement une pratique de consommation par exemple) et matériaux (savoir transformer un végétal peu commun par exemple). Suivant ce constat, les politiques publiques gagneraient à prendre en compte les contraintes cognitives et pratiques auxquelles les acteurs doivent faire face pour modifier leurs habitudes alimentaires en faveur de plus de durabilité.
Les situations collectives offrent des contextes idéaux pour agir sur les leviers disponibles tout en créant des situations conviviales facilitant l’interaction et l’apprentissage entre pairs. Concrètement, les politiques publiques territoriales peuvent d’une part, encourager et supporter les initiatives portées par des acteurs locaux (supermarchés de consommateurs, magasins de producteurs, AMAP, associations de quartier, structures de l’économie sociale et solidaire, etc.), et d’autre part, mettre en place des instruments déjà existants (Foyers à Alimentation Positive, De ferme en ferme, Ici.C.Local, etc.) fournissant des solutions pour accompagner l‘adoption de nouvelles pratiques alimentaires des habitants. Dans le déploiement de ces initiatives multi-acteurs, il est indispensable de prendre en compte les coûts sanitaires, sociaux et environnementaux de l’alimentation (« le vrai coût de l'alimentation »), condition indispensable pour permettre la transition alimentaire à grande échelle.
Les dimensions collectives ont, pour finir, l’avantage de pouvoir inclure les différents maillons du système agri-alimentaire, à savoir les politiques publiques, les filières de production, de transformation, de distribution, mais aussi les consommateurs, la société civile et la recherche. Elles offrent ainsi la possibilité de contourner une vision du consommateur à lui seul responsable de l’impact environnemental du système alimentaire et d’engager des changements plus larges en prenant en compte les marges de manœuvre et les contraintes des différents maillons.
-
-
-
Pour conclure...
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, compte tenu de sa situation géographique contrastée, permet d’aborder de manière concrète de nombreux enjeux liés aux transitions alimentaires et agricoles, dont la portée résonne au-delà des limites régionales. Le régime méditerranéen, au cœur des réflexions de cet ouvrage, est porteur de solutions en faveur de la santé humaine et de celle des agroécosystèmes, mais ses productions associées peuvent s’avérer vulnérables face au changement climatique. Leur fragilité est aussi manifeste vis-à-vis des pays lointains pouvant présenter des avantages comparatifs. Dans une région caractérisée à la fois par des potentialités agricoles limitées et une forte densité de marchés urbains de proximité, le renforcement du lien entre production et consommation locale est source d’espoirs, mais connaît encore des faiblesses pour constituer un modèle permettant de diffuser au plus grand nombre de nos concitoyens les bienfaits du régime méditerranéen. Des paradoxes sont encore en suspens : par exemple, le régime méditerranéen intègre, comme bon nombre de régimes traditionnels, un mélange de deux types de graines aux complémentarités essentielles sur le plan alimentaire et agronomique, les céréales (ou pseudo-céréales) et les légumineuses (famille des luzernes, haricots, pois, etc.). Outre leur complémentarité nutritionnelle, ces deux espèces ont des complémentarités sur le plan agronomique. Les légumineuses permettent en effet d’apporter dans les systèmes de culture de l’azote, réduisant significativement les besoins en engrais minéraux qui sont produits, pour une majorité d’entre eux, à partir de gaz, matière première au cœur des tensions climatiques et géopolitiques actuelles. Cet apport déterminant explique que, dans la plupart des systèmes de culture équilibrés, les légumineuses occupent 10 à 15 % des surfaces cultivées. En Europe et en France, cette proportion est nettement moins élevée. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, comme dans toutes les régions françaises, des efforts visent à réintégrer ces espèces dans les systèmes de production. C’est par exemple le cas des légumes secs, pois chiches et lentilles. Malgré une dynamique positive, ayant conduit à une extension significative des surfaces dédiées à ces espèces, ces dernières années ont montré la vulnérabilité de ces productions, comme en 2021 où la production a été divisée par 2, voire plus, à cause d’une conjonction d’aléas climatiques. Pourtant, la France n’est autosuffisante que pour la moitié de sa consommation de ces espèces. Ce paradoxe s’explique par des logiques d’import, aujourd’hui mondialisées, régies par des stratégies offensives des pays en développement (faible coût de production) ou des pays développés (grandes exploitations, capacité technique, organisationnelle et technologique, utilisation de pesticides et d’engrais chimiques…).
Les légumineuses, composante clé d’une transition agroécologique et alimentaire, font donc face à une double vulnérabilité, agroclimatique et économique, du fait de distorsions de concurrence. Elles ne sont pas les seules : nombre de cultures maraîchères et fruitières, également emblématiques de la région, sont aussi soumises à ces vents contraires. L’un des enjeux des politiques publiques est de fournir un espace suffisamment sûr pour tous les opérateurs de ces cultures, permettant de soutenir durablement les investissements favorisant leur production (et la nécessaire recherche semencière et agronomique), leur transformation, leur commercialisation et leur consommation. Les initiatives de relocalisation et de reconnexion des marchés urbains de proximité avec les productions locales constituent des initiatives positives à renforcer. Ces modèles doivent toutefois relever au moins trois défis pour accroître encore leur impact sur notre alimentation et notre agriculture :
● premièrement, ils doivent réussir une montée d’échelle, capable de générer des volumes suffisants pour faciliter un accès au plus grand nombre. Pour cela, l’échelle géographique de la production locale doit parfois passer de quelques kilomètres à quelques centaines : comment assurer cela sans distendre le lien territorial entre producteur et consommateur, et sans tomber dans les travers des distorsions de concurrence ?
● deuxièmement, en lien avec le premier point, ces modèles doivent mieux intégrer les denrées de base. En effet, l’immense majorité des initiatives de territorialisation de l’alimentation concernent des productions maraîchères, fruitières et aussi animales, plus faciles à identifier et relier à un terroir, voire à une exploitation agricole individuelle. A contrario, rien de ressemble plus à une semoule de blé dur ou un sachet de pois chiches du plateau de Valensole qu’aux mêmes produits venus du Manitoba ;
● enfin, ces approches doivent permettre de retrouver un dialogue apaisé et une compréhension collective des nécessaires moyens de production agricole, utiles à la mise en place et au maintien d’une agriculture diversifiée, fournisseuse d’aliments et de services écosystémiques garants d’Une seule santé (One Health en anglais). Le cas de la gestion de la ressource en eau en Provence-Alpes-Côte d’Azur est à ce titre symbolique, et devrait éclairer les débats actuels tendus sur ce sujet. Les grands ouvrages et investissements autour de la Durance sont en effet un bel exemple de la manière dont l’accès à l’eau rend possible l’existence d’une diversité de productions autrement inaccessibles dans un environnement pédoclimatique difficile. Ces investissements collectifs, conçus depuis maintenant des décennies, offrent un large éventail de possibilités d’adaptation au changement climatique que nous connaissons. Retrouver un dialogue serein sur ces questions sera à la fois une condition nécessaire à l’essaimage des pistes présentées dans cet ouvrage, et le signe visible du fait qu’elles ont réussi.
Ces paradoxes ne recouvrent que partiellement les problématiques liées aux systèmes alimentaires et agricoles, abordées dans ce cahier, mais ils mettent en lumière certains défis à relever, même si des solutions existent à l’échelle régionale pour assurer une transformation profonde de nos pratiques, de la ferme à l’assiette. Les politiques publiques, à tous les échelons territoriaux, doivent accompagner le changement et soutenir les démarches individuelles et collectives en faveur de l’adaptation au changement climatique et de l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, tout en garantissant une plus grande justice sociale. Face au changement climatique, les transitions alimentaires et agricoles ne doivent pas être perçues comme des freins ou des contraintes par les différents acteurs des filières et des territoires, mais comme des opportunités pour améliorer le fonctionnement de nos modèles actuels, développer l’innovation, stimuler l’économie locale, limiter les impacts sanitaires… L’évolution de nos régimes alimentaires, de nos modes de production agricole (agroécologie, agroforesterie…) et de consommation, le respect des recommandations nutritionnelles qui est une question cruciale en lien fort avec la santé et les transitions, la réduction du gaspillage alimentaire, la réorientation de la commercialisation des produits, les outils, comme les PAT, la restauration collective ou la sécurité sociale de l’alimentation par exemple, peuvent changer la donne et rendre la région exemplaire, en tendant vers la souveraineté, la sécurité, l’autosuffisance et la résilience alimentaires. Vu la grande complexité des systèmes et des interactions multi-échelles, il est nécessaire de mobiliser l’ensemble des protagonistes et de sensibiliser tous les publics pour réussir le pari des transitions.
-
Contributeurs
Sommaire du cahier
- Résumé
- Introduction générale
- Les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture
- L'alimentation régionale au cœur des problématiques sanitaires et climatiques
- Quels sont les régimes alimentaires et recommandations nutritionnelles ?
- Des pistes pour changer nos systèmes agri-alimentaires
- Les mesures sociales et collectives pour accélérer les transitions alimentaires et agricoles régionales
- Pour conclure...
- Contributeurs